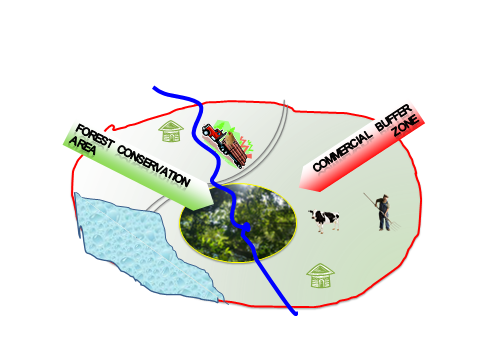Renforcement des récifs pour la protection des côtes
Construire le récif artificiel pierre par pierre.
The Nature Conservancy
Si les digues, les rochers et les autres approches dures de la protection côtière constituent la bonne approche dans certaines régions, elles sont également très coûteuses, nécessitent beaucoup d'entretien et détruisent le littoral vivant que nous chérissons tous. Les solutions fondées sur la nature cherchent à intégrer les structures construites et les systèmes naturels tels que les récifs, les plages, les mangroves et les bois côtiers, ainsi que les forêts. Les solutions fondées sur la nature sont souvent beaucoup moins coûteuses et offrent également des avantages plus importants, tels que la production alimentaire et des lieux de loisirs magnifiques. Ce projet vise à installer des structures récifales conçues pour fournir un habitat aux poissons et aux coraux, briser l'énergie des vagues et, en fin de compte, réduire l'érosion côtière et les inondations. La phase de conception comprenait des mesures détaillées du fond marin, la modélisation de l'énergie des vagues à l'aide des données des soixante dernières années et l'ingénierie côtière. La main-d'œuvre et l'équipement locaux ont été utilisés pour installer une première série de structures. L'installation a duré au total trois semaines et constitue l'un des projets pilotes les plus importants de TNC pour tester des solutions naturelles au changement climatique.
- Compréhension par la communauté de l'importance et des avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du projet ; - Acceptation par la communauté, participation au processus du projet et appropriation du projet ; - Implication et participation des ministères et départements gouvernementaux dans les processus du projet ; - Partenariats avec la Croix-Rouge de la Grenade et l'ONG Grenada Fund for Conservation et d'autres groupes communautaires qui ont contribué à la mobilisation des communautés et à l'autonomisation des parties prenantes ; - Participation de la communauté à la mise en œuvre du projet ; - Participation de la communauté à la mise en œuvre du projet ; - Participation de la communauté à la mise en œuvre du projet.
- L'engagement et l'adhésion de la communauté à tous les stades, ainsi que les partenariats avec les organisations et les groupes communautaires locaux, ont été essentiels à la réussite de la mise en œuvre : - Précision des données bathymétriques disponibles (nous avons utilisé des données dérivées de satellites, mais cela a entraîné des inexactitudes et des retards lors de l'installation ; l'accès à des données LIDAR (détection et télémétrie par ondes lumineuses) aurait été idéal) ; - Compte tenu de la nature expérimentale de ce bloc, le phasage de l'installation a été essentiel ; - L'emploi d'un opérateur de plongée commercial local et de plongeurs locaux a été essentiel lors de l'installation, car l'expérience du plongeur commercial et la connaissance du contexte local par les plongeurs se sont révélées inestimables ; - L'utilisation d'un système d'alerte précoce pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental a été essentielle.