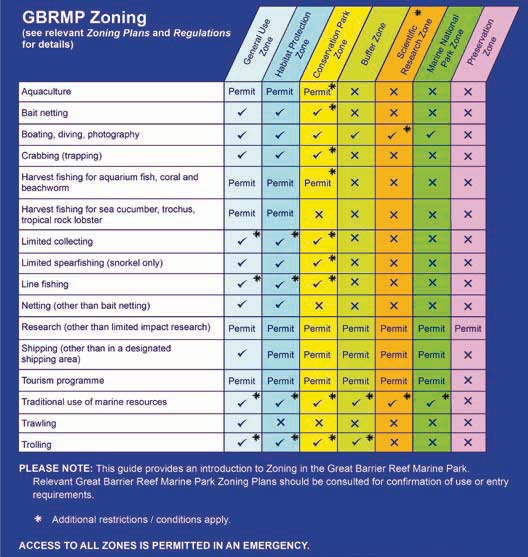Produits de communication ciblés et sensibilisation
Après avoir développé plusieurs produits de communication destinés à différents publics, nous avons publié les résultats de l'évaluation lors du symposium de l'Année internationale des récifs, qui s'est tenu à Belize City en novembre 2008. Nous avons également distribué les résultats dans une brochure de synthèse de six pages destinée aux décideurs ; plusieurs partenaires locaux ont également intégré les résultats dans des vidéos présentées au Premier ministre et à d'autres responsables lors de la soirée de gala qui s'est tenue ce soir-là. À la demande du Protected Areas Conservation Trust (PACT), nous avons également produit un document d'une page destiné aux décideurs politiques et l'avons distribué par l'intermédiaire du PACT et d'autres partenaires locaux. Nous avons également créé des outils basés sur Excel pour faciliter la reproduction de nos méthodes d'évaluation et de collecte de données. Ces outils et manuels d'utilisation, ainsi que le rapport technique complet et le résumé, peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site web. L'initiative Healthy Reefs for Healthy People, ainsi que le WWF, WCS, Oceana et de nombreuses autres ONG locales, ont utilisé les résultats de l'évaluation économique dans leurs efforts pour négocier des réglementations plus strictes en matière de pêche, une nouvelle législation sur les mangroves, une interdiction des forages pétroliers en mer et d'autres objectifs en matière de conservation et de gestion durable.
- Partenariat et engagement des parties prenantes : Une collaboration étroite avec des partenaires dévoués a permis d'assurer une communication pertinente et efficace avec les décideurs. Dans la plupart des cas, nos partenaires béliziens ont mené les activités de sensibilisation et de diffusion. Accès critique aux décideurs grâce aux partenaires béliziens - Présentation stratégique des résultats : Nous avons comparé la valeur des récifs coralliens et des mangroves du Belize au PIB national. - Rapidité : La publication des résultats a coïncidé avec des événements et des activités importants au Belize.
Utilisez différents produits de communication (par exemple, un long document, un bref résumé des principales conclusions, une vidéo, des présentations) et différents canaux (par exemple, des événements publics, des réunions privées ciblées, par l'intermédiaire de partenaires et de leurs réseaux) pour atteindre vos principaux publics. Encouragez en particulier vos partenaires à utiliser et à promouvoir vos résultats et vos recommandations.