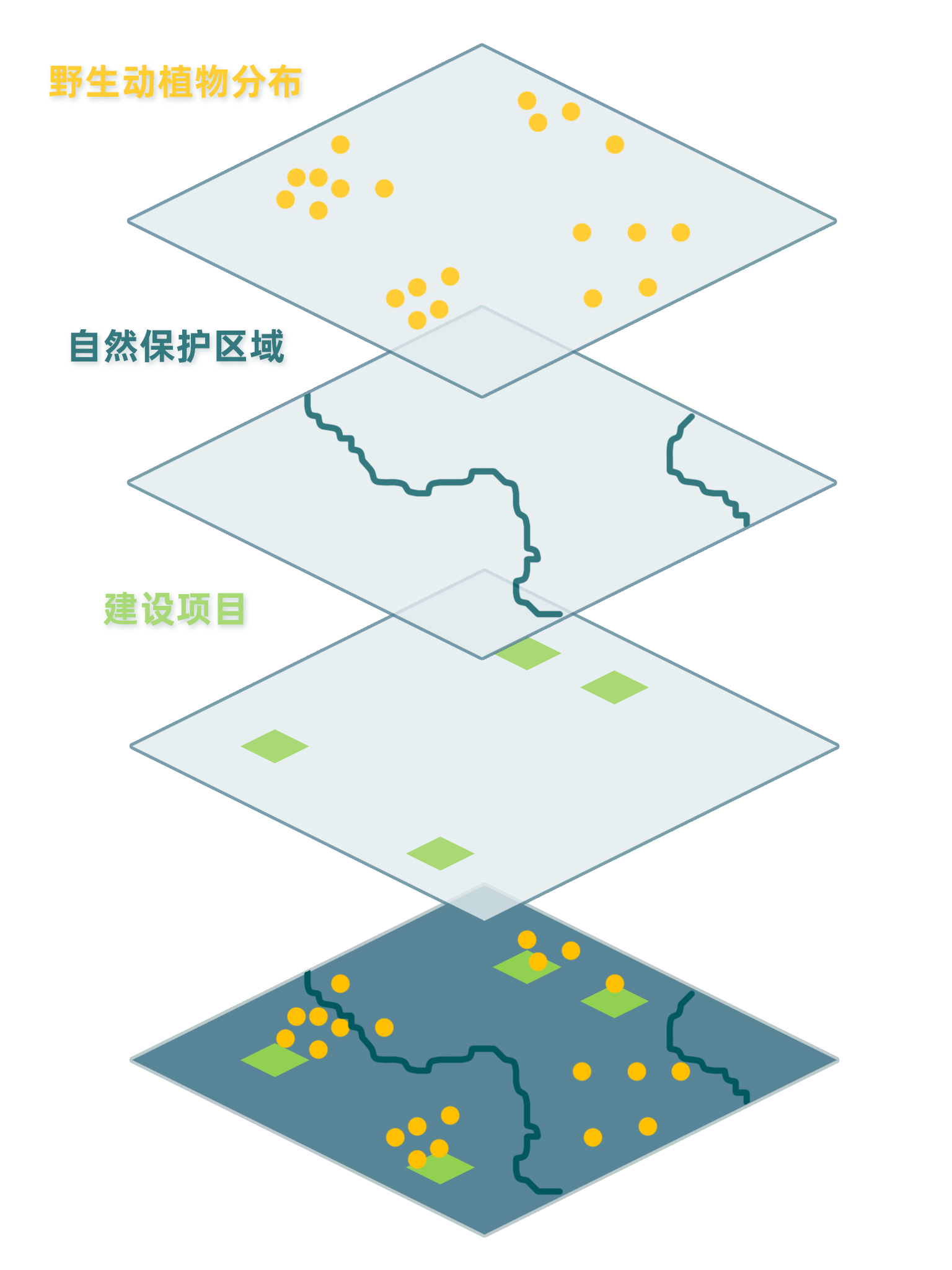Évaluation, diffusion et gestion efficace de la conservation.
Les techniques de gestion des rejets, la collecte de données et la nécessité d'intervenir sont évaluées en permanence afin de faciliter une gestion adaptative efficace au quotidien.
La diffusion des méthodes et des résultats est un outil important pour communiquer avec les donateurs, attirer de nouveaux financements ou le soutien des parties prenantes, et accroître la sensibilisation au niveau national et international.
Les rapports mensuels destinés aux partenaires du projet sont publiés en ligne à l'adresse www.BirdsOnTheEdge.org dans un format facile à lire qui interpelle le public. En conséquence, le projet a reçu des financements, a attiré des recherches de troisième cycle, a contribué à la mise en réseau avec des praticiens internationaux et a inspiré d'autres organisations.
Des travaux sont actuellement en cours pour analyser les données existantes, identifier les lacunes en matière de données et mener des recherches qui contribueront à l'élaboration d'un plan de gestion à long terme.
Durrell a récemment intégré les normes ouvertes pour la pratique de la conservation dans sa planification stratégique à l'aide du logiciel Miradi.