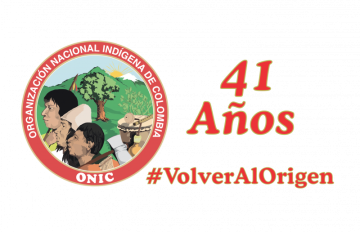Renforcement des pratiques de gestion de l'eau résistantes au climat pour les communautés vulnérables de La Mojana, en Colombie

Les inondations intenses et les saisons sèches prolongées dues à la modification du régime des précipitations ont eu des répercussions importantes sur la population de la région de La Mojana, et les projections climatiques prévoient que ces phénomènes deviendront plus fréquents et plus intenses.Les impacts comprennent la perte de récoltes, des changements dans les écosystèmes et leur capacité à fournir des services de gestion de l'eau, ainsi que des impacts négatifs dus à des périodes de sécheresse plus longues. Ces impacts exercent une pression supplémentaire sur les sources d'eau surchargées, affectant à la fois l'approvisionnement et la qualité. La solution présentée adopte une stratégie à long terme de réduction des risques de catastrophes liées à la sécheresse et aux inondations et tenant compte des risques liés au changement climatique. Elle ne repose pas uniquement sur les infrastructures d'approvisionnement en eau, mais aussi sur la restauration des services écosystémiques pour une gestion régionale adaptée de l'eau et sur le renforcement de la capacité de résistance au climat et des moyens de subsistance ruraux compatibles avec les écosystèmes, avec un impact sur la sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau des ménages.
Contexte
Défis à relever
Les projections climatiques indiquent que la majeure partie de La Mojana connaîtra une réduction des niveaux de précipitations totales associée à des températures plus élevées. Les données montrent que les périodes sèches moyennes (jours sans pluie) pourraient être prolongées de 12 à 30 jours.
La Mojana est extrêmement vulnérable à la variabilité du climat et très sensible aux conséquences des inondations et des périodes de sécheresse prolongées qui ont entraîné des pertes de récoltes. L'activité agricole non durable affecte la dynamique naturelle des flux d'eau dans l'écosystème des zones humides de la région, qui fournit des services sous forme de protection naturelle contre les inondations, de purification de l'eau et des sédiments et d'approvisionnement en eau, ainsi qu'une valeur économique grâce à l'utilisation agroproductive.
Le changement climatique a accru la dépendance de la communauté à l'égard de ces services, car l'eau s'est raréfiée en raison de périodes de sécheresse prolongées qui ont mis à rude épreuve l'infrastructure hydrique existante. D'autre part, les inondations deviendront plus fréquentes, ce qui augmentera la nécessité pour les zones humides de jouer un rôle de tampon.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Les blocs de construction ne s'attaquent pas seulement aux obstacles, mais travaillent sur l'ensemble des intrants clés de la gestion de l'eau, y compris les informations sur la capacité d'infiltration de l'aquifère (bloc de construction 1), l'accès à l'approvisionnement en eau (bloc de construction 2), l'ajustement de la production agricole en fonction des projections climatiques en termes de sécheresse (blocs de construction 4 et 5) et la restauration d'une source principale de gestion de l'eau, à savoir l'écosystème de la zone humide lui-même (bloc de construction 3). Plus important encore, elle le fait en donnant aux communautés et aux organisations locales les moyens d'assurer la durabilité à long terme du projet, non seulement par l'accès à des systèmes d'information climatique améliorés, mais aussi par la capacité à les utiliser pour une planification correcte à différents niveaux (planification et productivité locales).
Cela permet au projet d'améliorer la résilience en travaillant avec l'écosystème (plutôt que contre lui) pour gérer les impacts climatiques. Il s'agit d'un changement important par rapport aux anciens mécanismes d'approche des risques introduits dans la région, qui visaient à contenir les inondations plutôt qu'à les gérer dans le cadre du processus hydrologique naturel de la région. Le travail sur les moyens de subsistance des communautés a en quelque sorte permis à ces dernières de retrouver des moyens de subsistance traditionnels qu'elles avaient perdus.
Blocs de construction
Renforcement de la compréhension et de la systématisation des connaissances sur les impacts du changement climatique (CC) sur la gestion de l'eau dans la région
Les processus de planification locale n'ont pas intégré les considérations liées au changement climatique en raison d'un manque d'orientations techniques et institutionnelles sur la manière d'intégrer les incidences, les projections et les risques climatiques dans la planification et les activités municipales quotidiennes telles que la délivrance de permis d'extraction d'eau. Les parties prenantes n'avaient qu'une connaissance pratique limitée de la signification des projections climatiques et des options d'adaptation disponibles. Les informations n'étaient pas toujours accessibles à tous, ni regroupées pour traduire l'apprentissage en action.
Le projet a investi dans le développement de produits de connaissance pour la gestion de l'eau, tels qu'un modèle de débit et de qualité des eaux souterraines, afin de fournir les informations nécessaires au renforcement des capacités de gestion et de régulation de l'eau des autorités locales. Le modèle est accompagné d'un guide à l'intention des décideurs afin de garantir la capacité locale à l'utiliser dans le cadre de la planification. Le projet a également investi dans une stratégie de socialisation afin de permettre aux communautés de recevoir des informations et des formations ciblées pour une meilleure compréhension. Il s'agit notamment d'investir dans une stratégie indigène qui comprend des informations et des méthodes traditionnelles sur la gestion de l'eau, afin de concevoir un module de formation qui sera présenté par des universités indigènes. Pour assurer la continuité et la disponibilité des informations, celles-ci ont été systématisées dans une banque de données située au sein d'une agence nationale.
Facteurs favorables
Partenariats clés et compréhension des acteurs locaux, des préoccupations et des vulnérabilités, y compris l'identification des messages, des besoins et des moyens de communication. La collaboration avec le Fonds national d'adaptation a été un atout majeur pour assurer la coordination et l'intégration des produits de gestion des connaissances et leur utilisation.
Leçon apprise
La socialisation est une stratégie clé qui doit être intégrée pour garantir un changement transformationnel. Il s'agit notamment d'investir dans des messages adaptés aux principales parties prenantes afin de favoriser la pertinence des messages et de veiller à ce que les informations soient utilisées par ces groupes de parties prenantes. Travailler par l'intermédiaire des institutions locales, des parties responsables et des acteurs locaux permet également à la gestion des connaissances de rester sur le territoire, créant ainsi une source importante d'appropriation locale.
Ressources
Renforcer les infrastructures des systèmes d'eau pour améliorer l'approvisionnement en eau potable des communautés rurales en cas de sécheresse et d'inondation
L'accès à des sources fiables d'eau potable est l'un des problèmes les plus critiques à La Mojana. Plus de 42 % de la population n'a pas accès à l'eau potable. Cette situation sera exacerbée par l'augmentation des températures et la fréquence accrue des événements extrêmes tels que les inondations.
Le projet a investi dans un ensemble diversifié de solutions pour l'eau, sur la base d'une analyse de la vulnérabilité locale qui a été développée pour catégoriser la capacité d'accès à l'eau. Ces solutions comprennent des systèmes de collecte de l'eau de pluie pour les ménages et les communautés afin de récupérer l'eau pendant les saisons des pluies et d'améliorer l'infrastructure de l'eau existante. Pour ce faire, on a réparé les micro-aqueducs locaux et on s'est assuré qu'ils étaient capables de résister à une utilisation pendant les mois d'été (utilisation de panneaux solaires pour réduire la pression sur les pompes à eau, amélioration des systèmes de pompage et des réservoirs) et qu'ils étaient capables de protéger les sources d'eau contre la contamination en cas d'inondation.
Les solutions sont accompagnées d'une formation sur le fonctionnement et l'entretien de ces systèmes et sur le contrôle de la qualité de l'eau. Une formation est également dispensée aux commissions locales de l'eau afin de renforcer les capacités des communautés en matière de gestion de l'eau. Les capacités sont fournies par les parties responsables locales afin de s'assurer que les connaissances restent dans la région et sont pertinentes et que les ménages sont conscients de l'impact que le changement climatique aura sur les sources d'eau locales.
Facteurs favorables
Les connaissances tirées d'une analyse des flux hydrologiques dans la région ont permis une première compréhension de l'impact que le changement climatique pourrait avoir en termes de sources d'eau. Cela a permis au projet d'identifier la vulnérabilité et les besoins en eau. Une analyse de vulnérabilité développée par le projet a permis d'évaluer la bonne solution pour l'eau au niveau des ménages en fonction de leur accès aux infrastructures d'eau traditionnelles. Les partenariats avec les municipalités locales ont été un facteur clé, de même que la collaboration avec les parties responsables basées sur le territoire.
Leçon apprise
Les résultats de l'analyse de vulnérabilité sont devenus un élément clé dans l'attribution des solutions en matière d'eau, car ils ont permis au projet d'identifier de nouveaux investissements et de fournir l'additionnalité nécessaire pour leur permettre de bien fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes. L'analyse de vulnérabilité a également permis au projet de s'adapter aux conditions locales changeantes, telles que les perturbations liées au COVID. L'un des résultats a été de générer une résilience locale au COVID en fournissant l'accès à l'eau nécessaire à la mise en œuvre des protocoles d'hygiène.
La collaboration avec les municipalités a permis au projet de se coordonner au niveau local et, dans certains cas, d'augmenter l'allocation du cofinancement. Cela a permis au projet d'aborder sa théorie du changement de manière proactive en incorporant des considérations climatiques dans les investissements municipaux. L'un des principaux défis a été de gérer les effets du COVID qui ont affecté la tarification des intrants pour les infrastructures d'eau et leur transport. Le projet est revenu vers les parties responsables locales dans la région pour fournir un soutien plus important au renforcement des capacités et à la socialisation générale des solutions.
Ressources
Restauration des services écosystémiques des zones humides pour la gestion de l'eau
La zone est située sur un système de zones humides qui fournit des services de protection naturelle contre les inondations, de purification et d'approvisionnement en eau, ainsi qu'une valeur économique pour les moyens de subsistance de la communauté. Le changement climatique a accru la dépendance de la communauté à l'égard de ces services, car l'eau s'est raréfiée et les inondations sont devenues plus fréquentes.
Le projet collabore avec le ministère de l'environnement, l'institut de recherche Alexander von Humboldt et les services environnementaux locaux pour restaurer les principales zones humides. Les travaux de restauration sont guidés par la modélisation des flux hydrologiques qui a été développée dans la région par le Fonds national d'adaptation et qui a servi d'apport important pour la planification locale. Les travaux de restauration sont organisés par des plans de restauration communautaires et un suivi environnemental effectué par les communautés locales, en particulier les femmes. Les actions de restauration comprennent une approche du paysage productif qui privilégie la compatibilité avec l'écosystème des activités productives dans la région, y compris les activités agroforestières et sylvo-pastorales. Il s'agit notamment d'identifier des moyens de subsistance compatibles avec l'écosystème qui soient accessibles aux femmes et aux populations autochtones. Le projet collabore avec des associations d'éleveurs pour élaborer un code de pratique le long des zones humides dans le cadre de son approche de la gestion durable des écosystèmes.
Facteurs favorables
La connaissance de l'hydrologie des zones humides, le partenariat avec les institutions environnementales nationales et locales et la collaboration avec les communautés ont été des facteurs essentiels pour permettre à ces activités de s'aligner sur la planification locale et nationale tout en apportant des avantages et en suscitant l'adhésion des populations locales.
Leçon apprise
Travailler avec des associations productives pour renforcer les capacités de gestion productive durable permet au projet d'établir des partenariats stratégiques pour la restauration de l'écosystème tout en créant une prise de conscience sur les avantages fournis par l'écosystème des zones humides. L'écosystème des zones humides est un élément important de l'identité de La Mojana, c'est pourquoi le projet a travaillé avec les communautés pour retrouver cette identité amphibie en travaillant avec les impulsions naturelles de l'écosystème plutôt que contre elles. En ce sens, les travaux de restauration font partie de la stratégie d'adaptation communautaire sur laquelle le projet s'est appuyé et qui vise à garantir que la résilience prenne en compte les besoins des communautés et que les bénéfices reviennent aux communautés locales d'une manière inclusive. Il s'agit d'un aspect essentiel de la théorie du changement du projet et d'une partie de la stratégie de durabilité du projet en permettant un changement de culture vers une activité agro-productive dans la région.
Ressources
Amélioration des systèmes d'alerte précoce
Cette composante reconnaît la volatilité croissante des conditions météorologiques (en particulier sous la forme de précipitations) qui sera ressentie à La Mojana en raison du changement climatique. Bien qu'il existe certaines capacités locales d'alerte précoce, la couverture des stations météorologiques et la capacité de gestion des données étaient insuffisantes pour les alertes météorologiques localisées qui permettraient aux communautés de protéger leurs moyens de subsistance, d'autant plus que les inondations passées ont entraîné d'importantes pertes économiques et ont affecté la sécurité de l'eau et des conditions météorologiques.
Le projet a répondu au besoin de systèmes d'alerte précoce en renforçant le développement d'un centre de prévision régional doté d'une capacité de modélisation hydrologique et de développement de produits d'information d'alerte précoce. Cela a permis d'élaborer des bulletins agricoles et des alertes en temps opportun qui ont amélioré l'accès des communautés aux informations climatiques. Le projet a également fourni des informations sur la manière de gérer les alertes précoces, en cherchant à intégrer les capacités locales. Cela permet de passer de l'information à l'action tout en se rapportant aux investissements réalisés dans le cadre des blocs 2, 3 et 5 qui génèrent une capacité d'adaptation en matière de gestion de l'eau à des fins domestiques et productives.
Facteurs favorables
Une étude hydrologique des systèmes de zones humides développée par le Fonds national d'adaptation et intégrant le changement climatique a démontré la pertinence des systèmes d'alerte précoce pour protéger les moyens de subsistance et les raisons pour lesquelles ils devaient être renforcés. Le projet a également établi une relation avec le système météorologique national (IDEAM) qui a permis le développement d'un système de prévision régional à intégrer dans le réseau national de stations.
Leçon apprise
Les alertes précoces constituent une base d'action car elles permettent aux communautés de comprendre de manière tangible la pertinence des investissements du projet et la manière dont ils les concernent. Il s'agit d'un élément clé si l'on considère les inondations passées qui ont eu des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance. Cependant, la diffusion de ces alertes et bulletins est insuffisante si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie de socialisation active afin que l'information soit comprise et conduise à une meilleure prise de décision. La collaboration avec les associations productives, les parties responsables locales et les autorités environnementales locales a été un pilier de la communication d'informations aux communautés.
Le projet a renforcé les capacités locales. Cependant, une stratégie de durabilité à long terme est toujours en cours de développement afin de s'assurer qu'une fois le projet terminé, le centre de prévision régional reste opérationnel. Ceci est facilité par un accord avec IDEAM pour la maintenance des stations qui ont été investies ainsi que par l'existence d'institutions d'apprentissage dans la région et d'autorités environnementales fortes.
Ressources
Écosystèmes agricoles résistants au climat et soutien à la vulgarisation
Ce module fournit des services de vulgarisation agricole pour soutenir la gestion efficace de l'eau et la recherche et les capacités en matière d'agriculture intelligente face au climat au niveau communautaire. Il se concentre sur la promotion de cultures agro-diverses et locales résistantes au climat et sur la mise en œuvre de pratiques productives adaptées au climat afin d'améliorer les moyens de subsistance des populations rurales qui sont adaptées aux projections climatiques en matière de sécheresse et d'inondation. Ces systèmes de production agro-diversifiés valorisent la biodiversité locale et sont compatibles avec les systèmes de zones humides, ce qui permet de sauver et de favoriser les cultures traditionnelles qui avaient été perdues à cause de la monoculture et qui ont prouvé qu'elles résistaient mieux aux stress climatiques.
Les ménages reçoivent des kits de jardinage et de gestion de l'eau comprenant des semences (fournies par des banques de semences locales gérées par des femmes), du paillis et d'autres intrants. Une formation est dispensée sur la manière de mettre en place ces systèmes, notamment en utilisant des technologies d'irrigation peu coûteuses et en surélevant les planches de culture. Le soutien de la vulgarisation rurale permet aux ménages d'apprendre par la pratique grâce à l'expérimentation dans le cadre d'une approche d'école paysanne de terrain. Cela a permis de récupérer et de systématiser les connaissances locales tout en créant des partenariats avec les institutions de recherche locales. Ces jardins familiaux ont renforcé la sécurité alimentaire face au COVID et aux récentes inondations.
Facteurs favorables
L'expérience acquise dans le cadre d'un projet antérieur financé par le Fonds d'adaptation dans la région a servi de base à la montée en puissance du projet, notamment à la création de banques de semences locales gérées par des femmes. L'existence d'institutions de recherche et de centres d'apprentissage locaux s'est également avérée inestimable pour garantir que les connaissances restent locales et que l'aide à la vulgarisation soit pertinente et tienne compte de la culture et des circonstances locales. Le partenariat avec les institutions indigènes a également été une source essentielle de connaissances.
Leçon apprise
Le soutien à la vulgarisation rurale et le renforcement des capacités sont des facteurs essentiels dans la mise en œuvre de projets complexes visant à créer un changement de paradigme dans la gestion des risques climatiques. Ce volet a permis au projet de mieux comprendre les besoins et l'intérêt des communautés pour l'amélioration de la résilience. Plus important encore, il a permis au projet de fournir des résultats tangibles aux communautés qui ont démontré leur importance lorsque la région a été confrontée à de récentes inondations. Ces solutions se sont en fait avérées résistantes aux problèmes d'inondation car elles ont été conçues en tenant compte des extrêmes climatiques et en utilisant la modélisation hydrologique.
Cette composante a également bénéficié d'une collaboration avec les parties responsables locales pour s'assurer que les systèmes de production agricole diversifiés sont en fait compatibles avec les écosystèmes et créent une relation positive avec les zones humides. En outre, en travaillant avec les banques de semences locales, le projet a pu soutenir les économies locales et les moyens de subsistance compatibles avec les écosystèmes. Le rôle des instituts de recherche locaux a été précieux, permettant à l'information et à l'innovation de rester dans la région.
Impacts
Le projet financé par le Fonds vert pour le climat a déjà eu et aura d'autres effets grâce à son approche de l'adaptation basée sur les communautés et les écosystèmes. À ce jour, le projet a renforcé les capacités de prévision locale tout en fournissant des informations climatiques par le biais d'alertes et de bulletins agricoles. Il a collaboré avec les communautés autochtones pour mettre au point un module de formation à la vulgarisation rurale avec le soutien d'universités autochtones. Les investissements du projet ont permis de fournir des kits de jardinage et des formations pour créer des jardins familiaux diversifiés et des systèmes de collecte des eaux de pluie, tout en améliorant la capacité de gestion de l'eau et le renforcement institutionnel des commissions locales de l'eau. Ces investissements initiaux ont permis aux communautés de mieux gérer la pandémie de COVID ainsi que les récentes inondations.
À terme, 40 000 hectares de zones humides seront restaurés grâce à l'approche des paysages productifs, tandis que 203 918 personnes bénéficieront directement de cette intervention grâce à un meilleur accès à l'approvisionnement en eau, à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des moyens de subsistance. 201 707 personnes bénéficieront indirectement des alertes précoces. Les impacts incluront des opportunités économiques pour les personnes résidant dans les zones de restauration grâce à des options et des pratiques de subsistance adaptées ; une recherche localement appropriée sur les techniques productives adaptatives face au changement climatique pour les moyens et petits producteurs (ménages).
Bénéficiaires
203 918 personnes bénéficient directement de l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Parmi les bénéficiaires indirects, 201 707 personnes bénéficient des alertes précoces. Une attention particulière a été accordée aux femmes et aux populations autochtones.
Objectifs de développement durable
Histoire

Luz Mary Ordoñez ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'elle a appris par un bulletin d'information les mesures prises par le gouvernement colombien pour faire face à la crise du COVID-19. Elle a été frappée par la peur de l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Luz Mary. Pour de nombreuses communautés comme Las Palmas, où vit Luz Mary, l'avenir est incertain depuis des années, passant d'inondations extrêmes à une crise de l'eau profonde résultant d'événements extrêmes.
L'une des stratégies promues par le projet est la mise en œuvre d'agroécosystèmes biodiversifiés afin d'atténuer le changement climatique dans cette région. L'approche des agroécosystèmes biodiversifiés intègre une utilisation variée et durable des cultures et incorpore la gestion des risques face aux événements climatiques défavorables, dans le but de garantir l'approvisionnement alimentaire des familles tout au long de l'année. Aujourd'hui, les approches agro-écosystémiques adaptées au changement climatique réduisent les impacts du COVID-19 sur les communautés de La Mojana.
Grâce aux pratiques agricoles résistantes au climat et à l'augmentation de la production, elles disposeront d'aliments sains et nutritifs pour les mois à venir, ainsi que de fonds d'urgence supplémentaires provenant des excédents de production vendus sur les marchés locaux. Ces mesures de soutien contribueront également à protéger ces communautés contre les chocs provoqués par des tempêtes et des inondations de plus en plus intenses. Ainsi, lorsque d'autres crises surviendront, les familles de La Mojana ne seront pas obligées de migrer ou de perdre leurs fermes et leurs moyens de subsistance.
"Grâce à ce projet, j'ai appris beaucoup de choses. L'une d'entre elles est de savoir comment prendre soin de l'agroécosystème. Cela a eu un impact sur ma vie, et grâce à cela, j'ai redécouvert mon amour pour la nature. Aujourd'hui, nous avons reçu le matériel et les fournitures, et la plupart d'entre nous ne savaient pas quoi faire pendant cette quarantaine, mais nous allons maintenant profiter du fait que nous sommes à la maison et que nous travaillons dans l'agroécosystème communautaire pour nous préparer à l'hiver, ce qui nous aide beaucoup et maintient l'unité de la famille. Nous allons planter nos légumes et nos cultures, en plus d'utiliser le réservoir d'eau dont nous avons tant besoin pendant cette sécheresse, et nous sommes profondément déterminés à aller de l'avant et à surmonter cette épreuve."
Article complet : https://undp-climate.exposure.co/gcf-mojana