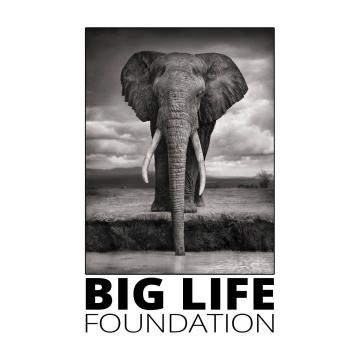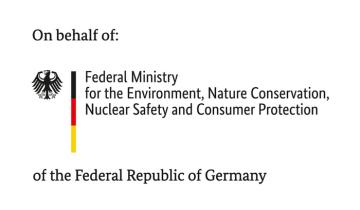Mise en œuvre de la RPF dans des systèmes couplés avec la faune sauvage à l'aide de techniques de régénération naturelle gérée par le pastoralisme (RNGP)
Le paysage de l'est du Kilimandjaro au Kenya, qui couvre le sous-comté de Kajiado South (environ 6 411 km²), comprend divers écosystèmes, y compris des terres de parcours souffrant d'une grave dégradation. Pour lutter contre cette dégradation, un projet de restauration des paysages forestiers, soutenu par le WWF et d'autres partenaires, impliquant des groupes communautaires tels que l'ALOCA (Amboseli Land Owners Conservation Association) a été mis en place. Le projet se concentre sur les pratiques d'utilisation durable des terres et les techniques de restauration afin de protéger les corridors de faune et de flore, de promouvoir les pratiques culturelles pastorales des Masaïs et de créer des moyens de subsistance. Les méthodes de restauration comprennent la gestion des pâturages, le rajeunissement des arbres, le captage des eaux de pluie et la mise en réserve de semences d'herbe. Les principaux acteurs sont l'ALOCA (Amboseli Land Owners Association), la Big Life Foundation, Justdiggit et le WWF.
Contexte
Défis à relever
Le projet AREECA s'attaque à la dégradation environnementale des habitats et, en particulier, au surstockage, à l'érosion et à la variabilité du climat dans les pâturages. Sur le plan social, il encourage les communautés indigènes, et en particulier les Massai, à utiliser les terres de manière durable et à préserver leur culture. Sur le plan économique, il vise à créer de nouveaux moyens de subsistance grâce au tourisme et à des pratiques de gestion durable des pâturages, telles que la mise en réserve de l'herbe.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Les cinq éléments constitutifs sont interconnectés grâce à une approche adaptative centrée sur la communauté qui garantit que chaque élément s'appuie sur le précédent pour obtenir des résultats durables. L'identification d'un partenaire de confiance, ALOCA, sert de base, en s'appuyant sur la crédibilité locale pour impliquer les parties prenantes. Des réunions communautaires (barazas) suivent, facilitant des discussions ouvertes qui alignent les priorités des propriétaires fonciers sur les objectifs du projet, créant ainsi une base participative pour les actions à venir. Cela conduit à la désignation et à la délimitation communes des sites de restauration, renforçant ainsi les accords sur l'utilisation des terres qui préviennent les conflits et permettent des interventions ciblées. La sensibilisation aux avantages de la restauration, en particulier pour les femmes et les jeunes, élargit ensuite l'engagement de la communauté en intégrant les incitations économiques et l'autonomisation sociale dans les objectifs environnementaux. Enfin, le cadre de suivi et de compte rendu permet aux participants locaux de suivre les progrès, d'adapter les méthodes et de documenter les réussites. Ensemble, ces éléments créent un cycle de confiance, de transparence et de responsabilité qui se renforce de lui-même, ce qui permet au projet d'avoir un impact écologique et social durable.
Blocs de construction
Identification d'une organisation communautaire appropriée (ALOCA)
La sélection d'une organisation communautaire de confiance était essentielle pour impliquer les communautés locales dans la restauration des pâturages. L'ALOCA (Amboseli Land Owners Conservation Association) a été choisie en raison de son double objectif de protection des couloirs de circulation de la faune et de promotion du patrimoine culturel masaï. Depuis sa création en 2008, l'ALOCA a travaillé en étroite collaboration avec les communautés Maasai à Amboseli, créant des plans de gestion durable des terres et mettant en œuvre des pratiques de pâturage indigènes qui reflètent les schémas d'utilisation saisonnière des terres des Maasai. L'expérience et la crédibilité de l'ALOCA auprès des propriétaires terriens locaux en ont fait un partenaire idéal pour diriger les efforts de restauration, établir une communication entre les parties prenantes et promouvoir l'utilisation durable des pâturages. La zone est essentielle à la conservation de la faune et de la flore, car elle constitue un corridor faunique.
Facteurs favorables
- Confiance de la communauté et présence établie: ALOCA est détenue et gérée par les communautés Maasai, ce qui constitue une base de confiance, facilitant la mobilisation du soutien pour de nouvelles initiatives de restauration.
- Soutien des parties prenantes: Initialement soutenue par l'African Wildlife Foundation, puis par la Big Life Foundation, l'ALOCA a bénéficié de la stabilité et de l'accès aux ressources nécessaires à la réussite à long terme du projet.
- Gouvernance et structure: Avec un conseil d'administration de 27 membres et des réunions régulières, l'ALOCA a fourni une approche structurée de la prise de décision, permettant des réponses rapides aux défis et le maintien de la responsabilité.
Leçon apprise
- Valeur des partenariats établis: La collaboration avec une organisation communautaire de confiance accélère le processus d'obtention du soutien et de la confiance au niveau local, ce qui est essentiel pour la mise en œuvre durable d'un projet.
- La gouvernance communautaire renforce l'appropriation du projet: L'autonomisation des structures de gouvernance locales, telles que le conseil d'administration de l'ALOCA, favorise le sentiment d'appartenance à la communauté, ce qui augmente la probabilité de durabilité du projet et la volonté d'intensifier les efforts de restauration à l'avenir.
- L'importance du soutien financier pour la longévité: L'obtention d'un soutien financier constant (par exemple, les baux de conservation couverts par la Big Life Foundation) est essentielle pour maintenir les engagements en cours et garantir que les organisations communautaires puissent soutenir leurs efforts à long terme.
Organisation de réunions communautaires avec les propriétaires fonciers (Barazas locales)
Les réunions communautaires, ou barazas, ont constitué la principale plateforme d'engagement avec les propriétaires terriens pour discuter et s'aligner sur les interventions de restauration proposées sur 150 hectares de terres de parcours. Ces réunions ont été conçues comme des sessions participatives au cours desquelles les propriétaires terriens Maasai locaux ont pu exprimer leurs préoccupations, poser des questions et obtenir des éclaircissements sur l'impact du projet sur l'utilisation de leurs terres. Les barazas ont contribué à favoriser une communication transparente entre les responsables de la mise en œuvre du projet et les parties prenantes locales, ce qui a permis de mettre en place un processus décisionnel inclusif respectant les traditions masaï et la dynamique de la communauté.
Facteurs favorables
- Méthodes d'engagement respectueuses de la culture: L'organisation de barazas, un format de réunion communautaire traditionnel, a permis aux responsables du projet d'aborder les discussions d'une manière culturellement appropriée.
- Représentation et inclusion : L'inclusion des propriétaires fonciers et des représentants de la communauté a permis d'entendre des points de vue divers et de faire en sorte que les décisions reflètent les priorités de la communauté.
- Cohérence et suivi : Des réunions régulières ont permis un dialogue et un retour d'information continus, renforçant ainsi la confiance et la capacité d'adaptation pour répondre à toute nouvelle préoccupation au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Leçon apprise
- La transparence renforce la confiance: Des discussions ouvertes et transparentes dans les barazas ont permis de démystifier les objectifs du projet, de renforcer la confiance et de minimiser la résistance des membres de la communauté.
- L'appropriation par la communauté conduit à un meilleur alignement: Lorsque les propriétaires fonciers sont activement impliqués dans le processus décisionnel, ils sont plus enclins à soutenir le projet et à y participer, en veillant à ce que les interventions soient conformes à leurs priorités en matière d'utilisation des terres.
- Le retour d'information itératif est essentiel: La nature régulière des barazas a permis un retour d'information continu, permettant au projet d'être réactif et de s'adapter aux besoins locaux et à l'évolution des défis.
Accord sur la désignation et la délimitation des sites de restauration
Pour garantir une restauration efficace, les chefs de projet ont travaillé avec la communauté pour désigner et délimiter physiquement des zones d'intervention spécifiques. Il s'agissait notamment de cartographier le paysage afin d'identifier les zones prioritaires pour la restauration des pâturages, de répondre aux préoccupations concernant la propriété des terres et de veiller à ce que la communauté s'accorde sur l'emplacement des limites. Le processus de désignation en collaboration a permis de conclure des accords clairs sur la manière dont les terres seraient utilisées, tandis que les marqueurs physiques ont aidé à prévenir les conflits futurs sur l'utilisation des terres et à maintenir les zones de restauration.
Facteurs favorables
- Identification et planification dessites à l'initiative de la communauté : La participation de la communauté à des exercices de cartographie a favorisé une compréhension commune du paysage et a permis de hiérarchiser les zones nécessitant une intervention urgente.
- Marquage clair des limites : Le marquage physique des limites (par exemple, au moyen de clôtures ou de marqueurs naturels) et les patrouilles frontalières effectuées par les éclaireurs de la communauté ont fourni des indicateurs clairs et visibles des zones de restauration désignées, réduisant ainsi les malentendus sur l'utilisation des terres.
- Processus de recherche de consensus: L'obtention d'accords à l'échelle de la communauté sur la désignation des sites a renforcé l'engagement local en faveur du respect et de la protection de ces zones.
Leçon apprise
- Des limites claires évitent les conflits: Des limites physiquement marquées réduisent les conflits potentiels sur l'utilisation des terres, garantissant que les zones de restauration restent protégées.
- La contribution locale améliore la pertinence et l'adéquation: L'implication de la communauté dans la sélection des sites augmente la pertinence, car les connaissances locales permettent d'identifier les zones qui sont à la fois écologiquement précieuses et socialement acceptables pour la restauration.
- L'appropriation par le biais d'une prise de décision partagée: L'implication de la communauté dans la désignation des limites favorise le sentiment d'appartenance, ce qui accroît l'engagement à maintenir et à protéger ces sites de restauration.
Sensibilisation à la restauration et aux moyens de subsistance pour les femmes et les jeunes Maasai
Le projet comprenait des campagnes de sensibilisation pour éduquer la communauté Maasai aux pratiques d'utilisation durable des terres et à l'importance de la restauration de l'écosystème. Des opportunités spécifiques, telles que les banques de semences d'herbe, ont été introduites afin de fournir des avantages économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes. Ces campagnes visaient à modifier la perception de la gestion des terres de parcours, en passant d'un simple pâturage de subsistance à une approche multi-bénéfices, combinant la santé écologique et l'autonomisation économique des membres marginalisés de la communauté. L'apprentissage par la pratique au sein de la communauté a permis de développer des compétences en matière de restauration parmi les membres, faisant ainsi de la communauté des champions de la restauration sur leurs propres terres.
Facteurs favorables
- Une communication sensible à la culture: Le recours à des dirigeants communautaires respectés et à des réseaux existants a permis à la campagne d'entrer en résonance avec les valeurs et les traditions locales.
- Avantages directs pour les moyens de subsistance: L'offre d'incitations économiques tangibles, telles que des banques de semences d'herbe, a rendu les efforts de restauration plus attrayants en montrant des avantages immédiats.
- Partenariats de soutien pour la mise en œuvre : La présence du WWF, de la Big Life Foundation, de Justdiggit et d'ALOCA dans les efforts de sensibilisation a apporté de la crédibilité et de l'expertise technique, ce qui a facilité l'acceptation générale.
Leçon apprise
- Les incitations économiques encouragent la participation: Le fait d'offrir des moyens de subsistance (par exemple, par le biais de banques de semences d'herbes) renforce l'engagement de la communauté et montre que la restauration a une valeur à la fois écologique et économique.
- La sensibilisation est essentielle au changement de comportement: Les projets de restauration réussissent lorsque les communautés en comprennent et en apprécient les avantages, ce qui souligne la nécessité de diffuser des messages clairs et cohérents.
- L'autonomisation des femmes et des jeunes a un impact plus large : Le fait de cibler des groupes marginalisés tels que les femmes et les jeunes permet non seulement d'améliorer l'inclusion, mais aussi d'étendre la portée et la durabilité du projet grâce à un engagement diversifié. 90 % des travaux de restauration ont été entrepris par des femmes et des jeunes.
Ressources
Suivi et rapport sur les progrès de la restauration
Un cadre structuré de suivi et d'établissement de rapports a été mis en place pour suivre les progrès de chaque méthode de restauration et évaluer les résultats. Ce cadre prévoyait la collecte régulière de données et l'établissement de rapports par des membres de la communauté formés à cet effet, qui se sont vu confier des tâches spécifiques afin de s'assurer que les objectifs écologiques et sociaux du projet étaient atteints. En contrôlant l'efficacité de chaque intervention (par exemple, le contrôle de l'érosion du sol, la croissance de la végétation), le projet a pu adapter les techniques en fonction des besoins et documenter les meilleures pratiques en vue d'une expansion future.
Facteurs favorables
- Formation de la communauté et renforcement des capacités : la formation des résidents locaux aux techniques de suivi a permis à la communauté d'assumer la responsabilité de la réussite du projet.
- Collecte régulière de données et établissement de rapports: La collecte régulière de données a permis d'obtenir des informations en temps réel, ce qui a permis de procéder à des ajustements en temps voulu pour améliorer les résultats de la restauration.
- Processus d'évaluation collaboratifs: L'implication de la communauté dans l'évaluation a favorisé la transparence, garantissant que les résultats du suivi étaient partagés et compris par toutes les parties prenantes.
Leçon apprise
Le renforcement des connaissances et des capacités est essentiel pour la compréhension et l'appropriation !
Impacts
Le projet a permis de restaurer 2 273 hectares de pâturages dégradés, de sécuriser les corridors de la faune sauvage en améliorant l'état de l'habitat et de soutenir les moyens de subsistance des Maasai basés sur l'élevage grâce à des pratiques durables telles que la mise en réserve de semences d'herbe. En protégeant les écosystèmes clés, le projet a un impact positif sur la biodiversité, favorise les avantages économiques grâce au tourisme et encourage la résilience sociale au sein des communautés masaï. Les impacts spécifiques comprennent la réduction de l'érosion des sols, la promotion des connaissances indigènes en matière de gestion des terres et le soutien à la gestion durable des pâturages pour le bénéfice des populations et de la faune.
Bénéficiaires
Les membres de la communauté masaï, notamment les femmes et les jeunes, bénéficient de meilleures pratiques d'utilisation des terres, de moyens de subsistance et d'une restauration de l'environnement qui protège leur mode de vie pastoral et la faune sauvage, base de l'écotourisme dans la région.