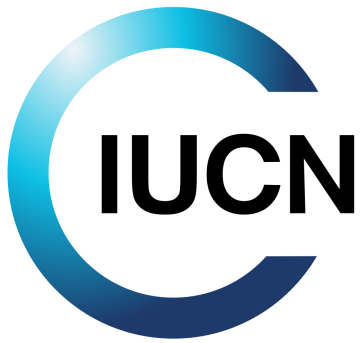
Lutter contre la dégradation des ressources pour renforcer la résistance au changement climatique

La réserve de biosphère du delta du Saloum, au Sénégal, connaît une tendance à la dégradation des ressources végétales. L'utilisation de bois de chauffage, l'empiètement agricole et la salinisation des terres augmentent la vulnérabilité des populations aux effets néfastes du changement climatique (sécheresse et inondations). Le projet EPIC (Ecosystems Protecting Infrastructure and Communities) de l'UICN utilise les connaissances locales pour reboiser les zones, restaurer les terres dégradées et réguler l'utilisation des ressources naturelles dans la zone protégée.
Contexte
Défis à relever
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Blocs de construction
Conception d'étapes participatives pour l'engagement des villages
Facteurs favorables
Leçon apprise
Renforcement des capacités des acteurs locaux
Facteurs favorables
Leçon apprise
Documentation des stratégies et évaluation des succès
Facteurs favorables
Leçon apprise
Création d'outils de sensibilisation et d'influence politique
Facteurs favorables
Leçon apprise
Facilitation des moyens de subsistance et de la diversification économique
Facteurs favorables
Leçon apprise
Impacts
L'EPIC améliore la régénération biologique dans le delta en utilisant les connaissances et les pratiques locales. La technique de "régénération naturelle assistée" a permis de restaurer 130 ha de forêt dans les 6 villages en 2014 afin d'améliorer la qualité des sols. En outre, jusqu'à 180 ha de terres sont en train d'être restaurés grâce à un processus participatif par la construction de 59 digues anti-sel avec des matériaux locaux. Cela permettra, d'une part, d'éliminer la cause de la salinité et, d'autre part, de retenir l'eau douce, ce qui améliorera la fertilité des sols et augmentera les rendements d'environ 40 %. En 2014, une centaine de parties prenantes ont été formées à la "régénération naturelle assistée" et aux techniques de digues anti-salines, ainsi qu'à la création et à l'entretien de pépinières. D'autres effets sont attendus à l'avenir, car les approches participatives de restauration de l'aire protégée renforcent les connaissances et les capacités d'adaptation des communautés rurales. Elles favorisent également l'obtention d'un large éventail d'avantages connexes, ce qui accroît le rapport coût-efficacité des activités. Au total, près de 20 000 agriculteurs, maraîchers, éleveurs et pêcheurs seront touchés par les activités du projet, soit près de 70 % de la population totale de la municipalité de Djilor.

