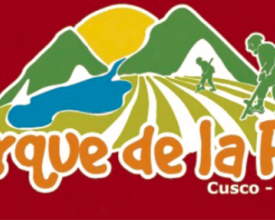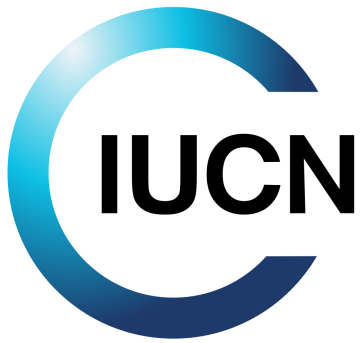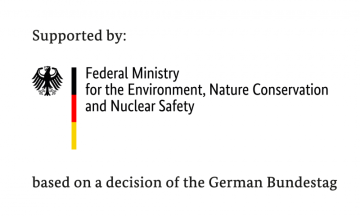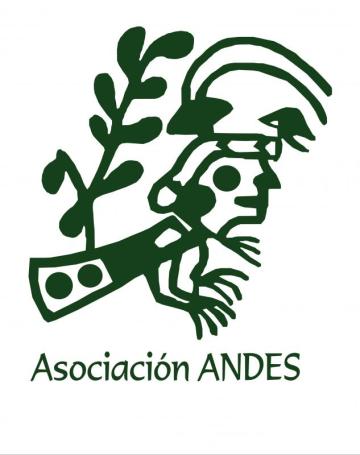
Préservation bioculturelle, innovation et partage des bénéfices pour la résilience au changement climatique

Dans le cadre de ce projet, ANDES (Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible) a apporté son soutien aux communautés de la région montagneuse de Cusco, au Pérou, pour la création et la gestion d'un parc de la pomme de terre, où les communautés peuvent s'engager dans le patrimoine bioculturel, le préserver et en tirer profit. Les communautés actives dans l'association des communautés du parc de la pomme de terre sont aidées à préserver les espèces végétales indigènes et adaptées aux conditions locales et à tirer parti de cette situation par le biais de microentreprises basées sur l'agrobiodiversité. La résilience des communautés face au changement climatique est renforcée sur le plan écologique en maintenant la disponibilité des cultures vivrières adaptées aux conditions locales, sur le plan culturel en ravivant les connaissances traditionnelles et sur le plan social en proposant des activités génératrices de revenus basées sur l'écosystème. Cette solution est publiée dans le cadre du projet "Adaptation basée sur les écosystèmes : renforcer les preuves et informer les politiques", coordonné par l'IIED, l'UICN et le WCMC de l'ONU Environnement.
Contexte
Défis à relever
Le changement climatique a entraîné des conditions météorologiques irrégulières, une augmentation des températures et des pluies tardives et imprévisibles. Dans la région du Parc de la pomme de terre, cela a réduit à la fois le nombre de variétés de pommes de terre qui peuvent être cultivées et le rendement de celles qui le sont. Les parasites et les maladies ont augmenté. Cette situation exerce une pression sur des communautés déjà confrontées à l'insécurité alimentaire, à une vulgarisation agricole médiocre et à un accès limité à la formation et aux services financiers. Plus généralement, l'extraction et l'agriculture industrielle dans la région mettent à rude épreuve sa biodiversité et sa culture.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Le BBI comprend le Parc de la pomme de terre, qui est un territoire de sauvegarde du patrimoine bioculturel. Il crée un espace pour la préservation de la diversité génétique et des variétés de cultures résistantes, ce qui permet de protéger les communautés contre le risque de mauvaises récoltes dues à la sécheresse, au gel et aux maladies. Le parc de la pomme de terre est un espace où BBII, une marque collective informelle pour les innovations bioculturelles telles que les produits alimentaires et les produits de beauté, peut s'épanouir. À son tour, le BBII agit comme un pilier de soutien pour le BBI, en fournissant une incitation et un élan pour la protection durable de l'agrobiodiversité locale. Une marque commerciale axée sur le parc de la pomme de terre constitue un point central autour duquel les communautés peuvent se rassembler, ce qui favorise la cohésion sociale et contribue également à renforcer la résilience face aux défis plus vastes posés par le changement climatique. Ainsi, les deux éléments constitutifs de cette solution se renforcent mutuellement, ce qui permet de maintenir les avantages écologiques et sociaux offerts par la solution complète.
Blocs de construction
Parc de la pomme de terre pour une adaptation fondée sur les écosystèmes grâce à la conservation de la biodiversité (et à la sauvegarde du patrimoine bioculturel)
Le parc de la pomme de terre est un territoire du patrimoine bioculturel, conçu et géré collectivement par les communautés qui vivent autour de lui. Créé en 2002 par six communautés quechua (dont cinq sont encore actives), le parc lui-même compte plus de 650 variétés selon la classification scientifique occidentale (ou plus de 1 300 selon la classification traditionnelle), ainsi que d'autres cultures andines. Il existe 18 variétés de pommes de terre résistantes à la sécheresse et au gel, ainsi qu'une variété tolérante aux virus. Le parc fait donc office de réserve génétique et de dépôt d'outils de résistance au changement climatique.
Le parc est géré sur le modèle du système traditionnel de l'aylluvalue, qui vise à protéger l'indivisibilité et l'interconnexion de l'agrobiodiversité au sein du parc. L'organe directeur, l'Association des communautés du parc de la pomme de terre, détient le titre foncier communal pour le territoire. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont défini la structure et le fonctionnement de l'association, avec le soutien de l'ANDES, et elle comprend des représentants des dirigeants de chacune des cinq communautés qui couvrent le parc. L'association permet aux communautés de conclure des accords juridiques et de négocier efficacement en tant que groupe en ce qui concerne les innovations ou les micro-entreprises associées au parc, telles que les produits de beauté ou les produits alimentaires.
Facteurs favorables
- Un accord de rapatriement conclu avec le Centre international de la pomme de terre a permis de restituer à la région 410 variétés de pommes de terre adaptées aux conditions locales.
- La mise en commun des terres facilite l'expérimentation, ce qui est d'autant plus important que le changement climatique modifie les conditions de culture, par exemple en repoussant la ligne de plantation inférieure pour les pommes de terre, et que les agriculteurs doivent s'adapter.
- Pour soutenir le parc, un groupe de gardiens des semences a été créé et formé à la production de semences botaniques, aux transects et à la multiplication.
Leçon apprise
- Le recours à la recherche-action participative pour soutenir la conception et la gestion du parc a été essentiel à son succès et a facilité le développement, par exemple, d'accords équitables de partage des bénéfices, fondés sur le droit coutumier, qui sous-tendent l'innovation bioculturelle associée au parc.
- En restaurant et en préservant le patrimoine bioculturel de cette région, le parc de la pomme de terre réduit la vulnérabilité aux phénomènes météorologiques défavorables et aux maladies, favorisant ainsi la résilience face aux défis du changement climatique. Le soutien à l'agrobiodiversité locale contribue également au maintien des services écosystémiques.
Ressources
Marquage informel et partage équitable des avantages
Le système informel de marque collective a été développé conjointement par les communautés du Parc de la pomme de terre (représentées par l'Association des communautés du Parc de la pomme de terre) et l'ANDES, grâce à un processus conjoint comprenant plusieurs réunions communautaires animées par des chercheurs de l'ANDES. La marque collective informelle permet aux micro-entreprises et à l'innovation bioculturelle dans la région du parc de la pomme de terre de présenter aux autres une identité distincte, basée sur le lieu, regroupant les diverses micro-entreprises opérant sur le territoire et générant une cohésion entre les communautés du parc qui sont autrement assez fragmentées. La marque est la propriété collective du Parc de la pomme de terre et est liée à celui-ci.
Le processus de partage équitable des bénéfices est lié au dépôt de la marque ; 10 % des recettes provenant des produits et services déposés sous la marque - tels que le thé, la nourriture ou les articles de toilette - sont versés dans un fonds commun, avant d'être redistribués aux communautés conformément à l'accord de partage des bénéfices. Ce partage équitable des bénéfices, ainsi que les avantages immatériels que sont la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance, encouragent l'engagement des communautés dans le parc de la pomme de terre et renforcent les capacités locales, ce qui, à son tour, consolide le soutien et la durabilité du parc.
Facteurs favorables
L'accord de partage des bénéfices a été guidé par les lois et les normes coutumières quechua et élaboré sur une période de 2 à 3 ans à l'aide d'un processus participatif approfondi facilité par des chercheurs communautaires. L'accord repose sur les trois principes fondamentaux issus de ce processus : la réciprocité, la dualité et l'équilibre. L'abandon des notions préconçues d'accès et de partage des bénéfices, et l'adoption de ces concepts du point de vue des communautés elles-mêmes, est un point de départ essentiel pour ce type de travail participatif.
Leçon apprise
- Le processus informel de dépôt de marque présente des avantages par rapport au processus formel de dépôt de marque, qui a été tenté mais qui a échoué en raison de certains points d'incommensurabilité entre les réglementations formelles en matière de propriété intellectuelle et les questions et préoccupations autochtones. Par exemple, pour respecter la réglementation officielle en matière de propriété intellectuelle, la marque doit être enregistrée de manière permanente sous un seul nom, ce qui n'était pas compatible avec la rotation des dirigeants de l'organe directeur du parc
- Dans ce cas, l'enregistrement collectif informel de la marque a été considéré comme une alternative appropriée qui avait toujours des impacts positifs, notamment en termes de cohésion sociale, de marketing et de partage des bénéfices. Néanmoins, il est important de noter que la marque informelle est vulnérable à l'appropriation illicite et à l'utilisation abusive, ce qui n'est pas le cas des marques formelles.
Ressources
Impacts
Le Parc de la pomme de terre maintient l'évolution des cultures dans les champs et les paysages des agriculteurs, offrant ainsi un espace pour la génération de nouvelles variations génétiques potentiellement utiles, qui renforcent la capacité des systèmes agricoles et alimentaires locaux à s'adapter au changement. Le maintien d'une grande diversité génétique protège également la production agricole des effets d'une plus grande variabilité climatique et des événements extrêmes, réduisant ainsi la vulnérabilité des communautés aux mauvaises récoltes. En outre, l'approche de recherche-action participative utilisée pour gérer le parc en tant que laboratoire vivant sur le changement climatique a renforcé la capacité locale à mener des recherches et la confiance dans les connaissances traditionnelles, et a renforcé les liens entre les détenteurs de connaissances traditionnelles, les scientifiques et les institutions de recherche dans la coproduction de réponses aux défis liés à l'alimentation, à la nutrition et à la productivité.
Bénéficiaires
Cinq communautés indigènes quechua bénéficient actuellement de cette solution. Les femmes et les membres les plus pauvres de la communauté bénéficient tout particulièrement des activités et du partage des bénéfices associés au système de marque collective.