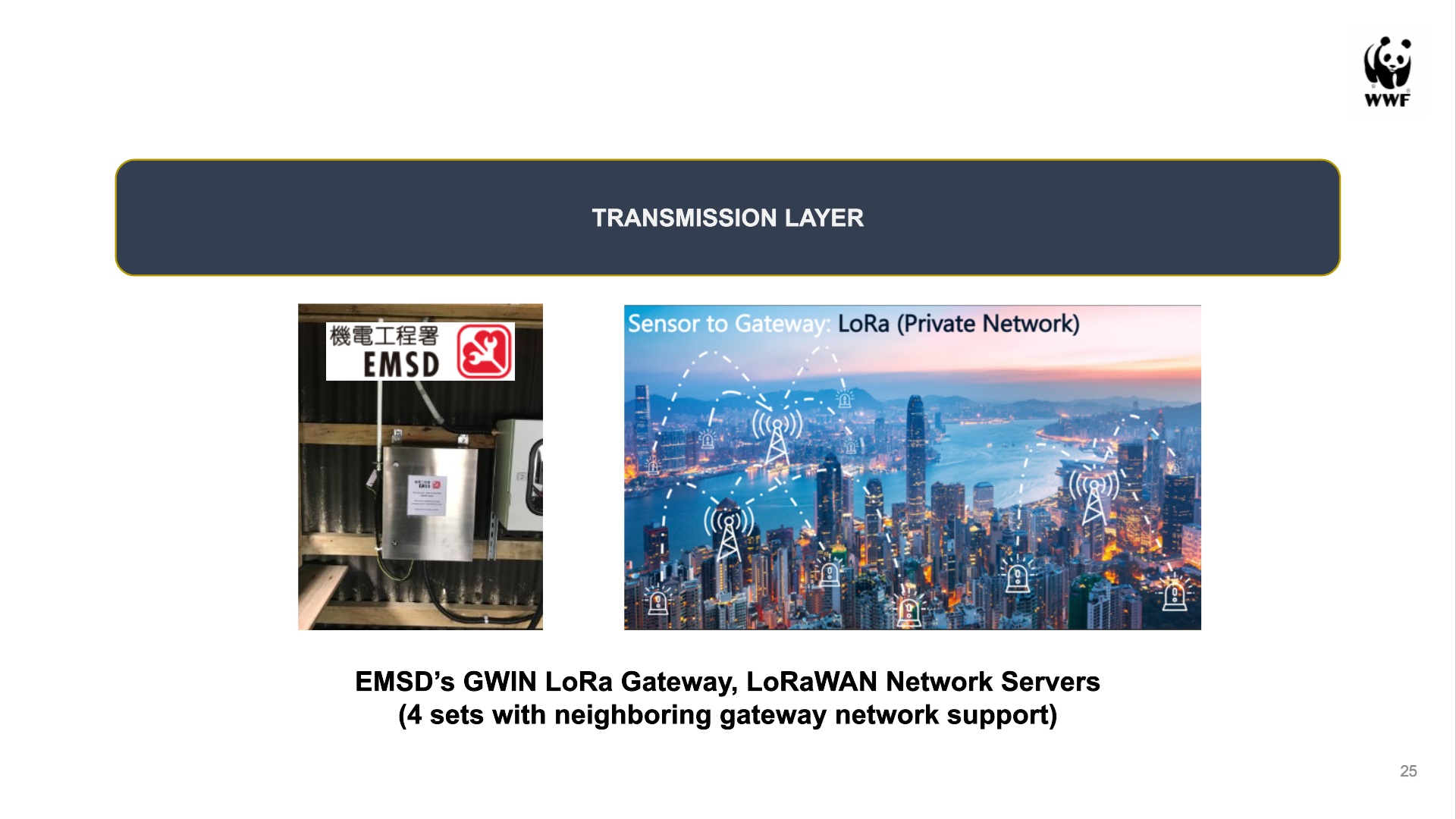Renforcement des capacités locales pour la mise en œuvre et l'extension de la solution
L'initiative GAIA met en œuvre d'importantes mesures de renforcement des capacités à mesure que le système d'alerte précoce développé est mis en pratique avec les parcs et les autorités locales dans de nombreux pays africains tels que la Namibie, le Mozambique et l'Ouganda. Le personnel des parcs, les fonctionnaires des autorités compétentes et des ministères sont formés à la mise en œuvre du système. Il s'agit notamment de donner aux communautés locales les moyens de procéder au marquage, à l'étiquetage et au suivi à l'aide du système GAIA, ainsi que de mettre en œuvre le système d'alerte précoce à l'aide de l'interface désignée.
En outre, le personnel de GAIA forme activement des étudiants dans diverses disciplines et domaines de recherche afin de soutenir les nouvelles technologies pour la conservation et les sciences de la vie. Au cours des six dernières années, plus de 250 étudiants ont participé avec succès aux cours dispensés par le personnel de GAIA à l'Université de Namibie en sciences vétérinaires et en biologie de la faune, avec un accent particulier sur, par exemple, les conflits entre l'homme et la faune, le suivi des animaux ainsi que le comportement des vautours, des lions et des hyènes.
Le renforcement des capacités professionnelles et la formation des étudiants ciblent directement les communautés locales afin de leur permettre de gérer le système d'alerte précoce GAIA en grande partie grâce aux connaissances et aux ressources locales. Ce bloc de construction place l'objectif 20 du GBF "Renforcer le renforcement des capacités, le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique pour la biodiversité" au cœur de l'initiative GAIA, car ce bloc n'est pas un addendum à la partie recherche et développement de l'initiative, mais un domaine d'action clé dès le début.
Le renforcement des capacités et la formation universitaire reposent sur des relations à long terme et sur l'ancrage du personnel de GAIA dans les communautés et organisations locales respectives. En Namibie, en particulier, la collaboration avec les organismes compétents a fait ses preuves depuis 25 ans et GAIA est maintenant en mesure de l'utiliser pour le renforcement des capacités et la formation. En outre, un investissement dans le transfert de technologie et le soutien est nécessaire pour permettre aux partenaires locaux d'adopter et de mettre en œuvre le système.
La mise en œuvre efficace d'une nouvelle approche est une tâche difficile, surtout à long terme. GAIA a intégré la perspective de la mise en œuvre dès le début, mais devait encore mettre l'accent sur l'établissement de routines, de processus et de responsabilités avec les autorités concernées. Sous l'égide de GAIA, le scientifique a lancé un projet de trois ans financé par le ministère allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs. Ce projet favorisera le renforcement des capacités locales et la mise en œuvre et garantira un déploiement durable.