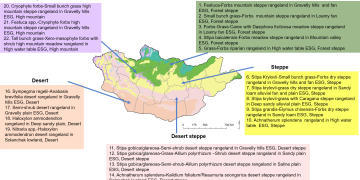La conservation du singe à nez retroussé du Yunnan doit s'appuyer sur trois systèmes fondamentaux : le soutien technique, le réseau de collaboration et le processus de gestion scientifique, afin de relever systématiquement les nouveaux défis tels que la fragmentation de l'habitat, l'interférence humaine et l'insuffisance des capacités de conservation, avec les éléments spécifiques suivants :
I. Soutien technique : innovation dans l'instrumentation et les méthodes scientifiques
1) Modernisation de l'équipement de surveillance
Outils d'observation de haute précision : équipés de monoculaires, de localisateurs GPS, de caméras infrarouges (par exemple, déploiement d'une grille de 1km×1km) et de l'application Patrol Assistant, l'enregistrement en temps réel et l'analyse de la trajectoire des sites d'activité des singes sont réalisés, remplaçant les enregistrements papier traditionnels et améliorant la précision des données (par exemple, réduction de 40% de l'erreur de suivi de la distance quotidienne de déplacement de la population de Longmashan).
équipement d'analyse d'images et de données : des caméras haute définition et un équipement de vision nocturne sont utilisés pour enregistrer le comportement des singes, et le logiciel QGIS analyse l'intensité de l'utilisation de l'habitat pour résoudre le problème de la fragmentation de l'habitat et du suivi dynamique (par exemple, identification des zones d'utilisation principales telles que les trépieds et les huttes de taille).
2) Méthodes de surveillance normalisées
Surveillance de la population et du comportement : méthode d'observation directe (par exemple, compter plus de 190 individus dans la population du mont Longma en 2024), méthode d'échantillonnage par balayage instantané (intervalles de 15 minutes pour enregistrer les comportements alimentaires/mouvements/repos/sociaux), combinée à une ANOVA à sens unique pour tester les différences dans les rythmes comportementaux, afin d'appréhender avec précision la structure de la population (femelles adultes vs. bébés singes 2.10 : 1) et les schémas d'activité (par exemple, singes à double poitrine 2.10 : 1), ainsi que leurs schémas comportementaux. 1) et les schémas d'activité (par exemple, pics d'alimentation bimodaux : 8:00-11:00 et 15:00-18:00).
Étude des facteurs d'alimentation et de menace : enregistrer le comportement alimentaire de 26 espèces de plantes dans 12 familles (par exemple, 67,4 % des roses des pins) et établir une base de données des ressources alimentaires ; enregistrer 96 activités anthropogéniques, telles que le pâturage et la cueillette de champignons, en classant l'intensité des perturbations (niveau 1-3), et clarifier le pic de perturbation en été (intensité de 4,23), afin de fournir une base pour une prévention et un contrôle ciblés.
II. réseau de collaboration : mécanisme synergique de sujets multiples
1. coopération intersectorielle en matière de recherche scientifique
Lien entre le gouvernement et les institutions de recherche scientifique : la zone protégée Yunnan Yunlong Tianchi s'est associée à l'Institut de recherche sur l'Himalaya oriental de l'Université de Dali pour mettre en place une équipe d'experts dont le noyau est Wang Haohan, afin d'effectuer une surveillance à long terme (par exemple, la population de Longmashan a augmenté de 49 % entre 2013 et 2024) et de résoudre les lacunes de la technologie de l'équipe de protection de la base.
Intégration de l'expérience internationale : en se référant aux normes de conservation des primates de l'UICN, introduire l'analyse de l'ADN fécal, le suivi par satellite et d'autres technologies pour améliorer la capacité de recherche sur la diversité génétique des petites populations (par exemple, la population de Tianchi, qui compte environ 20 individus).
2. cogestion communautaire et compensation écologique
Moyens de subsistance alternatifs et conservation participative : réduire les perturbations telles que le pâturage et la coupe de bois de chauffage grâce à l'écocompensation (par exemple, subventions pour l'économie sous-forestière) et aux patrouilles communautaires (formation des villageois pour qu'ils participent à la surveillance des singes), et réduire la fréquence des perturbations anthropogéniques à Longmashan de 15 % d'une année sur l'autre en 2024.
Publicité et éducation en matière de conservation : conférences communautaires pendant la saison estivale de cueillette des champignons afin d'améliorer les connaissances des habitants sur les habitudes alimentaires du singe à nez retroussé de Dian (par exemple, la dépendance à l'égard des œufs de pin) et de réduire le risque de destruction des ressources alimentaires.
III. processus de gestion : stratégie de protection de l'ensemble de la chaîne
1. normalisation des données et suivi à long terme
Collecte de données standardisées : modèles d'enregistrement standardisés (par exemple, sites d'activité des singes, espèces végétales consommées) pour garantir la disponibilité de données valides pendant 42 des 88 jours de suivi ; établissement d'une base de données à trois niveaux "individu-population-habitat", intégrant 26 spécimens de nourriture et la distribution de l'altitude de l'habitat (zone centrale de 3000-3200m). La base de données comprend 26 spécimens de nourriture et la distribution de l'altitude des habitats (zone centrale de 3000-3200 mètres).
mécanisme d'évaluation dynamique : utilisation d'un modèle de croissance de la population (rapport de 1,13:1 entre les individus adultes et juvéniles) pour juger de la capacité de l'habitat, et ajustement de la protection en fonction de l'intensité des perturbations saisonnières (par exemple, renforcement des patrouilles dans la région de Waipangzi en été).
2) Restauration de l'habitat et prévention et contrôle des risques
Construction de corridors d'habitat : en réponse au problème d'isolement de la population de Tianchi (à seulement 0,7 km du village), planifier des corridors entre les parcelles de forêt (par exemple en reliant les zones centrales de 1,24 km² et 1,58 km²) pour atténuer le blocage des échanges génétiques causé par les routes et les villages.
Système de réponse d'urgence : établir un mécanisme pour aider les individus en cas de blessures et de maladies (par exemple, le cas des singes à nez retroussé du Yunnan dans le village de Shangxiao en 2015), et se doter d'un équipement de premiers secours et d'un processus de consultation d'experts afin de réduire le risque de décès accidentel.
3. soutien politique et financier
Soutien juridique et de planification : en vertu de la loi sur la protection des espèces sauvages, le singe à museau court du Yunnan est inscrit sur la liste des espèces protégées au niveau national et inclus dans la ligne rouge de protection écologique ; le gouvernement local alloue des fonds spéciaux pour le déploiement de caméras infrarouges (par exemple, 5 caméras dans la région de Tianchi) et la formation du personnel chargé de la surveillance.
Mécanisme de financement à long terme : intégration des dons d'organisations de protection sociale (par exemple, le "Yunnan Snub-nosed Monkey Conservation Programme" de Tencent Public Welfare) et de projets de coopération internationale pour assurer la durabilité de la construction de la base de données sur les ressources alimentaires et l'indemnisation de la communauté.
En bref
La conservation du singe à nez retroussé de Dian a formé une boucle fermée de "surveillance-recherche-intervention-rétroaction" grâce à la précision de la surveillance permise par la technologie, à la collaboration pour résoudre les conflits humains et à l'efficacité de la gestion garantie par le processus. À l'avenir, il est nécessaire de renforcer la technologie de suivi des populations du sud (par exemple, la population de Tianchi) et d'étendre la couverture de la cogestion communautaire, afin de faire face aux nouveaux défis du changement climatique et du recul de l'habitat, et de promouvoir la transition de la population d'un "rétablissement stable" à une "croissance de haute qualité".
I. Expérience en matière de conservation
1) Système efficace de zones protégées et rétablissement de la population
Construction d'un réseau de zones protégées : grâce à la création de réserves naturelles nationales telles que Yunlong Tianchi, des barrières de protection de l'habitat central ont été formées. La taille de la population de Longmashan est passée de plus de 50 en 1988 à plus de 190 en 2024, avec une augmentation continue au cours des 30 dernières années, et une augmentation de 49 % entre 2011 et 2024. Le rapport entre les femelles adultes et les bébés singes s'est stabilisé à 2,10:1, et la structure de la population est saine.
Découverte d'une nouvelle population et expansion de la distribution : En 2024, une nouvelle "population de Tianchi" d'environ 20 individus a été découverte dans le sud-ouest de la réserve de Tianchi, repoussant la limite sud de la distribution du singe à nez retroussé du Yunnan de 40 kilomètres vers le sud et en faisant la population la plus méridionale, ce qui confirme l'efficacité des mesures de conservation dans l'expansion de la distribution de l'espèce.
2) Suivi scientifique et soutien à la recherche
Application de la technologie : des caméras infrarouges (déploiement d'une grille de 1km×1km), le suivi GPS, l'analyse de l'habitat QGIS et d'autres technologies sont utilisés pour réaliser un suivi précis de la dynamique de la population et de l'utilisation de l'habitat. Les données comportementales ont été enregistrées par la méthode d'échantillonnage par balayage instantané (intervalles de 15 minutes) pour la population de Longmashan afin de clarifier les pics d'alimentation (8:00-11:00 et 15:00-18:00) et les zones d'activité principales (bande d'altitude de 3000-3200 m).
Étude des habitudes alimentaires et de l'habitat : établir une base de données sur les habitudes alimentaires contenant 26 espèces de plantes, confirmant que Pinus sylvestris représente 67,4 % de la composition alimentaire, et cibler la protection de la végétation clé, telle que les forêts de pruches du Yunnan, pour sauvegarder l'approvisionnement en nourriture en hiver.
3) Participation communautaire et prévention et contrôle des perturbations
Modèle de cogestion communautaire : former des patrouilles de villageois pour participer à la surveillance et réduire les perturbations telles que le pâturage et la récolte de champignons grâce à la compensation écologique (par exemple, subventions pour l'économie de la sous-forêt). 2024 La fréquence des perturbations anthropogéniques dans la population de Longmashan diminuera de 15 % d'une année sur l'autre et l'intensité des perturbations en été diminuera de 23 % par rapport à celle de 2015.
Sensibilisation à la conservation : publicité communautaire combinée à des images de caméras infrarouges pour encourager les habitants à mettre en place un système d'inspection des lignes de feu de leur propre initiative afin de réduire l'impact des activités anthropogéniques sur la population de singes.
4) Collaboration interrégionale et garantie des politiques
Lien entre les institutions de recherche scientifique : la réserve de Yunlong Tianchi s'est associée à l'université de Dali et à d'autres universités pour former une équipe d'experts chargée de mener des recherches à long terme sur la génétique des populations et de confirmer la diversité génétique de la population de Tianchi par l'analyse de l'ADN fécal en 2024.
Soutien juridique et de planification : en s'appuyant sur la loi sur la protection des espèces sauvages, le singe à nez retroussé du Yunnan a été inscrit sur la liste des espèces protégées au niveau national et inclus dans la ligne rouge de protection écologique, et le gouvernement local a alloué des fonds spéciaux pour la modernisation des équipements de surveillance (par exemple, cinq caméras infrarouges ont été installées dans la zone de Tianchi).
II. principaux enseignements
1) Menaces de fragmentation et d'isolement des habitats
L'isolement géographique s'est intensifié : les populations existantes sont gravement isolées par les routes et les villages. Les populations de Longmashan et de Tianchi ne sont distantes que de 40 km, mais les échanges génétiques sont impossibles en raison de l'isolement de l'habitat ; la zone d'habitat de la population de Tianchi n'est que de 3,23 km², divisée par des pâturages et des coupe-feu, et le rapport périmètre/surface atteint 14,57, ce qui exacerbe le risque de déclin des petites populations.
Goulot d'étranglement de la capacité environnementale : le rapport entre les individus adultes et juvéniles de la population de Longmashan atteint 1,13:1, proche de la limite supérieure de la capacité environnementale, et le taux de croissance annuel moyen de 2012-2024 est inférieur de 42 % à celui d'avant 2011 ; il est donc nécessaire de renforcer l'expansion des habitats et la construction de corridors.
2) Capacité de surveillance et normalisation des données insuffisantes
Problèmes de qualité des données : des enregistrements de suivi irréguliers n'ont permis d'obtenir que 42 jours de données valides sur 88 jours de travail sur le terrain, et le taux d'exhaustivité des enregistrements des sites d'activité des singes était inférieur à 60 %, ce qui a affecté la précision de l'analyse de la dynamique de la population.
Equipement technique insuffisant : manque de caméras haute définition et d'équipement de vision nocturne pour enregistrer les comportements clés des singes traversant des zones ouvertes ; seules 5 caméras infrarouges ont été installées dans la population de Tianchi, et seuls 2 échantillons fécaux ont été obtenus en 2024, ce qui n'est pas suffisant pour évaluer la taille de la population.
3) Perturbations humaines et conflits de conservation
Les perturbations saisonnières sont importantes : les perturbations anthropogéniques ont entraîné une réduction de 18% du temps consacré à l'alimentation et une augmentation de 27% de la distance quotidienne parcourue par les singes.
Couverture limitée des moyens de subsistance alternatifs : certaines communautés dépendent encore de l'élevage traditionnel et le taux de compensation écologique (subvention annuelle par habitant d'environ 1 200 RMB) est insuffisant pour compenser les pertes économiques.
4) Interface insuffisante entre la recherche scientifique et la conservation
Manque de conseils d'experts : l'accord prévoit 60 jours de conseils d'experts par an, mais dans la pratique, seule la population de Longmashan est couverte, et la population de Tianchi manque d'occasions de suivre les singes en raison d'un manque de formation technique et d'une capacité insuffisante des gardes forestiers à reconnaître les traces.
Les mécanismes de suivi à long terme sont faibles : aucune base de données interannuelle sur la population n'a été établie, et il n'existe pas de modèle d'alerte précoce pour la tendance à long terme du "retrait vers des altitudes plus élevées" du singe à museau court du Yunnan (300 m/décennie de gain d'altitude dans son aire de répartition méridionale), ce qui rend difficile la réponse aux menaces potentielles liées au changement climatique.
La conservation du singe à nez retroussé du Yunnan a permis de rétablir la population grâce à la protection politique, au soutien scientifique et technologique et à la participation de la communauté, mais les problèmes de fragmentation de l'habitat, de capacité de surveillance insuffisante et d'interférence humaine doivent encore être résolus. À l'avenir, nous devrons renforcer la construction de corridors d'habitat, la collecte de données normalisées, la collaboration interrégionale en matière de recherche scientifique et le soutien communautaire aux moyens de subsistance durables, afin de faire face aux défis cumulés du déclin des petites populations et des changements environnementaux.