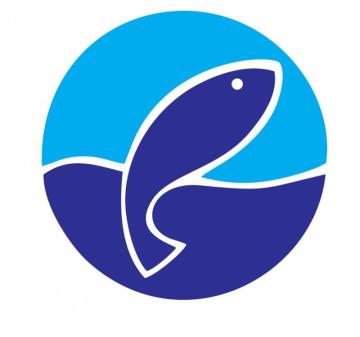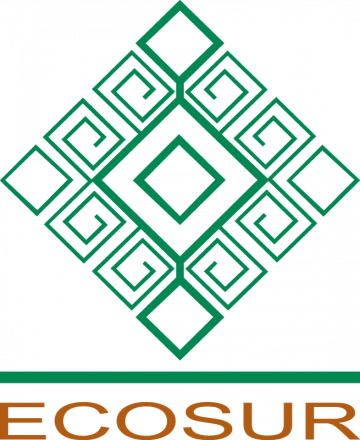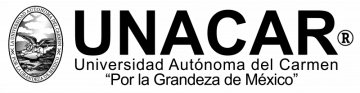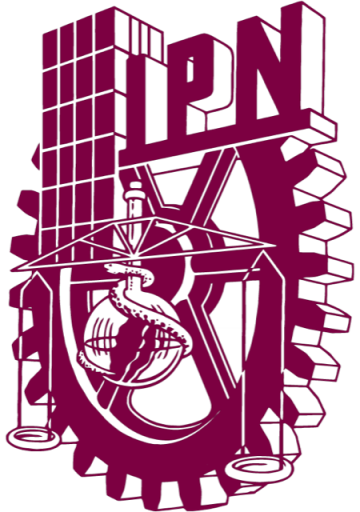Durabilité de la pêche

Au Mexique, la plupart des petites pêcheries qui capturent du poisson ne disposent pas d'une surveillance adéquate de la pêche et de la biologie. Cela entraîne des lacunes en matière d'information et rend la gestion difficile. Cela complique également la reconnaissance de ces pêcheries par les normes internationales, ainsi que l'existence d'avantages sociaux et économiques pour les pêcheurs et les pêcheuses. Afin de parvenir à une pêche durable des poissons (à l'exclusion des requins et des raies) au Mexique, les acteurs impliqués dans cette pêche se sont réunis, dans le cadre d'un système de cogestion et de cofinancement qui intègre l'égalité des sexes, pour établir un système de surveillance de la pêche qui fournit des informations permettant d'apporter des améliorations à la pêche et à sa gestion. Les femmes et les pêcheurs sont ainsi devenus des pionniers en matière de durabilité de la pêche, donnant l'exemple à de nombreux autres pêcheurs.
Contexte
Défis à relever
1. Amener les pêcheurs et les pêcheuses à s'engager et à accepter de commencer à mettre en œuvre différentes stratégies pour améliorer la gestion de leurs pêcheries.
2. Adapter le processus de mise en œuvre à chaque communauté de pêche afin que les pêcheurs et les pêcheuses intègrent les connaissances traditionnelles dans les différentes stratégies.
3. La difficulté d'obtenir une reconnaissance officielle des bonnes pratiques et des accords communautaires informels en matière de gestion de la pêche.
4. Étant donné que différentes espèces de poissons sont capturées dans cette pêcherie, des efforts doivent être faits pour enregistrer des informations biologiques et halieutiques à partir d'un échantillon représentatif de toutes les espèces de la pêcherie.
5. Encourager le co-investissement (par les communautés de pêcheurs, le secteur public, les organisations de la société civile, le monde universitaire et le marché) afin de garantir la durabilité à long terme des ressources.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Les pêcheries artisanales sont confrontées à des défis nationaux et internationaux pour atteindre la durabilité, comme l'ont indiqué respectivement les consultants de Pronatura et du CEA. Au Mexique, l'un de ces défis est le manque d'informations sur les pêcheries. Il est donc difficile d'élaborer des stratégies d'exploitation globales pouvant être mises en œuvre et évaluées par le secteur et qui tiennent compte des pratiques et des connaissances traditionnelles. Pour relever ce défi, l'utilisation de la surveillance des pêches par le biais de journaux de bord a été mise en œuvre. La base des stratégies d'exploitation a été établie de manière participative.
En outre, les pêcheries sont confrontées à des déficiences dans le système de gestion (absence d'objectifs spécifiques pour la ressource exploitée) et à une faible participation des différents acteurs impliqués dans la pêche. Par conséquent, des partenariats entre tous les acteurs impliqués dans la pêche ont été recherchés par le biais de la cogestion et du cofinancement (composantes dépendantes), dans une perspective égalitaire et équitable avec des possibilités de participation pour les hommes et les femmes dans le secteur de la pêche.
Blocs de construction
Produire des informations sur le suivi et l'analyse des pêches pour les poissons
L'un des défis les plus immédiats auxquels sont confrontées les pêcheries sur la voie de la durabilité est la mise en œuvre de la surveillance des pêcheries. Celui-ci rassemble toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la pêche, y compris ses composantes économiques et écologiques, ce qui permet de prendre de meilleures décisions en matière de gestion. Pour y parvenir dans la pêcherie de poisson, les pêcheurs et les pêcheuses ont été formés à l'importance du suivi de leurs pêcheries et à la manière de le réaliser. En collaboration avec les communautés de pêcheurs, le secteur gouvernemental, les universités et les organisations de la société civile, un format de journal de pêche a été conçu et approuvé par le gouvernement.
En 2021, cela faisait quatre ans que les communautés avaient commencé à surveiller leurs pêcheries (en particulier pour différentes espèces de poissons), ce qui leur a permis de tirer des conclusions sur le comportement des pêcheries, de planifier leurs activités, de contrôler leurs revenus, etc.
Facteurs favorables
- Concevoir le journal de bord avec tous les acteurs impliqués dans la pêche (pêcheurs, gouvernement, universités, marché et organisations de la société civile).
- Prévoir une section dans le journal de bord pour enregistrer les longueurs et les poids des poissons capturés.
- Veiller à ce que les pêcheurs disposent de l'équipement nécessaire pour effectuer le suivi de la pêche.
- Former les pêcheurs à la collecte de paramètres (par exemple, la longueur des poissons) pour la surveillance biologique et halieutique.
Leçon apprise
- Il est important de définir la manière dont les pêcheurs enregistreront les journaux. Le processus doit être adapté aux conditions locales (la pêcherie, l'organisation interne de la coopérative et de la communauté) et maintenir une méthodologie standardisée de collecte des données. Il est possible que chaque personne tienne son journal de bord au retour de la pêche ou qu'une seule personne en soit responsable (par exemple, dans la zone de réception des produits).
- En raison des prises accessoires de certaines espèces, il est important que les pêcheurs et les pêcheuses soient formés à la prise de photos et à l'identification des caractéristiques morphologiques et des couleurs des espèces capturées afin de les identifier.
- Les résultats de l'analyse des informations contenues dans les journaux de bord ont été utilisés pour définir des stratégies de gestion, telles que l'augmentation de la taille des mailles des pièges utilisés ou la modification du nombre d'hameçons afin d'éviter la capture d'organismes plus petits.
Ressources
La cogestion dans les pêcheries
Pour parvenir à une pêche durable, il est nécessaire d'impliquer toutes les parties prenantes dans la prise de décision. Elles partagent ainsi les responsabilités et les droits liés à l'utilisation et à la gestion des ressources, à la résolution des conflits et à l'échange de connaissances. C'est ce que l'on appelle la cogestion de la pêche, où les parties prenantes deviennent des alliés et collaborent pour atteindre le même objectif.
Pour ce faire, tous les partenaires potentiels ont d'abord été identifiés : les communautés de pêcheurs, le secteur public, le monde universitaire, les organisations de la société civile et le marché. Ils ont été invités à collaborer et une série de réunions a été organisée avec la participation de tous les acteurs, au cours desquelles le projet, ses objectifs et ses buts ont été définis. Les acteurs ont été invités à participer au projet et à y contribuer en faisant part de leur expérience et de leur domaine de travail. Le tout a été formalisé par la signature d'un protocole d'accord. Aujourd'hui, des réunions semestrielles sont organisées pour présenter les progrès réalisés et fixer les prochains objectifs, en recherchant toujours la transparence et en encourageant la confiance et la participation équitable.
Facteurs favorables
- Impliquer tous les différents acteurs concernés : pêcheurs et pêcheuses, gouvernement, universités, organisations de la société civile et marché.
- Établir les rôles et les responsabilités de chaque acteur impliqué dans le projet afin de créer une atmosphère d'alliance entre tous.
- Organiser des réunions, au moins deux fois par an, pour présenter les progrès réalisés et proposer de nouveaux objectifs.
- Reconnaître et valider les accords de pêche traditionnels et communautaires avec le secteur gouvernemental.
Leçon apprise
- Former les pêcheurs et les pêcheuses aux outils de gestion, aux réglementations, à la biologie des ressources et à l'importance de produire des informations sur leur pêcherie. Connaître les droits et les obligations découlant du droit d'accès aux ressources halieutiques génère un plus grand sens des responsabilités.
- Maintenir une communication efficace avec les parties prenantes afin d'identifier les opportunités et les défis. Cela permet également de maintenir la motivation du groupe à continuer à participer et à s'engager dans le projet.
- Outre les améliorations apportées à la pêche à l'initiative des producteurs, avec le soutien du secteur public, des universités et des organisations de la société civile, ce travail d'équipe a eu des effets positifs sur la structure sociale des communautés, en leur donnant des capacités accrues et améliorées pour prendre leurs décisions.
- Il permet également de transférer les connaissances aux nouvelles générations, d'accroître l'intérêt pour la participation et de générer des informations et des connaissances, tout en favorisant un sentiment d'appropriation de l'écosystème et des ressources.
Ressources
Pêche responsable - stratégies dans deux régions du Mexique
Une stratégie d'exploitation est un ensemble d'outils convenus officiellement ou traditionnellement pour garantir une bonne utilisation de la ressource. Dans la pêche au poisson, il est difficile de définir ces stratégies et d'évaluer si elles fonctionnent ou non, car cette activité implique généralement un grand nombre d'espèces aux caractéristiques biologiques différentes.
Afin d'identifier les stratégies d'exploitation utilisées dans la pêche au poisson, un suivi de la pêche a été mis en place à l'aide de journaux de bord. Ces carnets contiennent des informations sur les captures, l'effort, l'engin de pêche, la taille et le poids des captures. Les informations recueillies dans les journaux de bord sont analysées tous les six mois afin de comprendre la pêche et d'identifier les possibilités d'amélioration. Deux exemples d'améliorations apportées par les communautés de pêcheurs ont consisté à modifier les engins de pêche afin de rendre la pêche plus sélective. Elles ont également décidé d'établir des accords sur la taille minimale des prises pour les espèces de poissons. Ces informations enregistrées par les pêcheurs et les pêcheuses sont partagées avec le secteur gouvernemental afin de disposer de plus d'informations pour connaître l'état des pêcheries et définir des stratégies de gestion durable.
Facteurs favorables
- Intégrer les connaissances empiriques des pêcheurs et des pêcheuses dans l'élaboration des stratégies de capture de référence.
- Générer et partager des connaissances sur la biologie des espèces capturées.
- Soutenir la formalisation des stratégies de capture des communautés de pêcheurs, lorsqu'elles ne sont pas reconnues par le secteur public.
- Assurer la collaboration entre la recherche scientifique et les connaissances traditionnelles afin d'élaborer des stratégies de capture appropriées et de contribuer à leur mise en œuvre.
Leçon apprise
- La mise en œuvre du contrôle des pêches permet d'identifier les possibilités d'amélioration de la pêche et de vérifier si sa mise en œuvre fonctionne bien.
- De légères modifications des engins de pêche, basées sur les connaissances traditionnelles des communautés, peuvent avoir un impact important, à la fois positif et négatif, sur les stocks de poissons et l'écosystème.
- En l'absence d'informations sur le cycle de vie des espèces exploitées, il est nécessaire de générer ces connaissances dans la zone d'exploitation afin d'obtenir des résultats plus solides. En attendant, des mesures de précaution doivent être prises.
- La stratégie d'exploitation peut être adaptée aux facteurs externes (environnementaux, sociaux et économiques).
- Une stratégie de capture réussie, établie par une organisation de pêche et documentée sous la forme d'un accord interne, sert de référence pour l'élaboration d'une stratégie de capture officielle.
Ressources
Reconnaître le rôle des femmes dans le secteur de la pêche
Lorsque nous pensons à la pêche, nous imaginons des espaces où les hommes prédominent et où la seule activité est l'extraction des ressources. Pour avoir une image complète de la pêche, il est important d'inclure les activités post-récolte, pré-récolte et complémentaires, ce qui nous permet de connaître la pêche plus en détail et d'identifier et de reconnaître le travail des pêcheurs et des pêcheuses.
Depuis 2015, COBI participe à la mise en œuvre de projets d'amélioration de la pêche en collaboration avec le secteur productif. En plus des améliorations environnementales, ces projets visent désormais des améliorations sociales, y compris l'égalité des sexes. Au début de ces projets, il a été identifié que le travail effectué par les femmes, n'étant pas un travail d'extraction, n'était pas reconnu comme faisant partie de la pêche, un paradigme que nous parvenons à briser avec des années de travail.
Facteurs favorables
- Reconnaître que la pêche se compose de différentes activités, et pas seulement de la récolte.
- Inclure les femmes dans le processus décisionnel en encourageant et en formalisant leur participation et leur adhésion.
- Mettre en place des formations sensibles à la dimension de genre dans les domaines de la pêche et de la surveillance biologique et océanographique.
- Proposer des postes administratifs et techniques aux femmes formées.
- Les inviter à participer à des forums nationaux et internationaux en tant que représentantes de leurs pêcheries afin de les responsabiliser dans leurs projets et activités.
Leçon apprise
- Les pêcheurs ont reconnu que les femmes ont une grande capacité à se développer à différents stades de la pêche.
- L'autonomisation des femmes pêcheurs en matière de commercialisation, de certification selon les normes internationales, de surveillance de la pêche, océanographique et biologique a été observée et reconnue avec succès.
- La collaboration entre les hommes et les femmes dans le secteur de la pêche a eu des effets positifs et a renforcé les liens entre les membres de la pêcherie, ce qui a été projeté à la communauté.
- Les femmes pêcheurs sont fières de leurs tâches et ont développé un sentiment d'appartenance et d'identification à leur communauté.
- Inclure une perspective de genre dans la pêche n'est pas facile, mais c'est un processus positif qui change la dynamique de la pêche et de ses communautés.
Ressources
Modéliser l'écosystème avec peu de données
De par leur nature, les pêcheries à petite échelle disposent souvent de données limitées, mal systématisées et à court terme. Cette rareté des informations représente un défi pour comprendre, par exemple, l'interaction des engins de pêche avec l'écosystème et leur impact sur l'habitat ; ces informations sont fondamentales pour la mise en œuvre d'un projet d'amélioration de la pêche. Dans le monde entier, différentes méthodologies ont été développées pour générer des informations sur les impacts de la pêche sur l'écosystème ; l'une d'entre elles est la modélisation basée sur le programme Ecopath avec Ecosim.
COBI a utilisé cet outil en incluant des informations générées par les pêcheurs et les pêcheuses à travers les journaux de pêche, ainsi que des informations biologiques et écologiques pour les espèces qui habitent les zones de pêche. En outre, pour renforcer le modèle, les connaissances écologiques traditionnelles des communautés de pêcheurs ont été intégrées par le biais d'entretiens, qui ont permis d'obtenir des informations pertinentes sur le régime alimentaire des espèces, leur répartition géographique, la saison de reproduction et les observations.
Facteurs favorables
- Que les pêcheurs et les pêcheuses génèrent des informations sur les pêcheries par le biais de la surveillance des pêcheries.
- Il est important d'intégrer les connaissances traditionnelles des pêcheurs et des pêcheuses, car ils disposent d'une mine d'informations importantes sur leur environnement naturel et leurs espèces.
- Les résultats doivent être partagés avec les membres de la communauté de pêcheurs, afin qu'ils valorisent et s'approprient leurs connaissances.
Leçon apprise
- Le processus d'obtention des résultats de la modélisation Ecopath avec Ecosim peut prendre environ six mois, puisqu'il est nécessaire de rechercher des informations, d'interroger les membres de la communauté, d'analyser les informations et de créer les modèles.
- Il est important de faire comprendre aux pêcheurs l'importance et les avantages de connaître les effets de la pêche sur l'écosystème, et de leur faire savoir comment leurs connaissances traditionnelles sont intégrées afin d'obtenir des informations plus solides pour la gestion de l'écosystème.
- Les entretiens menés avec les pêcheurs pour enregistrer leurs connaissances traditionnelles ont été longs (environ 40 minutes), ce qui a parfois entraîné une perte d'intérêt de la part de la personne interrogée. En outre, compte tenu du temps nécessaire pour mener chaque entretien, le temps disponible pour interroger davantage de membres pourrait être limité.
Le co-investissement au service de la durabilité de la pêche
Pour réussir à assurer la durabilité des ressources halieutiques, il faut une participation active des différentes parties prenantes : les communautés de pêcheurs, le secteur gouvernemental, le monde universitaire, les organisations de la société civile et le marché, parmi les plus importantes. En 2019, COBI a commencé à contrôler les coûts (monétaires et non monétaires) associés à la mise en œuvre et au développement de projets d'amélioration de la pêche. De cet exercice, il a été documenté que généralement au début des projets, la philanthropie fait l'investissement économique le plus important par l'intermédiaire des OSC, tandis que les communautés de pêcheurs font des investissements non monétaires (par exemple en mettant leurs bateaux à disposition pour les activités), et que d'autres acteurs participent également (par exemple les organismes gouvernementaux ou le monde universitaire). L'objectif du co-investissement communautaire est qu'au fil du temps, les communautés de pêcheurs s'organisent et s'engagent à continuer à payer les coûts associés à ce type de projet et à atteindre une plus grande autonomie financière. COBI et les communautés de pêcheurs ont développé une stratégie écrite avec un calendrier de cinq ans, dans laquelle les communautés s'engagent à maintenir un pourcentage progressif de contributions économiques afin d'atteindre la coresponsabilité et l'autonomie du projet.
Facteurs favorables
- Les parties prenantes connaissent les coûts du projet et disposent ensuite d'une stratégie financière progressive pour le co-investissement.
- Les parties prenantes ont mis en place des processus transparents et responsables afin d'instaurer la confiance et de soutenir ainsi les projets d'amélioration de la pêche à long terme.
Leçon apprise
- Cartographie des acteurs de la cogestion de la pêche dès le départ. Cela permet de rendre visibles tous ceux qui peuvent/doivent participer aux contributions financières des pratiques d'amélioration et au suivi du projet.
- Intégrer et former tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur à l'importance et aux avantages d'être des co-investisseurs dans l'amélioration de la pêche.
- Prendre en compte les contributions monétaires et non monétaires (par exemple, le capital humain, le temps investi, la production de données/d'informations, l'infrastructure/l'espace de réunion). Cela permet d'évaluer, de reconnaître et de rendre visibles les contributions et l'engagement de chaque secteur en faveur d'une pêche durable.
- Le co-investissement n'est pas un processus simple, car il implique des questions financières. Il est donc nécessaire de former les participants et de leur faire reconnaître son importance.
Impacts
1. Reconnaissance et engagement de l'opinion publique régionale, nationale et latino-américaine en faveur d'une bonne gestion et d'une bonne gouvernance de la pêche.
2. La pêcherie a réussi à atteindre et à améliorer certains des indicateurs établis par le Marine Stewardship Council (MSC), grâce à une bonne gestion de la pêcherie et à une meilleure disponibilité des informations, un processus qui se poursuit. Cela a apporté une valeur ajoutée au produit, qui est reconnu dans des segments de marché préférentiels.
3. La génération d'informations pour la bonne gestion de la pêche, grâce à un système de surveillance de la pêche et de l'environnement de la flotte artisanale.
4. La pêcherie opère de manière durable, en établissant des tailles minimales de capture.
5. La pêche est plus sélective grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques ; les poissons plus gros sont capturés et les prises accessoires sont réduites grâce à la modification des engins de pêche.
6. Collaboration interinstitutionnelle entre le secteur productif, le secteur gouvernemental et le secteur privé pour la gestion de la pêche.
7. Les communautés de pêcheurs ont été impliquées et se sont appropriées le projet, en assurant un suivi optimal et en prenant conscience de l'importance d'une pêche durable.
8. L'échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les femmes et les pêcheurs de différentes communautés a été facilité.
Bénéficiaires
Environ 1 000 femmes et pêcheurs artisanaux dans quatre États mexicains.
Objectifs de développement durable
Histoire
Au Mexique, les pêcheurs et les pêcheuses s'efforcent d'améliorer la gestion et la connaissance de leurs pêcheries. Ils ont mis en place un suivi de la pêche axé sur différentes espèces de poissons par le biais de carnets de pêche. Cela leur permet d'obtenir des informations et de suivre l'évolution de leur pêche. Ces informations sont partagées avec différents secteurs (universités, gouvernement et organisations de la société civile). Aujourd'hui, d'autres organisations de pêche ont demandé le soutien de ces pêcheurs et pêcheuses pour mettre en œuvre des projets d'amélioration de la pêche, pour optimiser leurs pêcheries et pour approcher ou atteindre les normes internationales de durabilité. Quatre coopératives de pêche sont devenues des pionniers et des leaders nationaux en matière de durabilité de la pêche, ce qui rend leurs communautés fières et motive les pêcheurs à poursuivre et à améliorer leur travail dans le domaine de la pêche.