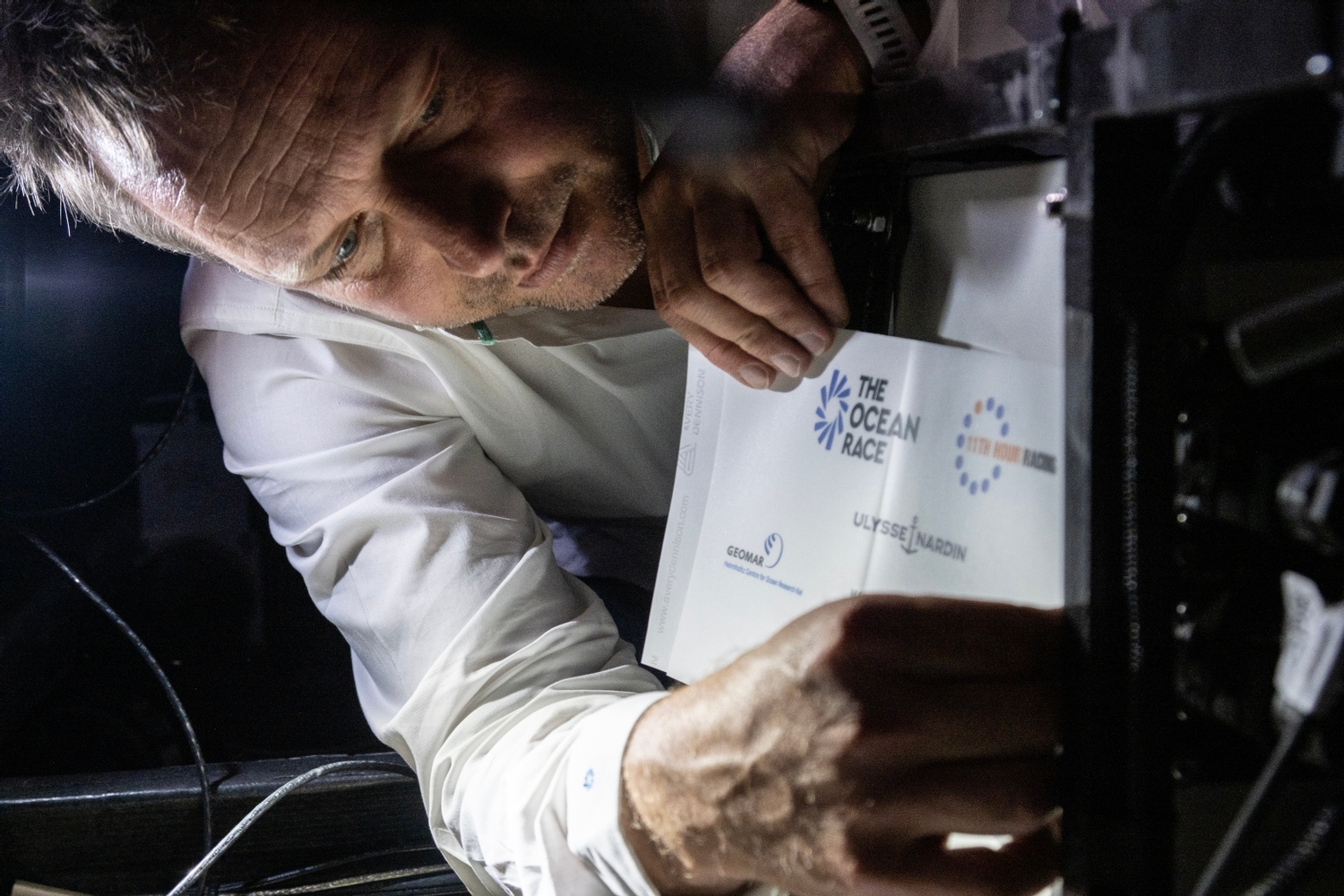Renforcement des capacités, partage des connaissances et sensibilisation au CCRE avec les parties prenantes
Ce module permet aux communautés locales, aux agences gouvernementales et aux autres parties prenantes d'acquérir les connaissances, les compétences et les outils nécessaires à la mise en œuvre et à la pérennisation d'initiatives efficaces de restauration des mangroves. Grâce à un engagement stratégique et à des efforts de renforcement des capacités, les parties prenantes sont dotées de l'expertise technique et des ressources nécessaires à la restauration écologique communautaire des mangroves (CBEMR). Ces efforts comprennent l'identification et la formation de champions de la restauration écologique communautaire des mangroves (CBEMR) afin qu'ils servent de catalyseurs pour la diffusion des connaissances et les activités pratiques de restauration au sein de leurs communautés et de leurs institutions.
Wetlands International a lancé des activités de renforcement des capacités en engageant les communautés locales de Lamu et de Tana par le biais d'organisations communautaires, d'associations de consommateurs et d'agences gouvernementales clés, notamment KFS, KEFRI, KMFRI, le gouvernement du comté de Lamu, ainsi que des organisations de la société civile telles que le WWF et le Northern Rangelands Trust. Les femmes représentaient 50 % des participants, jouant un rôle de premier plan dans les efforts pratiques de restauration des mangroves. Les sessions de formation comprenaient des techniques de restauration solides basées sur l'approche du CBEMR, menées en anglais et traduites en swahili pour une plus grande accessibilité. Ces sessions ont permis d'intégrer la science des mangroves, pratique et réaliste, aux connaissances indigènes, favorisant ainsi l'inclusion et l'appropriation par les communautés.
En outre, les parties prenantes ont reçu des outils simples tels que des réfractomètres et des bandelettes de pH pour effectuer des tests de salinité et d'acidité, ainsi que des ressources pour soutenir le suivi et la gestion adaptative.
Les champions du CCREB, nommés par les CFA, les BMU, les groupes de jeunes, les groupes de femmes et les agences gouvernementales, ont amplifié ces efforts. Ces champions contribuent à la mobilisation des communautés, à la sensibilisation, à la conduite des activités de restauration, au suivi des progrès et à la réalisation d'évaluations écologiques et sociales. Les champions des agences gouvernementales servent également de formateurs de formateurs pour assurer un renforcement continu des capacités au sein de leurs institutions et de leurs communautés.
Sur la base du succès des formations initiales à Lamu et dans d'autres sites, les responsables du KFS de Lamu, en collaboration avec Wetlands International, ont identifié le besoin de diffuser ces connaissances principalement au niveau de la politique et de la gestion au sein du KFS parmi d'autres parties prenantes clés. En partenariat avec le KFS et le PAM, nous avons organisé une formation à la gestion du CBEMR pour les cadres supérieurs et les gestionnaires des forêts côtières du KFS, les directeurs du département de l'environnement des comtés de Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River et Lamu, les universitaires de la Kenya School of Forestry et de l'Université Kenyatta, les organisations partenaires de Global Mangrove Alliance, à savoir l'UICN, le WWF et TNC, ainsi que les représentants du Western Indian Ocean Mangrove Network et les journalistes locaux spécialisés dans les questions d'environnement.
La collaboration avec les OSC, l'Alliance mondiale pour la mangrove et d'autres partenaires a renforcé la portée et l'impact de l'initiative, permettant des activités régulières de formation et de partage des connaissances dans les régions de mangrove.
Approches participatives et holistiques: La conception participative du CCRE met en relation les utilisateurs des ressources avec les institutions de recherche, les gouvernements locaux, les agences de conservation et la société civile, en tirant parti de leurs connaissances locales et de leur expertise. Cette approche garantit un engagement holistique et l'intégration de diverses perspectives.
Sélection stratégique et autonomisation des champions: Les champions ont été choisis en fonction de leurs qualités de leadership, de leurs compétences en matière de communication et de leur intérêt pour la conservation des mangroves. Une représentation diversifiée, comprenant des femmes, des jeunes et des dirigeants communautaires, a permis d'améliorer l'inclusion. Les champions ont été dotés de connaissances, de compétences, de ressources et d'un mentorat permanent, ce qui a permis une mobilisation efficace de la communauté et un transfert de connaissances. Des rôles et des responsabilités clairement définis permettent de s'assurer que les champions comprennent leurs contributions et peuvent défendre efficacement la conservation des mangroves au sein de leurs communautés et de leurs agences. Wetlands International a contribué à la création d'un système de communication et de coordination, de mécanismes de retour d'information par le biais de réunions régulières et d'opportunités de partage des connaissances et de résolution conjointe des problèmes. Outre la formation, l'autonomisation des champions a été la clé du succès de l'initiative. Il s'agit de leur fournir les ressources nécessaires, y compris les outils et le soutien financier, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs tâches. Il est tout aussi important de reconnaître et de valoriser leurs contributions, de leur proposer des incitations qui les motivent et de leur offrir des possibilités de développement personnel et professionnel. Cette approche permet non seulement de renforcer leur engagement, mais aussi d'inciter d'autres personnes à participer activement aux efforts de conservation des mangroves.
Des partenariats solides: La collaboration entre Wetlands International, KFS, KEFRI, KMFRI, les communautés locales et les OSC a facilité le partage des connaissances, la mobilisation des ressources et l'influence sur les politiques.
Rôles de genre et groupements sociaux: La reconnaissance du rôle central des femmes dans les activités de restauration de la mangrove et l'existence d'organisations communautaires relativement bien établies à Lamu ont favorisé l'engagement et l'appropriation par les parties prenantes. Une planification tenant compte de la dimension de genre a permis de garantir que les initiatives soient inclusives et aient un impact.
Accès à l'information et aux ressources: Des supports de formation en anglais et en swahili, des outils simples à utiliser et des ateliers pratiques ont favorisé le transfert de connaissances, permettant aux parties prenantes de mettre en œuvre le CCREM de manière efficace.
Un environnement politique favorable: Les efforts de formation ont incité le KFS et d'autres agences gouvernementales à intégrer les principes du CBEMR dans les directives nationales et les stratégies de gestion, favorisant ainsi un cadre politique propice à la restauration durable des mangroves. La collaboration avec le KFS et le KEFRI sur l'utilisation et l'application de l'approche CCRE a permis de réviser les directives nationales de restauration qui prennent en compte les informations sur le CCRE.
Approche de gestion adaptative: Le suivi régulier des activités de restauration a permis aux parties prenantes d'adapter les stratégies, de tirer les leçons des expériences et d'améliorer les résultats au fil du temps, garantissant ainsi un succès à long terme.
Le partage des connaissances est essentiel: La diffusion d'informations et de bonnes pratiques dans les langues locales garantit l'inclusivité et favorise une adoption plus large de l'approche du CCREM. Rendre l'information accessible facilite la compréhension, la contribution et la participation de diverses communautés.
Les champions sont de puissants agents de changement: Investir dans des champions ciblés ayant de l'influence et des réseaux amplifie la portée et l'impact des efforts de restauration des mangroves. En leur donnant les moyens d'acquérir des compétences, des ressources et des incitations, on renforce leur engagement et on suscite un engagement plus large de la part de la communauté.
La diversité et la représentation sont importantes: La sélection de champions issus de milieux diversifiés garantit que les initiatives de restauration sont inclusives et répondent aux différents besoins de la communauté.
La collaboration renforce l'efficacité: Faciliter la collaboration entre les champions et les parties prenantes favorise l'apprentissage mutuel, le partage des connaissances et l'action collective, ce qui accroît l'efficacité des efforts de restauration.
Les politiques doivent être adaptables: Des politiques souples fondées sur les données de suivi et les enseignements tirés sont essentielles pour relever les nouveaux défis et améliorer les pratiques de restauration. Pour ce faire, les gestionnaires forestiers nationaux devraient participer aux initiatives de restauration locales et infranationales afin de contribuer à l'élaboration des politiques relatives aux forêts de mangrove. Par exemple, compte tenu du succès de la première formation du CCREM à Lamu, les agents du KFS de la région ont identifié la nécessité de diffuser ces connaissances auprès de l'équipe de gestion du KFS, des responsables politiques de haut niveau et d'autres parties prenantes clés.
L'autonomisation est le moteur de la réussite: Fournir aux champions des outils, un soutien financier et des opportunités de croissance personnelle et professionnelle inspire l'engagement et favorise une conservation durable menée par la communauté.