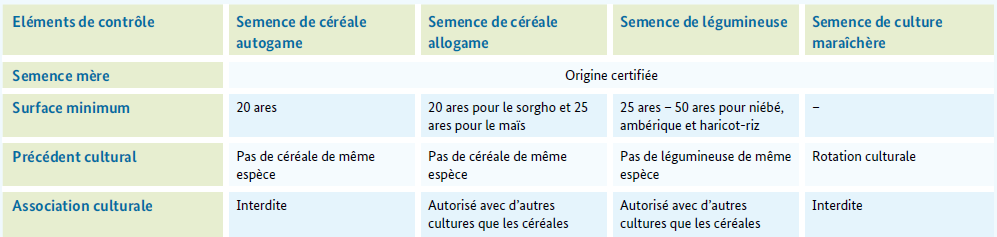Techniques avancées de codage à barres de l'ADN et de métabarcodage :
Le barcoding et le metabarcoding de l'ADN sont des techniques moléculaires de pointe qui permettent une identification précise des espèces à partir de petits échantillons biologiques tels que les excréments d'animaux. Le barcoding cible une seule espèce en séquençant une région génique standard, tandis que le metabarcoding amplifie simultanément plusieurs marqueurs d'ADN, ce qui permet une analyse complète de mélanges complexes. Ces méthodes permettent d'obtenir des informations détaillées sur le régime alimentaire des animaux, les relations prédateurs-proies et les schémas de dispersion des graines sans avoir recours à un échantillonnage invasif. Dans notre solution, ces techniques ont été adaptées au contexte écologique libanais, permettant une évaluation à haut débit de la biodiversité et révélant des interactions clés entre la faune et la flore. Cette approche permet de surmonter les limites des études écologiques traditionnelles et ouvre de nouvelles possibilités pour le suivi des changements de biodiversité, en particulier dans les régions où les données de base sont rares.
L'accès à la technologie de séquençage à haut débit, l'expertise en biologie moléculaire et la disponibilité de bibliothèques de référence régionales ont permis une mise en œuvre réussie. La collaboration avec des experts internationaux, tels que la Smithsonian Institution, a garanti la rigueur méthodologique. L'élaboration de protocoles adaptés aux conditions locales et aux types d'échantillons a été cruciale pour obtenir des résultats fiables. Le financement de FERI et de MEPI a fourni les ressources nécessaires à la mise en place et à l'extension des flux de travail moléculaires.
Nous avons appris qu'il est essentiel d'adapter les protocoles de métabarcodage de l'ADN aux conditions écologiques locales pour maximiser la précision des données. L'établissement préalable de bibliothèques de référence complètes est essentiel pour l'identification correcte des espèces. L'engagement précoce avec des experts moléculaires et des partenaires internationaux a accéléré le transfert de technologie et amélioré le contrôle de la qualité. Nous avons également découvert que les méthodes d'échantillonnage non invasives, telles que la collecte d'excréments, peuvent fournir des données riches, mais nécessitent des protocoles stricts pour éviter la contamination. Enfin, l'intégration de ces outils moléculaires aux connaissances écologiques traditionnelles renforce l'interprétation et l'application pratique pour la restauration.