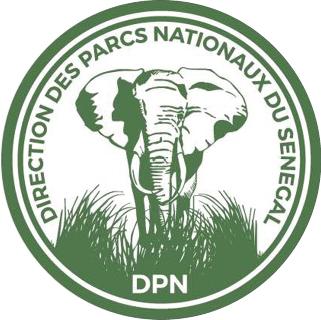Amelioration de la gestion des aires protégées au Sénégal

Les Aires protégées au Sénégal sont constituées d’un réseau représentatif des différents écosystèmes (soudanien, forestier, sahélien, lagunaire, marin, côtier et deltaïque) qui abrite une diversité d’espèces. Depuis leur mise en place, des acquis importants sont notés mais malheureusement des contraintes de différents ordres : anthropique, juridique, institutionnel et financier ont engendré une dégradation des écosystèmes ainsi que les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent.
C’est à travers l’appui du Fonds d’Action du programme BIOPAMA alloué à deux directions chargées de la gestion du réseau d’aires protégées du Sénégal que cette solution a été concrétisée. Celle-ci a notamment contribué à l’amélioration de la planification et la gestion des aires protégées, au renforcement de leur gouvernance tout en mettant en place les conditions pour améliorer le bien-être des communautés riveraines des aires protégées.
Contexte
Défis à relever
Les enjeux liés à la préservation des aires protégées sont tant écologique en permettant de conserver la biodiversité et les services associés, que social et économique pour soutenir les nombreuses activités humaines.
La mise en œuvre de ce projet a permis de relever un certain nombre de défis liés à :
-
l'intégration de ces enjeux de conservation dans la planification des aires protégées ;
-
au renforcement de la participation et de la légitimité des parties prenantes dans la gestion des aires protégées ;
-
au renforcement des compétences des gestionnaires et des moyens opérationnels pour un dispositif de suivi écologique et de surveillance plus performant de la biodiversité ;
-
la réduction des conflits suscités par les intérêts divergents des différents acteurs ainsi que la diversification des sources de revenus alternatives ;
-
l'amélioration des revenus des communautés.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
L'amélioration des documents de planification des aires protégées (PAG) a été la première étape abordée par le projet grâce à l'intégration des résultats IMET2. Pour la mise en oeuvre des PAG, un renforcement de compétences techniques et moyens opérationnels des gestionnaires sur différents outils innovants comme les pièges photographiques, les drones ainsi que des méthodes de traitement et d'intréprétation des données sont réalisés, suivi d'une dotation en équipements pour l'application sur le terrain. Pour plus d'efficacité des actions de gestion de la biodiversité par les gestionnaires, il a fallu aussi gérer les défis sociaux consistant à réduire les pressions sur les ressources et renforcer l'engagement des parties prenantes. Ainsi, à travers un processus d'amélioration de la gouvernance, des plateformes d'interaction des parties prenantes ont été formalisées impliquant une plus grande représentativité de celles-ci dans les instances de prise de décisions (comité de gestion, cadre de concertation, conseil des sages). Quant à la gestion des pressions sur les ressources, des activités génératrices de revenus ont été identifiées en collaboration avec les communautés puis accompagnées financièrement par le projet.
Blocs de construction
Amélioration de planification
La stratégie du projet a consisté à faire la promotion de l’outil IMET2 ainsi que de son utilisation au sein du réseau d’aires protégées du Sénégal. Ainsi, tous les gestionnaires du réseau d’aires protégées ont pris part à la session de formation pour une bonne appropriation de l’outil, suivie de son implémentation au niveau des sites. A l'issue de l'élaboration participative des résultats d’évaluation, un processus de révision des plans d’aménagement et de gestion intégrant les recommandations IMET s’en est suivi.
Facteurs favorables
Au-delà des bénéficiaires, la formation a intégré l’ensemble des gestionnaires et représentants de communautés du réseau pour avoir plus d’impact sur le nombre de personnes aptes à implémenter l’outil sur le terrain. L’accompagnement par un coach pour les séances de collecte de données a renforcé l’efficacité de l’utilisation de l’outil sur le terrain avec les différentes parties prenantes.
La disponibilité d’un coach au niveau national pour accompagner l’exercice a donné de bons résultats
Leçon apprise
Comme leçons apprises, nous avons compris que l'implémentation de l’outil IMET sur le terrain est assujettie à la disponibilité des ressources financières.
La leçon tirée est la faiblesse des ressources allouées aux AP constitue un facteur bloquant pour mieux intégrer l'outil dans la gestion des aires protégées.
Le pré-remplissage est une étape importante pour la gestion du temps imparti à l’évaluation car le travail a été plus fastidieux au niveau des sites mal préparés.
Le renforcement du réseau de coach au sein des pays est plus que nécessaire pour une bonne appropriation de l’outil, la disponibilité d’un seul coach pour le pays a fait de cet exercice un travail très fastidieux.
Les rapports IMET constituent des documents de plaidoyer à l’endroit des bailleurs pour renforcer le financement des AP et orientent les décisions de gestion.
Ressources
Renforcement des compétences
Un volet important de renforcement de capacité a été développé au profit des bénéficiaires pour améliorer la gestion de la biodiversité dans le réseau d’aires protégées. L’objectif était d’améliorer le dispositif de suivi écologique et le niveau de connaissances sur les espèces et habitats grâce à l’adoption et l’intégration des nouvelles technologies (drones et pièges photographiques).
Les attentes des communautés ont été prises en compte dans le cadre de ces formations pour pérenniser des activités génératrices de revenus mises à leur profit.
Facteurs favorables
Les responsables de suivi écologique ont été les principales cibles au niveau des sites, tandis qu’au niveau central, les responsables du système d’information géographique des deux directions bénéficiaires ont été impliqués pour mieux implémenter et centraliser les données collectées sur le terrain.
Des cas pratiques sur les aires protégées ont servi d’exercice aux participants dans le cadre d’un apprentissage par action.
Concernant les acteurs locaux, les thématiques ont été adaptées aux besoins identifiés pour répondre à leurs préoccupations.
Leçon apprise
Le choix des cibles adaptées aux thématiques de formation donne de meilleurs résultats quant à la capacités des bénéficiaires à les restituer sur le terrain. L’expérience a montré que les cibles qui avaient des prérequis sur les thématiques proposées partageaient aussitôt après la formation leur retour d’expériences sur le terrain
La liste des problèmes logistiques identifiés sur le terrain tels que la mise à jour des équipements, la non compatibilité des ordinateurs et smartphone avec les équipements (drone, camera, logiciel) rendaient difficile la pratique de terrain.
Comme leçon apprise, il y a nécessité de gérer les aspects logistiques avec les cibles pour éviter les couacs du terrain afin de renforcer l’efficacité de la formation
La principale leçon apprise du renforcement de compétence pour les communautés est que celles-ci tirent plus profit des sessions de formation itérative et participative que théorique.
Ressources
Accompagnement des résultats de la formation sur le terrain
Ce bloc met en évidence la stratégie du projet pour déployer sur le terrain les différents acquis de la formation des gestionnaires. Pour cela, les moyens opérationnels des sites ont été renforcés sur ces nouvelles technologies (dotation de drone et caméra trap) ainsi que les équipements pour le suivi de la biodiversité marine (balance de précision, filet de pêche expérimentale, filet de capture pour les oiseaux, kit multi-paramètre pour suivre la qualité de l’eau).
Concernant l’IMET, le projet a accompagné les sites dans le processus participatif de collecte de données ainsi que la prise en compte des objectifs et recommandations formulés dans les documents de planification des sites.
Facteurs favorables
L’acquisition des équipements à la suite des sessions de formation a été un facteur clé de succès, car l’une des recommandations des participants à l’issue des ateliers de formation était de rendre ces équipements accessibles pour l’opérationnalisation des activités de terrain.
L’utilisation de l’outil IMET sur le terrain ainsi que l’actualisation des plans d’aménagement ont suivi une dynamique participative impliquant les parties prenantes clés pour la prise en compte des différentes préoccupations.
Leçon apprise
Grâce à l’implication des gestionnaires, les caractéristiques techniques des filets de pêche acquis sont adaptées aux conditions écologiques des aires protégées.
Concernant les kits multi-paramètres, le projet a capitalisé les expériences des premières dotations qui n’ont pas fait l’objet de pérennisation faute d’accompagnement technique des bénéficiaires, raison pour laquelle ces considérations ont été bien prises en compte à travers la formation sur les techniques d’utilisation et d’entretien avant la remise.
Amélioration de la gouvernance
Le projet a intervenu dans différentes catégories d’aires protégées (Parc nationaux, aires marines protégées et réserves communautaires) dont les modèles de gouvernance obéissent aux spécificités. Il était ainsi question de mettre en place des cadres de gouvernance harmonisés et participatifs applicables aux différentes catégories. Pour y parvenir, un document diagnostic de la gouvernance identifiant les actions prioritaires a été élaboré de manière participative et certaines recommandations traduites concrètement sur le terrain dont le renforcement de la participation des parties prenantes.
Facteurs favorables
La cartographie des parties prenantes a été un critère de
désignation des représentants des différents collèges dans les organes
de gouvernance.
Ce critère a contribué à l'amélioration de la gouvernance participative des AP.
Leçon apprise
Le contexte actuel d’évolution de la gestion des ressources naturelles nécessite une plus grande ouverture des aires protégées de catégorie 2 vers les communautés. Le projet a tenté une expérience avec le Parc national du delta du Saloum en facilitant la mise en place d’un cadre de concertation et d’un comité de gestion où les parties prenantes sont représentées et participent aux processus de prises de décision et leur mise en oeuvre, mais ces instances ont du mal à être opérationnelles.
La leçon qu’on peut en tirer est que l’engagement communautaire ne suffit pas seulement pour la mise en œuvre d’une gouvernance adaptative dans ce type d’aire protégée, car la volonté de partager le pouvoir d’autorité avec ces communautés est seul gage de réussite.
Renforcement des moyens d’existence
La précarité des conditions de vie des communautés qui vivent en périphérie des aires protégées contribuent aux pressions sur les ressources qui sont souvent fragilisées et est aussi souvent source de conflit. La mise en place des activités alternatives participent à leur autonomisation et à la préservation des ressources. Une démarche inclusive et participative a été adoptée lors de l’implémentation des activités génératrices de revenus appuyées par le projet. Ce processus a débuté par un diagnostic des activités porteuses de richesse, une identification des bénéficiaires, la sélection des activités sur proposition des communautés, l’élaboration des fiches de projet et de plans d’affaire par secteur d’activité et la mise à disposition des moyens pour leur déroulement
Facteurs favorables
La démarche participative adoptée a suscité une plus grande responsabilisation des acteurs dans le processus d’identification, de formation et de mise en œuvre. Les critères de choix définis sont d'odre économique (rentabilité), social (sécurité alimentaire, valeur nutritionnelle) et environnemental (peu d’impacts négatif) et attention particulière réservée au GIE de femmes dans le ciblage des bénéficiaires.
Un renforcement de compétence a été réalisé pour accompagner l’ancrage de ces activités à long terme
Leçon apprise
Lors du diagnostic un des groupements bénéficiaires n'avait aucune expérience sur l'activité choisie et encore moins d'espace pour mener ses activité. Cependant il s'est rapidement positionné comme le plus dynamique après l'affectation d'une parcelle par la commune.
La leçon tirée est que l'accès des femmes à la terre est un facteur clé de développement. Il en est de même de la dynamique organisationnelle et de l'engagement des bénéficiaires dans l'activité.
Impacts
Impacts sur la biodiversité
L'intégration des technologies innovantes, drones et pièges photographiques a amélioré les connaissances sur la biodiversité de 12 aires protégées bénéficiaires des formations et des équipements.
L’efficacité de gestion des aires protégées est améliorée avec l'intégration des résultats IMET dans 06 PAG révisés. L'IMET a aussi contribué à la désignation d'une AP au label RAMSAR et servi de plaidoyer pour l'amélioration du financement de l’AMP Gandoule avec un appui de 76 225 euros du PPI .
Impacts sur les communautés ;
Renforcement de la participation des communautés au sein de 02 comités de gestion intégrant les représentants des collèges d’acteurs ainsi que l'implication des notables dans 01 comité de sage qui est une instance de régulation et de gestion des conflits.
Les revenus de 230 bénéficiaires directs dont 191 femmes ont été relevés grâce à l’accompagnement d’activités génératrices de revenus axées sur l’apiculture, la commercialisation de riz, la transformation des produits halieutiques, l’écotourisme et le maraîchage intégré à l’aviculture. Le groupement de femmes de Ndorong Log a vu ses bénéfices passés de 1 136 euros à 5 404 euros en six mois avec l’intégration de l’aviculture dans les activités maraichères.
Bénéficiaires
Les principaux groupes bénéficiaires sont :
- les communautés ;
- les gestionnaires ;
- les GIE de femmes d'écogardes;
- les services techniques au niveau décentralisé ;
- les autorités administratives et locales ;
Objectifs de développement durable
Histoire

DEMARCHE DOWN UP DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS EN PERIPHERIE DES AIRES PROTEGEES
C’est en tirant les leçons des différentes expériences déroutantes de l’efficacité de nos actions envers les communautés que le projet d’amélioration de la gestion des aires protégées dans 02 réserves de biosphère du Sénégal appuyé par le fonds d’action BIOPAMA a changé de fusil d’épaule dans son approche de développement à l’endroit des communautés pour améliorer l’impact de l’appui qui leur est destiné.
Pour accompagner les activités génératrices de revenus en périphérie de ses 06 sites d’intervention, le projet a adopté une approche inclusive et participative avec les bénéficiaires dans le choix des filières porteuses de richesse à financer.
Pour y arriver, 04 critères (rentabilité, conformité avec la préservation de l’environnement, savoir-faire local, bénéfique aux communautés, conforme aux objectifs et moyens disponible) ont été définis pour la sélection des activités et une démarche méthodologique (revue documentaire, réunion, enquête semi-structurée) adoptée pour la collecte de données.
Des rencontres organisées avec les populations en périphérie ont impliqué 24 GIE et fédération de femmes, des éleveurs, apiculteurs, pêcheurs, etc. à l’issue desquelles, un rapport diagnostic est produit et restitué aux communautés pour validation.
Les ateliers de restitution ont été un prétexte pour inviter les groupes d’acteurs de chaque aire protégée à se concerter pour 10 minutes pour l’identification d’une activité clé tenant compte des critères. Ainsi, les différentes activités proposées sont : l’aviculture intégrée au maraîchage, la transformation des produits halieutiques, l’apiculture, l’écotourisme et la commercialisation du riz. Ces différentes propositions ont été soumises à l’appréciation des experts pour juger de leur pertinence avant leur validation finale.
Cette démarche a eu comme résultats de :
- améliorer les revenus des femmes car sur 06 projets retenus, 04 GIE de femmes sont bénéficiaires ;
- fédérer les acteurs autour d’un objectif commun ainsi que de favoriser une bonne appropriation des activités qu’ils ont eu eux-mêmes proposées ;
- renforcer la transparence dans le processus de choix des bénéficiaires qui sont considérés de ce fait légitimes par leur pair ;
- améliorer l’efficacité et l’efficience de l’appui.