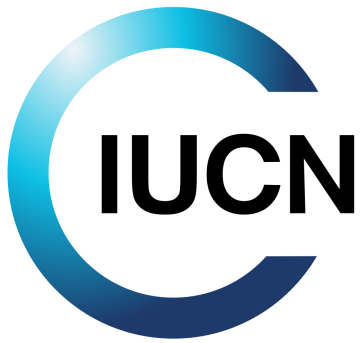
Une boîte à outils participative pour la gestion durable des pâturages avec une approche holistique et multidisciplinaire

La boîte à outils de gestion durable des parcours est testée en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest (région NAWA), avec un accent particulier sur la Tunisie, la Jordanie et l'Ouzbékistan, et offre un ensemble d'outils holistiques et pluridisciplinaires pour s'attaquer à la cause première de la dégradation des parcours. La boîte à outils aidera les communautés, les acteurs politiques et les acteurs du développement à utiliser des pratiques clés de gestion durable des pâturages à l'échelle locale ou dans des environnements spécifiques au contexte, en s'attendant à ce que les services écosystémiques soient utilisés de manière durable et atteignent un niveau de neutralité en matière de dégradation des terres, augmentent la production d'aliments pour le bétail (fourrage) et améliorent les services écosystémiques.
Contexte
Défis à relever
Globalement, le programme de restauration des terres et des écosystèmes a été dominé par les approches forestières et agroforestières, négligeant d'autres approches spécifiques aux terres et aux sites. Dans les zones de parcours, le surpâturage, l'agriculture intensive et l'expansion des zones urbaines entraînent la dégradation des sols et l'extension de la désertification. Ces défis sont aggravés par le changement climatique et la croissance démographique. Les partenaires du développement ont déployé des efforts pour restaurer les terres de parcours, mais leurs approches n'ont pas été holistiques. Des facteurs de complication s'ajoutent à l'ordre du jour, notamment des sécheresses récurrentes, des politiques inefficaces, des arrangements institutionnels faibles, des régimes fonciers peu clairs et la perte des connaissances indigènes en matière d'utilisation des terres. Les approches visant à réhabiliter les pâturages ne tiennent souvent pas compte de l'adoption locale et de la durabilité. Toutefois, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides et ses partenaires ont recherché des possibilités de gestion restauratrice des parcours.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Les pratiques MRS développées dans le cadre de la boîte à outils ont le potentiel d'être mises en œuvre dans plusieurs agro-écosystèmes. Par exemple, la Badia jordanienne est caractérisée par un sol à croûte superficielle, des précipitations faibles et irrégulières qui la rendent sujette à l'érosion ; les pratiques sont alors sélectionnées pour répondre à ces contraintes et atténuer la tendance à la dégradation des pâturages. Il est donc important d'associer les connaissances locales indigènes aux technologies scientifiques en utilisant des approches participatives ascendantes pour atteindre l'objectif souhaité. Il est donc essentiel d'associer les outils qu'il comprend à un écosystème particulier, y compris la participation des parties prenantes et un processus social pour accompagner le processus technique. Le potentiel de reproduction est élevé, car il combine différentes méthodes adaptées à différents scénarios, en associant les processus sociaux et biophysiques.
Blocs de construction
Cadre de gestion et de planification participative des parcours
La bonne gouvernance inclut la participation, car elle permet de responsabiliser les bénéficiaires et d'améliorer la planification au sein des communautés. Par conséquent, la gestion et la planification participatives des parcours (PRMP) fournissent un cadre permettant d'adapter les approches à différentes utilisations dans des contextes spécifiques. Ces caractéristiques uniques comprennent l'échelle, les parties prenantes à impliquer et les migrations ou mouvements saisonniers. L'objectif du PRMP est de faciliter la planification de la gestion participative des parcours d'une manière simplifiée et pratique tout en tenant compte du cadre unique de la gestion des ressources naturelles dans les parcours.
Facteurs favorables
- Dialogue continu dans lequel les parties prenantes concernées expriment leur intérêt et parviennent à un consensus sur l'utilisation et la gestion futures des parcours.
- Processus inclusif dans lequel toutes les parties prenantes sont représentées et impliquées dans les dialogues initiaux, la préparation des cartes, les discussions et l'accord.
- Mobilisation des connaissances locales et intégration des connaissances scientifiques pour façonner les processus de planification.
- Orienté vers l'action, l'accent étant mis sur l'élaboration de plans d'action qui déterminent la manière dont les interventions stratégiques convenues par les parties prenantes seront mises en œuvre.
Leçon apprise
Pour une gestion durable des pâturages, il est important d'utiliser une approche participative holistique et ascendante qui inclut les communautés pastorales locales ; sinon, les efforts peuvent être réduits à néant. Il est donc essentiel d'adapter les outils aux contextes et écosystèmes particuliers. Il faut également déployer des formations pour accompagner la solution et promouvoir la simplicité et la flexibilité administrative afin de s'adapter à l'évolution des environnements et des prévisions pour assurer une meilleure gestion des opérations sur les terres de parcours. Le potentiel de reproduction est élevé car la boîte à outils SRM combine différentes méthodes adaptées à différents scénarios et la solution a reçu un retour d'information positif de la part des bénéficiaires.
Méthodes techniques et boîtes à outils
L'approche holistique de la dégradation des terres de parcours comprend des recommandations relatives aux régimes fonciers et aux ressources, ainsi qu'aux modèles institutionnels qui améliorent la gestion des terres et réduisent leur dégradation. Par exemple, elle indique quand et où utiliser les pratiques de gestion durable des parcours (SRM). Elle peut donc contribuer à orienter les priorités en matière de politique, de technologie et d'investissement dans le domaine de l'élevage pour les programmes, mais aussi pour les agences de développement, les décideurs et d'autres organisations internationales.
L'objectif principal de cette boîte à outils est d'améliorer les services écosystémiques des parcours et le bien-être des éleveurs en partageant, en améliorant et en utilisant les connaissances sur les pratiques de gestion durable des parcours. Pour chaque site, une combinaison de technologies éprouvées est mise à disposition dans le but de mettre en œuvre une restauration rentable, holistique et évolutive. En outre, cette boîte à outils vise à minimiser les échecs d'investissement en fournissant des informations détaillées sur les pratiques couramment utilisées.
Facteurs favorables
- Spécifique au site : la boîte à outils propose des solutions à la suite d'un diagnostic qui sont basées sur le contexte.
- Participative : la méthodologie est basée sur des principes participatifs.
- Holistique : prise en compte des liens biophysiques et socio-économiques et des compromis existant entre les différentes utilisations des terres.
- Approche flexible qui s'appuie sur un suivi au jour le jour où les gestionnaires doivent planifier et replanifier.
- Technologie éprouvée, basée sur l'expérience acquise sur le terrain dans des environnements similaires.
- Mise à l'échelle : fournir les dernières informations sur la gestion des ressources naturelles en présentant les bonnes pratiques pertinentes en vue d'une mise à l'échelle.
Leçon apprise
Le potentiel d'extension de la boîte à outils SRM est élevé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. Par exemple, dans les zones arides de Jordanie où se déroule le programme de restauration de la Badia, les banques de semences du sol ont du mal à se développer parce que la surface du sol est encroûtée. La boîte à outils contient des pratiques qui permettent de résoudre ce problème. Lorsque la réserve de semences du sol est épuisée, les pratiques de MRS sélectionnées améliorent les résultats par rapport aux méthodes traditionnelles qui sont relativement difficiles, longues et coûteuses, et qui ont eu tendance à donner lieu à des enregistrements trop détaillés pour quelques endroits seulement.
Impacts
- Retour d'information positif : En Tunisie, l'office de l'élevage et des pâturages a reconnu l'impact positif de la gestion des pâturages, en produisant des aliments pour le bétail pendant les années favorables, alors qu'ils n'étaient pas disponibles auparavant.
- Attentes élevées en matière d'impact : la boîte à outils pourrait avoir un impact sur plus d'un million d'hectares rien qu'en Tunisie et permettre d'améliorer la gestion et la restauration des pâturages dans les zones arides.
- Adoption élevée: la boîte à outils a de grandes chances d'être adoptée grâce à l'inclusion des connaissances indigènes et à la flexibilité permettant d'ajuster les stratégies de pâturage en fonction des conditions climatiques, associées à des technologies telles que les TIC. En 2021, son adoption a commencé grâce à des procédures contractuelles souples entre l'administration et l'agriculteur.
- Participatif : approches participatives axées sur les institutions de gouvernance coutumières des éleveurs.
- Multidisciplinaire : couvre un large éventail de sujets, y compris les dimensions physiques, écologiques, sociales et institutionnelles.
- Résultats résistants au climat: augmentation de la résistance du système pastoral au changement climatique.
- Gestion améliorée : meilleure gestion et restauration des pâturages dans les zones arides à l'aide de solutions fondées sur la nature qui exploitent la biodiversité et les services écosystémiques afin de réduire la vulnérabilité au changement climatique.
- Approche holistique: la boîte à outils fournit des outils pour traiter les causes profondes d'un système complexe en comprenant les liens entre les terres, l'environnement et l'écosystème choisis.
Bénéficiaires
Les utilisateurs des terres et les décideurs politiques sont les principaux bénéficiaires de cette solution.
Objectifs de développement durable
Histoire
"La boîte à outils pour la gestion durable des parcours présente une approche holistique et multidisciplinaire pour aborder les compromis biophysiques et socio-économiques existant entre les différentes utilisations des terres." M. Mohamed NASRI, ancien directeur général de l'Office de l'élevage et des pâturages en Tunisie.
Cette citation capture précisément l'essence de la boîte à outils SRM, tout en impliquant également les lacunes des efforts de restauration antérieurs. Il s'agit par exemple du manque d'implication des partenaires, du fait de ne pas combiner les connaissances indigènes avec les résultats scientifiques et de ne pas prendre en compte les différents contextes biophysiques (par exemple, la topologie) et socio-économiques (par exemple, la culture ou la réglementation). C'est pourquoi les partenariats locaux et internationaux, scientifiques et exécutifs, en sciences sociales et en sciences naturelles, étaient au cœur du processus. Ce processus participatif a conduit à une approche flexible, holistique et multidisciplinaire pour revitaliser les parcours marginalisés et assurer leur durabilité. Son potentiel est énorme, rien qu'en Tunisie le potentiel est de 2 millions d'hectares ! Le potentiel est également d'aller au-delà des politiques liées à l'élevage, en s'étendant à la technologie et aux priorités d'investissement pour les programmes, les agences de développement et les décideurs.
La collaboration avec un si grand nombre de partenaires et d'acteurs divers a certainement généré des idées pour la gestion des terres de parcours, ce qui s'est traduit par une histoire très positive. Par conséquent, ce processus participatif sera amélioré et étendu afin d'atteindre encore plus de parcours marginaux et de soutenir les moyens de subsistance qui en dépendent.








