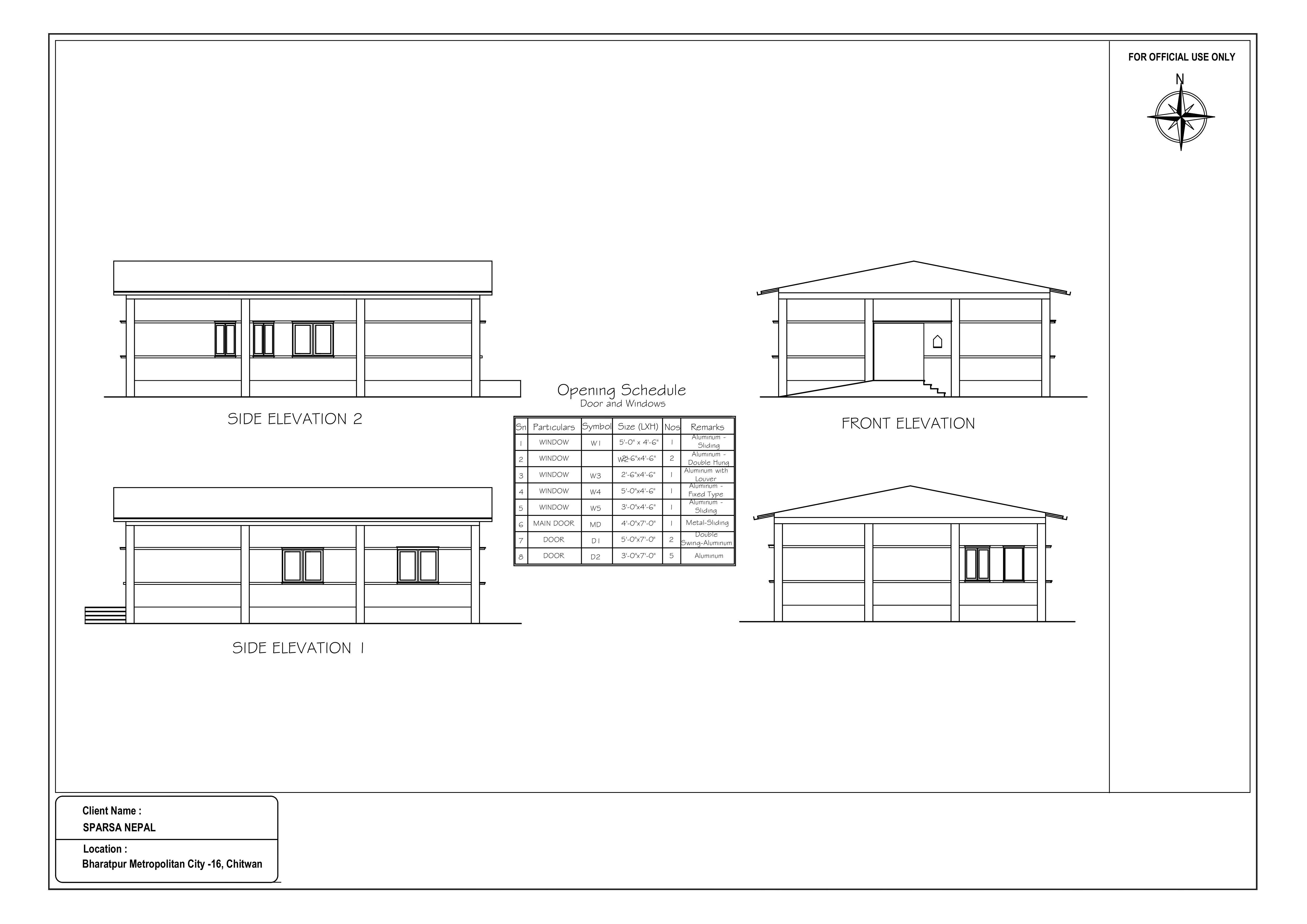Renforcement de la confiance
L'instauration de la confiance est essentielle pour un mécanisme de retour d'information efficace, car elle garantit que les parties prenantes se sentent en sécurité lorsqu'elles font part de leurs préoccupations. Sans confiance, les gens peuvent hésiter à signaler des problèmes par crainte de représailles ou d'inaction, ce qui compromet l'objectif du système.
Au fur et à mesure que les parties prenantes voient leurs préoccupations prises en compte, la confiance s'approfondit, ce qui entraîne une plus grande participation et des relations plus solides entre les communautés et les partenaires de la conservation. Au fil du temps, cette confiance améliore la résolution des conflits et accroît le soutien local aux efforts de conservation.
L'accessibilité et la confidentialité sont essentielles. Des boîtes à clé sécurisées dans chaque zone permettent des soumissions sûres et confidentielles, ce qui encourage la participation. L'impartialité est également cruciale. L'équipe d'intervention multiorganisations, qui comprend des représentants de la Société zoologique de Francfort, du projet de conservation Chitimbwa Iyendwe et du département zambien des parcs nationaux et de la faune sauvage (FZS), rassure les parties prenantes sur le fait que les commentaires et les doléances seront traités de manière équitable.
Une communication et un suivi cohérents renforcent encore la confiance. Le fait de tenir les plaignants informés des progrès et des résolutions démontre l'engagement. La transparence, y compris le partage des résultats généraux des griefs lors des réunions, renforce la confiance.
Pour instaurer la confiance dans le mécanisme de retour d'information, il faut un engagement constant, de la transparence et de la réactivité. Dès le début, l'accessibilité s'est avérée essentielle : en plaçant des boîtes à clé dans plusieurs zones, les membres de la communauté ont pu faire part de leurs préoccupations facilement et en toute confidentialité. Cependant, le manque initial de sensibilisation a limité la participation, soulignant la nécessité de réunions de sensibilisation répétées pour expliquer le processus et rassurer les gens sur la confidentialité.
L'impartialité est un autre enseignement clé. En impliquant plusieurs organisations (FZS, DNPW et CICP) dans l'équipe de révision, le mécanisme a gagné en crédibilité, réduisant les craintes de partialité. Des réponses rapides étaient également essentielles ; les retards dans le traitement des griefs risquaient d'éroder la confiance, soulignant l'importance de délais clairs et de mises à jour intermédiaires.
En outre, il était nécessaire de gérer les attentes. Tous les problèmes ne pouvaient pas être résolus immédiatement et certains ne relevaient pas du mandat du NTCP. La mise en place du mécanisme stipulait que ces questions devaient être transmises aux organes compétents tels que la police zambienne (aucun grief sérieux nécessitant cette action n'a été reçu à ce jour). Le fait de communiquer sur ce que le mécanisme pouvait et ne pouvait pas traiter a contribué à maintenir la confiance. En fin de compte, la transparence, le suivi et le dialogue continu se sont avérés essentiels pour que la communauté considère le processus comme équitable et fiable.