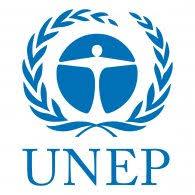Application de la réduction des risques de catastrophes basée sur les écosystèmes (Eco-DRR) pour la planification du développement durable et résilient dans les montagnes de Koh-e Baba, Afghanistan

Le projet visait à réduire les risques d'inondation et d'avalanche et à accroître la résilience dans une région montagneuse de l'Afghanistan en promouvant une meilleure gestion des écosystèmes grâce à une approche paysagère ascendante. Des plans de développement vert et résilient ont d'abord été créés. Dans sept villages, des pépinières ont été créées et 235 380 boutures d'arbres ont été plantées dans des zones sélectionnées exposées aux risques afin de reboiser et de réhabiliter les pentes dégradées. Les capacités en matière de gestion durable et de RRC ont également été renforcées aux niveaux local, provincial et national.
Le projet a adopté une approche Eco-DRR en s'attaquant aux dangers (risques d'inondation et d'avalanche), à l'exposition et à la vulnérabilité aux catastrophes par le biais de l'aménagement du territoire, de mesures basées sur l'écosystème et de la préparation aux catastrophes. Les risques et les impacts concernés sont des risques climatiques qui augmentent en raison du changement climatique. Les mesures écosystémiques mises en place permettent donc également l'adaptation. Si les activités de gestion durable de l'environnement relèvent à la fois de l'EbA et de l'Eco-DRR, le cadre est celui de l'Eco-DRR.
Contexte
Défis à relever
Les températures extrêmes, les fortes chutes de neige, les inondations, les avalanches, les sécheresses et les glissements de terrain ont un impact sur les vies, les cultures et le bétail, ainsi que sur les infrastructures. La vulnérabilité des communautés est exacerbée par la dégradation de l'environnement résultant de pratiques foncières non durables, de l'augmentation de la population et d'une mauvaise planification de l'utilisation des terres. Les principaux défis du projet étaient de savoir comment intégrer l'Eco-DRR dans la planification du développement local en Afghanistan à différents niveaux, le manque de terres publiques, ce qui impliquait de travailler avec des propriétaires terriens privés.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Le projet comporte quatre volets principaux. Les fondements de ce travail reposent sur l'intégration de l'Eco-DRR dans la planification du développement local et national (bloc 1), ce qui permet la planification et la mise en œuvre d'interventions Eco-DRR sur le terrain (bloc 2). Le renforcement des capacités locales et nationales (bloc 3) ainsi que le soutien à la défense des intérêts provinciaux et nationaux en matière d'écorégulation (bloc 4) permettent de soutenir la mise en œuvre (future) et la reproduction des mesures d'écorégulation.
Blocs de construction
Intégrer l'éco-RSE dans les processus de planification du développement local et national
Le projet a conçu un modèle de planification du développement vert et résilient à utiliser au niveau du village, et a proposé un modèle pour étendre la planification locale afin d'intégrer les écosystèmes et les catastrophes au niveau du paysage. Une cartographie communautaire, une modélisation SIG et des évaluations par télédétection ont été entreprises pour mieux comprendre les changements actuels et historiques en matière de risques de catastrophes, de santé des écosystèmes et d'utilisation des terres, tout en tenant compte du changement climatique. Une évaluation de la vision de la communauté locale a également été menée pour mieux comprendre les besoins de développement de la communauté.
Dans le modèle, le processus de planification commence par un examen approfondi des conditions physiques, sociales, culturelles, religieuses et socio-économiques existantes, ainsi que par l'identification et la localisation des principaux risques et des zones sujettes aux catastrophes grâce à des consultations communautaires, des visites sur le terrain et des connaissances d'experts locaux. Une fois les informations recueillies, les communautés sont encouragées à discuter et à identifier les priorités de développement local en ce qui concerne les moyens de subsistance, le développement du village, la prévention des catastrophes et l'amélioration de la résilience de la communauté. Une carte de développement du village, accompagnée d'un bref rapport expliquant les résultats, les objectifs de développement et les stratégies, constitue le plan final.
Facteurs favorables
Le projet a réalisé qu'il serait plus utile d'intégrer le processus de planification du développement du projet dans les processus de développement locaux institutionnalisés. En raison des difficultés rencontrées à cet égard (voir les enseignements tirés), le projet a tiré parti de l'emplacement des sept villages cibles, qui se trouvaient dans les limites de la zone protégée de Shah Foladi, et a influencé la conception du plan de gestion de la zone protégée afin d'intensifier les mesures fondées sur l'écosystème dans un paysage plus vaste.
Leçon apprise
L'un des défis auxquels le projet a été confronté était de savoir comment soutenir au mieux l'intégration des éléments Eco-DRR dans la planification du développement local en Afghanistan. Alors que le projet a commencé par créer des plans de développement écologiques et résilients à utiliser dans le cadre du projet, il a décidé d'influencer le processus de planification du développement existant dans le cadre du Programme de solidarité nationale (PSN) du gouvernement. Cependant, le PSN est actuellement en cours de révision et un nouveau processus de PSN est en cours d'élaboration au niveau national. Le projet n'a donc pas pu intégrer la planification du développement vert et résilient dans le PSN. Cependant, il a mis tout en place pour que cela puisse se produire à l'avenir.
Interventions sur le terrain au niveau des villages
Dans chaque village, quatre interventions principales ont été menées :
- Création de pépinières communautaires
- Plantation d'arbres/reboisement
- Création de centres de résilience communautaires
- Renforcement des capacités locales en matière d'activités d'éco-réduction des risques de catastrophe (Eco-DRR)
Ces activités visent à restaurer le couvert végétal sur les pentes et les berges des rivières autour des villages afin de réduire les risques d'inondation, tout en apportant des avantages directs en termes de moyens de subsistance aux ménages ciblés et aux parties prenantes du projet. La mise en place de centres communautaires et de procédures de préparation aux catastrophes vise à réduire l'exposition des ménages en leur fournissant un abri contre les conditions hivernales extrêmes. Le projet a également encouragé la reproduction et l'extension des activités d'éco-réduction des risques de catastrophes à Koh-e Baba, afin de maintenir les interventions sur le terrain au-delà de la durée de vie du projet, qui est de trois ans.
Facteurs favorables
La situation relativement stable en matière de sécurité dans la province de Bamyan et la collaboration de longue date entre le PNUE, l'Organisation pour la conservation des zones montagneuses afghanes (COAM) et les villages cibles ont facilité la mise en œuvre et le suivi des activités sur le terrain.
Leçon apprise
Des interventions sur le terrain à une échelle géographique et temporelle beaucoup plus grande seraient nécessaires pour apporter la preuve d'une réduction réelle des risques d'inondation, ce qui dépassait la portée de ce projet. Par conséquent, l'intention était plutôt de faire des démonstrations sur le terrain de mesures écosystémiques bien connues qui se sont avérées efficaces dans d'autres recherches sur le terrain et dans la littérature scientifique, afin de démontrer leur potentiel dans les zones de haute montagne de l'Afghanistan.
Un certain nombre de difficultés entraveront l'adoption, la reproduction et l'extension de l'approche dans le pays. Il s'agit notamment des capacités limitées des gouvernements nationaux et locaux, du manque d'accès aux terres publiques pour les activités communautaires basées sur les écosystèmes, et de la nécessité de démontrer clairement les avantages économiques de ces activités afin de fournir des incitations locales à la reproduction. En effet, l'utilisation de terres privées pour les pépinières s'est heurtée à une résistance initiale, mais à la fin du projet, la demande de reproduire l'établissement de pépinières s'est manifestée une fois les avantages constatés.
Développer les capacités locales et nationales en matière d'éco-réduction des risques de catastrophe (Eco-DRR)
Le projet a investi de manière significative dans le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'Eco-DRR. Tout d'abord, la sensibilisation de différents publics (communautés dans la zone du projet, gouvernement, université et autres publics locaux et nationaux) a été menée par divers moyens tels que la radio, des conférences, des ateliers, des fiches d'information et des affiches, des modèles 3D et des vidéos.
Ensuite, divers ateliers sur la mise en œuvre de l'Eco-DRR ont été organisés au niveau local pour former à la gestion des pépinières, à l'alerte précoce et à la préparation, à la gestion du centre de résilience communautaire, ainsi qu'à la formation des formateurs. Les démonstrations sur le terrain et les formations pratiques aux niveaux provincial et national ont servi de base pour renforcer la compréhension des gouvernements provinciaux et nationaux de la pratique Eco-DRR afin de soutenir la mise en œuvre et la reproduction des mesures Eco-DRR à l'avenir.
Enfin, le projet a impliqué les universités afghanes dans des conférences et des formations nationales et provinciales sur l'EcoDRR, dans le but d'intégrer les concepts et les connaissances pratiques de l'Eco-DRR dans les programmes universitaires.
Facteurs favorables
Il est important d'entretenir des relations de longue date et de travailler avec des organisations et des acteurs locaux pour mettre en place une bonne stratégie de communication et favoriser le renforcement des capacités. En outre, un financement supplémentaire a permis un échange d'expériences entre l'Afghanistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan afin de promouvoir l'éco-réduction des risques et l'adaptation aux changements climatiques dans la région.
Leçon apprise
Le dialogue, l'implication des parties prenantes et la collaboration avec les organisations locales, la mise en place d'un projet pilote de démonstration au niveau local et l'investissement massif dans le renforcement des capacités sont des éléments clés de la durabilité.
Soutenir les activités de plaidoyer au niveau provincial et national en matière d'éco-réduction des risques de catastrophe (Eco-DRR)
Ce volet visait à promouvoir les mesures basées sur les écosystèmes et la réduction des risques de catastrophe en Afghanistan, où ce type de travail n'existe qu'à l'échelle nationale. Le projet a donc identifié des points d'entrée tels que les travaux d'adaptation au changement climatique et a promu le concept global de réduction des risques de catastrophe dans le pays, les mesures basées sur les écosystèmes faisant partie intégrante de la réduction des risques de catastrophe.
Facteurs favorables
Grâce à ses interventions sur le terrain et aux multiples formations et ateliers organisés aux niveaux local, provincial et national, le projet a suscité un dialogue national sur l'efficacité des mesures fondées sur les écosystèmes pour parvenir à un développement durable et résistant aux catastrophes. Le projet est arrivé à point nommé, car il a permis d'acquérir une expérience concrète de l'éco-RRC en Afghanistan, ce qui a contribué à alimenter le dialogue politique national en vue de l'adoption du nouveau cadre mondial sur la RRC.
Leçon apprise
Le projet a influencé la politique et les programmes nationaux en promouvant l'éco-RRC en tant que composante intégrale de la RRC dans les activités humanitaires et de gestion des catastrophes, ainsi qu'en intégrant l'éco-RRC dans les activités d'adaptation au changement climatique. Toutefois, la rotation élevée du personnel occupant des postes gouvernementaux a limité les efforts visant à renforcer les capacités et à soutenir la défense des politiques en matière d'éco-réduction des risques et des dommages. Par exemple, les efforts du PNUE pour promouvoir l'écorégulation dans le plan provincial quinquennal de Bamyan ont été compromis par le changement de gouverneur provincial et les multiples affectations temporaires à ce poste, ce qui a entraîné de longs retards dans l'élaboration du plan provincial. Toutefois, les formations et les conférences nationales garantissent le renforcement des capacités du personnel technique du gouvernement.
Impacts
Les risques d'inondation et l'érosion qui en découle sont atténués par la plantation d'arbres sur les pentes dégradées et les rives des cours d'eau dans les villages situés en amont du bassin versant. En outre, la plantation d'arbres fruitiers et les ventes des pépinières ont augmenté la sécurité alimentaire et les revenus des villages.
Les plans de développement de villages verts et résilients, comprenant des cartes détaillées des risques et de l'utilisation des terres, permettent une planification sensible aux écosystèmes et aux risques qui peut être étendue à la vallée et au paysage. Cela permet également d'éloigner le développement des zones exposées aux risques et d'identifier les zones de changement dans la santé de l'écosystème, réduisant ainsi l'exposition et la vulnérabilité aux risques climatiques.
Enfin, la communauté est mieux préparée aux catastrophes et dispose de nouvelles capacités pour réduire les risques et accroître sa résilience.
Bénéficiaires
Sept villages de haute montagne comprenant un total de 1317 personnes ont été les principaux bénéficiaires du projet. Toutefois, le projet profite également à la province de Bayman et à l'Afghanistan en renforçant les capacités en matière d'éco-réduction des risques de catastrophes, y compris dans le cadre de la planification nationale.
Objectifs de développement durable
Histoire

Les communautés de sept villages des montagnes de Koh-e Baba, avec l'aide d'une ONG locale et du PNUE financés par la Commission européenne, ont créé des plans de développement villageois écologiques et résilients qui peuvent être reliés à des plans de vallée et de paysage plus vastes. L'établissement de bases de référence et de bases de données pour informer la planification de l'utilisation des terres fait partie intégrante de ces plans. Il s'agissait notamment de cartographie participative communautaire, d'enquêtes sur le terrain, de télédétection et de modélisation SIG, qui ont servi de base à la planification des interventions sur le terrain.
Les interventions sur le terrain comprenaient la création de pépinières (saules, peupliers et arbres fruitiers) et la plantation d'arbres pour la stabilisation des sols et la gestion des inondations sur les pentes et à côté des cours d'eau, ainsi que la création de centres de résilience communautaires (zones d'abris sûrs et espace de formation) et d'équipes villageoises de préparation aux catastrophes, ainsi que le renforcement des capacités dans tous ces domaines. En raison de l'absence de terres publiques, des terres privées ont dû être sélectionnées dans chaque village et les pépinières sont donc gérées comme des entreprises privées avec des bénéfices sociaux. Cela permet également d'améliorer la situation économique des villageois, car les arbres fruitiers génèrent des revenus plus importants que le blé ou la pomme de terre.
En deux ans, 235 380 boutures d'arbres ont été plantées dans des zones inondables sélectionnées dans les sept villages. Les habitants des communautés ont également exprimé leur appréciation de la valeur esthétique de villages plus verts.
Enfin, le projet a également investi de manière significative dans le renforcement des capacités locales et nationales pour la mise en œuvre de l'Eco-DRR par le biais d'une sensibilisation, d'une formation et d'ateliers locaux et nationaux, d'activités d'apprentissage pratiques sur les sites de terrain, de l'intégration de l'Eco-DRR dans les programmes universitaires et de visites de terrain et de voyages d'étude à la fois dans le pays et dans la région (échanges d'apprentissage entre l'Afghanistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan).