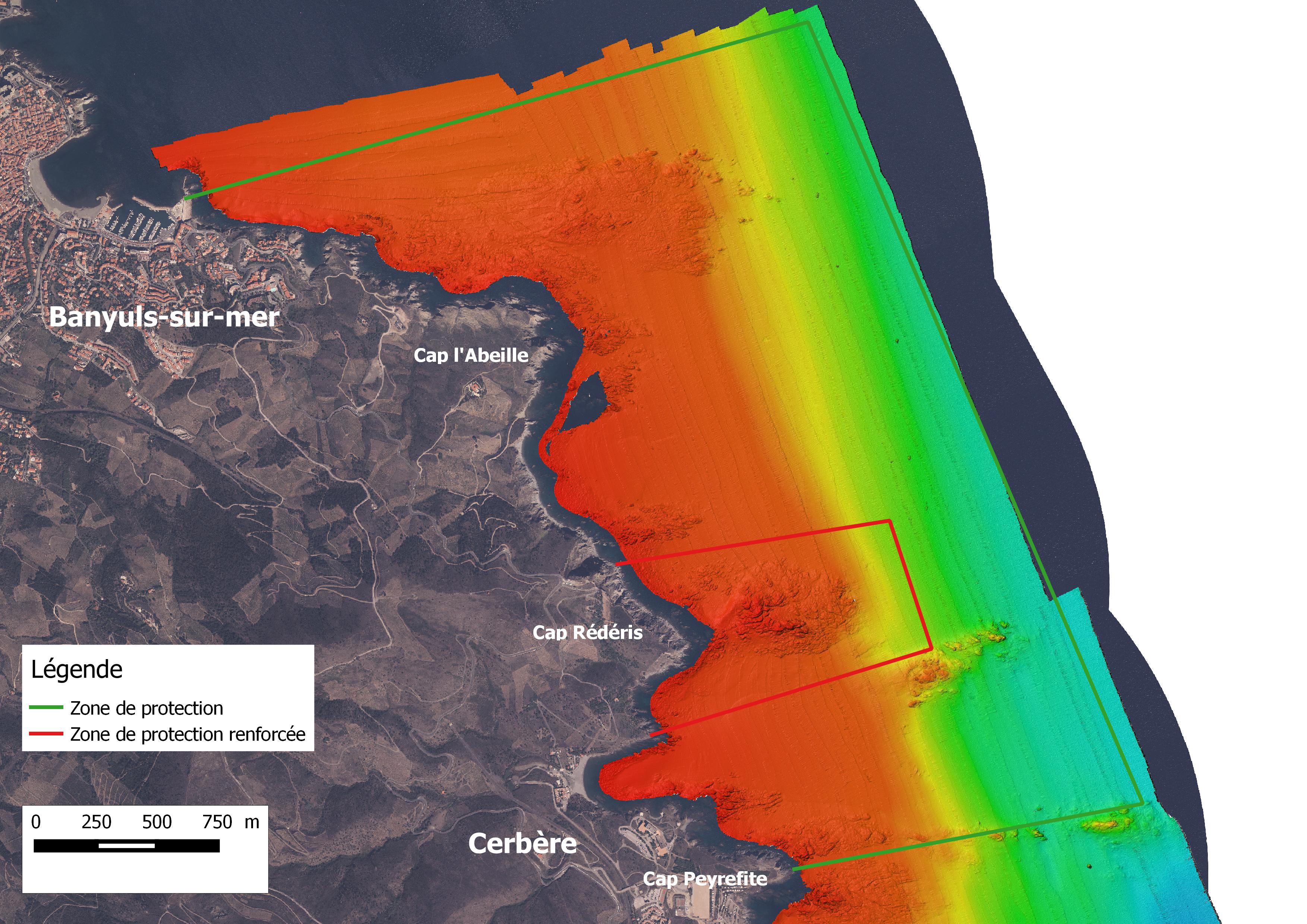Disposition des caméras et collecte des données
En tenant compte des caractéristiques géographiques de la réserve, des caractéristiques saisonnières, de la répartition des communautés et des principales ressources naturelles, les travailleurs de terrain mettent en place des sites de surveillance sur les routes principales et à l'entrée des ravins de la région, et utilisent la méthode "deux caméras lumineuses et une caméra sombre" pour le déploiement des caméras, c'est-à-dire que les deux caméras tiennent compte de l'orientation de l'objectif, de la distance, Les deux caméras tiennent compte de l'orientation de l'objectif, de la distance et de la qualité des images pour s'assurer que des images ou des vidéos claires de l'avant de l'entrant sont prises sans laisser de zones mortes dans la zone aveugle, et la troisième caméra se concentre sur la sécurité des deux premières caméras, placées dans un endroit très secret et difficile à trouver, et le champ visuel doit inclure les deux premières caméras infrarouges pour éviter les dommages malveillants à l'équipement de surveillance, sinon, les données seront perdues.
La première est que l'installateur de la caméra maîtrise la disposition des caméras infrarouges, la deuxième est que le site d'installation de la caméra peut être sélectionné correctement, la troisième est que le plan de travail est combiné avec la situation réelle, et la quatrième est le mécanisme de récompense et de punition correspondant.
Premièrement, les paramètres, l'orientation et la hauteur de l'appareil photo doivent être corrects afin de réduire le nombre de photos non valides. Deuxièmement, l'appareil photo doit être placé dans un endroit bien caché afin de réduire le taux de perte de l'appareil.