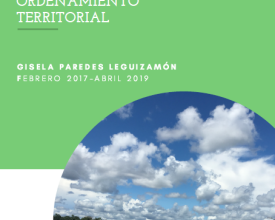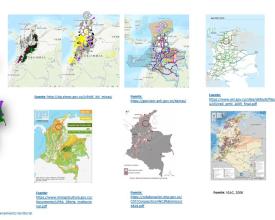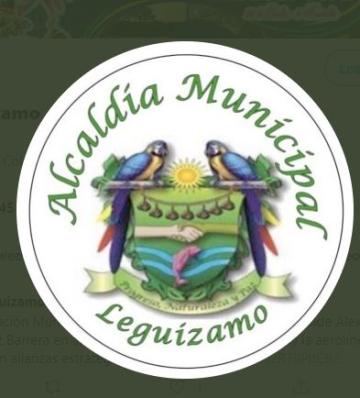Intégrer les aires protégées dans les politiques publiques, les instruments et la planification territoriale : une stratégie pour la gouvernance, la gestion des conflits, le développement et la réconciliation avec la nature.

Quelle stratégie peut-on utiliser pour que la planification des aires protégées soit articulée et influence les décideurs des politiques publiques pour le développement étatique et sectoriel ? En 2011, j'ai commencé une recherche/action systématique qui a cherché l'intégration complémentaire et synergique des zones protégées dans les instruments de planification de l'utilisation des terres, comme une stratégie pour la gestion des conflits socio-écologiques et la contribution au bien-être humain. Grâce à la stratégie politique, technique et de formation qui a été développée en continu depuis 2012, l'intégration des zones protégées dans la politique générale de gestion des terres, la participation à plusieurs échelles des gardes du parc, des communautés, des autorités environnementales dans la formulation des plans de gestion des terres, des organismes interinstitutionnels et le renforcement des capacités de gestion des terres, l'échange d'expériences avec l'Argentine et la participation au projet de l'UICN Zambie, Tanzanie, Vietnam, Colombie, ont été réalisés.
Contexte
Défis à relever
L'évolution à partir de paradigmes fragmentés de la réalité territoriale (urbaine, écologique, socioculturelle, économique) a généré des connaissances fragmentées et une dispersion de la gestion, ce qui n'a permis d'atteindre ni la conservation de la nature ni le bien-être des communautés. Le progrès dans la connaissance transdisciplinaire, le dialogue des connaissances et une vision intégrale du territoire ne peuvent être reportés, de même que la reconnaissance de nous-mêmes en tant qu'êtres de la nature. Il est fondamental de comprendre que le paysage n'est pas le territoire, dans la gestion de la biodiversité ou dans les processus de planification urbaine, ce qui nous permettra d'évoluer vers une gestion territoriale multi-échelle à partir d'une approche basée sur les droits (nature, collectifs environnementaux, vie digne). Influencer les politiques publiques pour que la conservation de la biodiversité et la diversité naturelle soient considérées comme des piliers du développement territorial, que leur conservation soit financée par des contributions de différents secteurs et que le renforcement des capacités soit favorisé.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
L'initiative d'intégrer les zones protégées dans l'aménagement du territoire répond à la nécessité de :
1. de progresser dans l'harmonisation des instruments de planification appliqués sur un même territoire (environnementaux, ethniques, d'aménagement du territoire et sectoriels).
2. Elle contribue à la prévention et à la gestion des conflits
3. Il s'agit d'une approche multi-échelle et multi-acteurs qui reconnaît les instruments de planification ethnique et les différents niveaux de biodiversité. Elle contribue à la gestion des politiques publiques à plusieurs niveaux.
Blocs de construction
Synergie et complémentarité entre les approches pour une gestion territoriale efficace de la biodiversité
Afin de répondre aux défis sociaux, économiques, environnementaux et culturels auxquels la société est confrontée, des engagements ont été adoptés au niveau mondial et souscrits par les États dans le cadre de différents agendas, chacun avec des approches d'intervention particulières (droits, écosystèmes, urbain-régional, prévention des catastrophes et gestion des risques et/ou changement climatique). Laquelle de ces approches est appropriée pour une gestion territoriale efficace de la biodiversité et de l'inclusion sociale ? Toutes. La réalité des territoires est diverse, complexe et présente des problèmes et des potentiels très spécifiques, qui nécessitent un travail coopératif, concomitant, complémentaire et à plusieurs échelles des acteurs sociaux et institutionnels pour harmoniser et mettre en œuvre les actions proposées dans les instruments de planification, de manière à répondre aux besoins identifiés, à prévenir et gérer les conflits socio-environnementaux et à progresser dans la conservation de la nature et du bien-être humain.La combinaison des droits, des approches écosystémiques, urbaines et rurales, de la gestion des risques et du changement climatique est nécessaire pour gérer les territoires de manière intégrée et pertinente.
Facteurs favorables
Ratification, respect des engagements du cadre de Sendai, de la convention sur la biodiversité, de la convention sur le changement climatique, du nouvel agenda urbain, de la convention 169 de l'OIT. Institutionnalité et systèmes solides de : Prévention et réponse aux catastrophes et gestion des risques, environnement national, zones protégées, changement climatique, villes. Personnel possédant des connaissances et de l'expérience. Existence d'un comité spécial interinstitutionnel de la commission colombienne de gestion des terres depuis 2012. Des accords existent entre les parcs nationaux, les autorités environnementales, les communautés ethniques et les secteurs.
Leçon apprise
La Colombie est un territoire multiple, où coexistent différents concepts de territoire : État national (république unitaire, décentralisée en entités territoriales, où elle exerce sa souveraineté) ; ethnie indigène (il existe 115 groupes ethniques, chacun amalgamant ascendance, origine, cosmovision, relation avec la terre mère) ; communautés ethniques noires, afro-colombiennes, palenquères et raizales, où les ancêtres, la nature, le fleuve, la mer déterminent les comportements de solidarité ; territoire frontalier, où les écosystèmes et la culture transcendent les frontières politico-administratives des nations. La gouvernance territoriale nécessite un dialogue entre les gouvernances (zones protégées, eau, ressources naturelles et alimentation), afin de parvenir à la légitimité, à la synergie entre les processus, à la gouvernance, à la pertinence des politiques publiques, à la participation, au dialogue des connaissances et à la qualité de vie. La planification environnementale, ethnique, paysanne, urbaine et rurale doit dialoguer afin d'obtenir des territoires viables. Co-pilotage, alliances, travail coopératif entre les autorités environnementales, les chercheurs, les universitaires, les entités territoriales, les leaders communautaires, les secteurs institutionnels.
La biodiversité dans les instruments d'aménagement du territoire
la planification des zones protégées et des socio-écosystèmes, pour être réalisable, doit avoir un impact sur les instruments de planification de l'utilisation des terres.
Facteurs favorables
L'intégration de l'aménagement du territoire dans la gestion de la conservation de la nature, la gestion des risques et la santé publique a déjà été mentionnée.
Leçon apprise
Ils ne sont pas synonymes : 1) planification de l'écosystème avec planification de l'utilisation des terres, 2) écosystème n'est pas synonyme de territoire.
Tout aménagement du territoire doit être environnemental.
Pour intégrer les aires protégées dans l'aménagement du territoire, il est nécessaire d'avoir une vision et une analyse intégrales du territoire, c'est pourquoi elles doivent être identifiées et contribuer à la gestion de l'articulation des écosystèmes, des programmes de la CDB, de l'UNESCO et, bien sûr, des aspirations, des visions et des formes propres de conception et de régulation des territoires des communautés ethniques et locales.
Impacts
Plaidoyer dans les politiques publiques et participation aux instances interinstitutionnelles: inclusion des aires protégées dans la politique générale d'aménagement du territoire colombien, dans les directives départementales ; coordination du Secrétariat technique de la Commission d'aménagement du territoire 2017-2019 ; membre du Comité spécial interinstitutionnel de la Commission d'aménagement du territoire depuis 2012 coordonné par la DNP et du Comité pour la gestion intégrée du territoire marin côtier dirigé par la Commission colombienne de l'Océan. Structuration de huit cas pilotes : génération de leçons apprises, de recommandations et de méthodologies pour l'intégration des aires protégées dans les politiques publiques, avec le soutien de plus de 30 institutions. Renforcement des capacités des acteurs sociaux et institutionnels, des secteurs, échange d'expériences avec l'Argentine et l'Uruguay. En 2021 Diplôme en coopération colombienne Orinoco, Llanos, Santo Tomas et universités des parcs nationaux. En collaboration avec l'Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, développement de dialogues interinstitutionnels permanents et de cours diplômants dans le Chocó biogéographique. Alliances internationales: avec l'UICN, développement du projet "Planification intégrée de l'utilisation des terres pour la mise en œuvre du plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique et l'augmentation de la résilience des écosystèmes au changement climatique" au Viêt Nam, en Tanzanie, en Zambie et en Colombie au cours de la période 2014-2018.
Bénéficiaires
Communautés locales
Communautés ethniques
Société civile
Universités
Gouvernements locaux, infranationaux et nationaux
Décideurs politiques transfrontaliers
Partenaires
Secteurs productifs
Objectifs de développement durable
Histoire

Dans un pays biodivers, multiethnique, pluriculturel, côtier, marin et régional, avec une tradition de plus de 60 ans dans la conservation de la nature, pendant une décennie, des gardes du parc, des universitaires, des dirigeants de communautés noires, indigènes et paysannes, des chercheurs, des universitaires, la société civile, des institutions publiques et des partenaires coopérants ont pris le risque de faire confiance, de croire, de contribuer et de rêver d'un territoire inclusif, en paix, où la vie sous toutes ses formes est possible. Ils ont entrepris un voyage d'apprentissage commun pour comprendre comment la nature, les territoires et les secteurs productifs pouvaient générer des espaces de dialogue et de participation active à plusieurs échelles dans la formulation de politiques publiques contextualisées en matière d'aménagement du territoire. Nous avons traversé des paysages fantastiques, rencontré des héros en chair et en os qui luttent pour leurs communautés et la protection de la nature, des fonctionnaires qui ont mis leur chemise pour les territoires, des victimes du conflit armé, des défenseurs de l'environnement qui pardonnent et appellent à la réconciliation, des universitaires rigoureux qui écoutent et apprennent, des gardes forestiers au mysticisme inébranlable. Tous unis dans la diversité, nous nous engageons pour un monde meilleur pour tous. Dédié avec respect, admiration et gratitude à ceux qui ont été, à ceux qui sont et à ceux qui viendront.