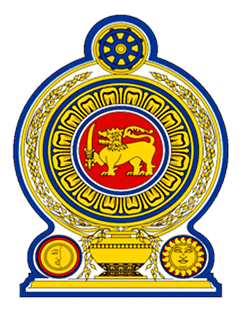Zones sensibles du point de vue de l'environnement : Une histoire de conservation, de développement et de résilience

Le Sri Lanka, bien que de petite taille, fait partie d'un point chaud de la biodiversité mondiale en raison de la richesse de sa biodiversité et des menaces croissantes liées à l'empiètement sur les habitats, à l'utilisation non durable des ressources, à la pollution et aux espèces envahissantes. Si 28 % du pays est couvert par des zones protégées, de nombreux écosystèmes essentiels existent en dehors de ces zones. Conscients de cette situation, le ministère de l'environnement et le PNUD, avec un financement du FEM, ont mis en œuvre une approche de cogestion dans les zones sensibles sur le plan environnemental (ESA), des paysages présentant une grande valeur en termes de biodiversité et de services écosystémiques et situés en dehors des zones protégées officielles. Cette approche a impliqué les secteurs public et privé, ainsi que les communautés locales, pour conserver la biodiversité tout en maintenant les avantages écologiques et socio-économiques essentiels pour les populations environnantes. Elle a encouragé des pratiques de gestion durables et inclusives, en équilibrant la conservation et l'utilisation responsable des ressources, et en permettant des accords de collaboration entre les communautés et le gouvernement. Cette approche est essentielle pour sauvegarder la biodiversité unique du Sri Lanka.
Contexte
Défis à relever
Les principaux défis qui menacent la biodiversité sont la déforestation pour la culture de la chena, l'agriculture non durable telle que la monoculture, l'utilisation excessive de produits agrochimiques, la pollution et la méconnaissance de la valeur de la biodiversité. La faible productivité agricole entraîne l'empiètement sur les terres, de faibles revenus provenant de l'agriculture et du tourisme en raison de chaînes de valeur et d'un accès au marché médiocres, ainsi que des problèmes sociaux tels que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. L'insuffisance des capacités en matière de gouvernance environnementale crée une méfiance entre les communautés et les agences gouvernementales. Le changement climatique intensifie encore ces menaces par des sécheresses, des inondations et des températures extrêmes plus fréquentes et plus graves, accélérant la dégradation des terres et des forêts, la pénurie d'eau douce et l'appauvrissement de la biodiversité. Ces impacts érodent les services écosystémiques et les moyens de subsistance traditionnels, en particulier pour les groupes vulnérables. Parmi les causes sous-jacentes, citons la faible coordination institutionnelle entre les secteurs, l'absence de planification tenant compte de la biodiversité et l'insuffisance de l'engagement public et politique en faveur de la conservation.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
Les trois composantes du processus d'élaboration du plan de cogestion sont l'évaluation de la biodiversité, l'évaluation des menaces et des tendances et la planification participative . sont interconnectées et se renforcent mutuellement. L'évaluation de la biodiversité fournit les connaissances écologiques fondamentales nécessaires pour comprendre ce qui est protégé et pourquoi c'est important. S'appuyant sur cette base, l'évaluation des menaces et des tendances identifie les pressions qui s'exercent sur la biodiversité et projette leur évolution, garantissant ainsi que les décisions sont fondées à la fois sur les réalités actuelles et sur les risques futurs. Ces deux couches fondées sur des données probantes alimentent directement la planification participative, où les communautés et les parties prenantes utilisent les résultats scientifiques pour concevoir des stratégies de gestion pratiques et ancrées localement. Le processus de planification participative renforce l'appropriation, améliore la mise en œuvre des actions et garantit que les mesures de conservation sont socialement acceptables et alignées sur les moyens de subsistance. Ensemble, ces trois composantes créent un système de retour d'information continu : la science informe la planification, la planification répond aux menaces et l'engagement de la communauté assure la durabilité - ce qui produit en fin de compte un plan de cogestion solide, adaptatif et efficace.
Blocs de construction
Approche de la cogestion
L'approche collaborative dans laquelle les communautés locales et les autorités partagent la responsabilité et la prise de décision pour la gestion des ressources naturelles - telles que les forêts, les pêcheries ou les ZEE - permet d'équilibrer la conservation avec les besoins de la communauté, d'améliorer le respect des règles, d'instaurer la confiance et d'assurer la durabilité à long terme.
Wewalkele, l'une des ZSE pilotes, abrite plusieurs espèces menacées, dont le thamba-laya (Labeo lankae), le léopard, le chat pêcheur, l'éléphant et la loutre d'Eurasie. Parmi ses 125 espèces de flore, la canne à sucre (Calamus), haute et dense, pousse dans des bosquets boueux et épineux. Les villages environnants récoltent le Heen Wewal pour l'artisanat, souvent par des méthodes non durables qui complètent leurs revenus.
Reconnaissant la valeur de la biodiversité de Wewalkele et les menaces émergentes, le secrétariat divisionnaire et la communauté ont formé un comité de gestion local (CGL) en 2018 pour élaborer un plan de cogestion. La zone a fait l'objet d'une enquête sociale et a été physiquement délimitée pour empêcher l'empiètement et garantir les objectifs de conservation.
Pour ne laisser personne de côté, le projet a aidé les communautés à passer d'une récolte non durable à des emplois verts - en améliorant les compétences, en renforçant les liens avec le marché et en promouvant des produits de canne à valeur ajoutée. Des pépinières de cannes et des installations de replantation ont été créées pour garantir des moyens de subsistance à long terme. Des partenariats solides entre les autorités locales, les communautés et le LMC ont assuré le succès de l'ESA. Wewalkele montre que les communautés, les habitats et la biodiversité peuvent coexister et prospérer.
Facteurs favorables
1. Un cadre juridique et politique clair
2. Des institutions et un leadership locaux forts
3. Confiance et communication efficace
4. Partage équitable des bénéfices
5. Renforcement des capacités
6. Soutien cohérent du gouvernement
7. Gestion adaptative et suivi
Leçon apprise
L'un des principaux enseignements tirés est que l'absence ou l'imprécision des cadres juridiques et politiques de cogestion a limité l'efficacité et la durabilité des interventions de l'ASE au stade initial du projet. Lorsqu'un soutien clair et reconnu a été mis en place, les rôles des communautés ont été mieux respectés, les droits ont été définis et les résultats de la conservation sont devenus plus durables.......
Le partage équitable des bénéfices est essentiel à la réussite de la cogestion des ASE. Dans la ZSE de Wewalkele, les efforts de conservation ont été conçus pour s'aligner sur les moyens de subsistance locaux, notamment en renforçant l'industrie artisanale basée sur la canne à sucre. Grâce à la formation, aux liens avec le marché et au soutien institutionnel, les communautés ont obtenu des revenus stables tout en contribuant activement à la conservation de la biodiversité. Cet arrangement mutuellement bénéfique démontre que lorsque les communautés partagent à la fois les responsabilités et les bénéfices de la gestion d'une ZSE, les efforts de conservation deviennent plus inclusifs, participatifs et durables.
Ressources
Redécouvrir et mettre en œuvre les connaissances traditionnelles
Il s'agit de faire revivre, de préserver et d'appliquer les systèmes de connaissances autochtones et locaux qui ont toujours soutenu l'utilisation durable et la conservation de la biodiversité à l'intérieur et autour de l'écosystème de la cascade. Ces systèmes de connaissances sont profondément enracinés dans des siècles d'interaction avec les écosystèmes, offrant des méthodes pratiques et éprouvées pour gérer les ressources naturelles de manière à maintenir l'équilibre écologique. En intégrant ces connaissances à la science moderne de la conservation, les efforts en faveur de la biodiversité deviennent plus respectueux de la culture, plus inclusifs et plus efficaces. Sri Lanka : Les systèmes de réservoirs en cascade (Elangawa) sont d'anciennes pratiques de gestion de l'eau qui favorisent la biodiversité aquatique et la culture du riz dans les zones sèches.
- Les anciens du village et les gestionnaires traditionnels de l'irrigation (Vel Vidane) savaient quand ouvrir et fermer les vannes en fonction du moment et du schéma des pluies de mousson, et non pas en fonction de calendriers fixes. Ils s'appuient sur des signes subtils tels que le premier cri des oiseaux migrateurs, la floraison des arbres ou l'humidité des couches du sol pour prendre des décisions en matière de distribution d'eau - des pratiques fondées sur l'observation et non sur des manuels d'ingénierie.
- Les agriculteurs entretiennent traditionnellement des zones tampons végétalisées (Kattakaduwa) en aval du réservoir pour filtrer les sels, protéger la qualité de l'eau et maintenir la santé du sol. Cette pratique n'était pas expliquée scientifiquement dans le passé, mais les communautés locales savaient que l'élimination de ces zones de végétation nuisait aux cultures et à la qualité de l'eau.
- Les agriculteurs locaux savent intuitivement où les sédiments se déposent, comment draguer périodiquement et comment réutiliser le limon pour améliorer la fertilité du sol. Ces pratiques ont permis de maintenir les réservoirs pendant des siècles sans modèles hydrologiques formels.
- Les communautés comprennent que la présence d'oiseaux, de poissons et de reptiles dans et autour des réservoirs fait partie de la santé de l'écosystème - certaines évitent même de perturber les zones de nidification ou ne récoltent les poissons qu'après les périodes de frai, même en l'absence de règles formelles.
Facteurs favorables
- Mémoire de la communauté et continuité de l'utilisation
- Signification culturelle et religieuse
- Reconnaissance juridique et institutionnelle
- Validation scientifique et partenariats
- Organisations communautaires et sociétés d'agriculteurs
- Soutien des ONG et des donateurs
- Reconnaissance mondiale (par exemple, statut GIAHS)
Leçon apprise
- Les projets qui ont relancé les systèmes de citernes en cascade ont mieux réussi lorsque les rôles des sociétés d'agriculteurs et des agences d'État étaient formalisés dans des accords ou soutenus par des politiques locales. en l'absence de reconnaissance formelle, les efforts communautaires se sont parfois effondrés après la fin du financement du projet.
Impacts
Cette solution a permis de créer un environnement favorable à la biodiversité sans compromettre le développement économique durable des communautés environnantes. En permettant aux communautés locales et aux parties prenantes de concevoir et de mener collectivement des interventions axées sur la conservation, elle a favorisé un fort sentiment d'appropriation, tandis que les avantages économiques ont fourni des incitations supplémentaires à la conservation. L'approche de gestion des zones sensibles à l'environnement (ZSE) a permis de promouvoir un modèle holistique de conservation de la biodiversité et de planification intégrée de l'utilisation des sols au sein des agences gouvernementales concernées. Le projet a permis d'identifier et de gérer 23 253 ha en tant que ZSE, d'introduire des pratiques de production compatibles avec la biodiversité sur 23 763 ha et d'intégrer 183 957 ha de zones protégées dans des plans de gestion des paysages terrestres et marins plus vastes. Elle a testé des modèles de gestion d'ASE sur 18 439 ha d'habitats divers, y compris des forêts, des cascades de réservoirs, des écosystèmes côtiers et des collines isolées en dehors des zones protégées. Cela a permis d'établir le cadre de gouvernance nécessaire à l'opérationnalisation de l'ESA et de favoriser une forte collaboration entre les parties prenantes sur les sites pilotes de Manawakanda, Kala Oya Riverine, Gangewadiya, Villu et Wewalkale. Sur la base de ces modèles, le ministère de l'environnement a élaboré et le cabinet des ministres a approuvé une politique nationale d'ASE pour permettre un développement durable et inclusif tout en conservant la biodiversité en dehors des zones protégées.
Bénéficiaires
- Les communautés locales, les cultivateurs de riz et d'autres cultures - hommes et femmes -, les organisations d'agriculteurs, les entreprises agroalimentaires locales.
- Les agences gouvernementales locales telles que le département des forêts, le département de la faune, le département de l'agriculture et les secrétariats divisionnaires.
Cadre mondial pour la biodiversité (CMB)
Objectifs de développement durable
Histoire
Habarawatte, un village situé à la périphérie de Galnewa, dans le district d'Anuradhapura au Sri Lanka, offre un paysage luxuriant inattendu malgré sa classification en zone sèche. Les champs de riz émeraude qui s'étendent, les groupes d'arbres comme Mee et Kumbuk, et le réservoir scintillant du village créent une scène de tranquillité rurale.
Cette sérénité est récente. Il y a quelques années encore, Habarawatte souffrait d'une grave aridité et les villageois peinaient à cultiver leurs terres. Sa transformation est le résultat d'un effort communautaire soutenu par le département provincial de l'irrigation. L'initiative a fait revivre une ancienne pratique écologique, le système de réservoirs en cascade (Ellangawa). Mené par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le ministère de l'environnement et le PNUD, le projet "Enhancing Biodiversity Conservation and Sustenance of Ecosystem Services in Environmentally Sensitive Areas" a restauré le système dans la division GN de Kandulugamuwa, apportant un changement visible dans le village.
Habarawatte borde la forêt et le sanctuaire de Kahalla-Pallekelle, une zone protégée gérée par le département des forêts et le département de la conservation de la faune et de la flore. Les villages adjacents aux zones protégées sont essentiels à la conservation de la biodiversité et à l'équilibre de l'écosystème. C'est pourquoi Habarawatte a été identifié comme une zone écologiquement sensible (ESA). Cette zone abrite une biodiversité importante et fournit des services écosystémiques essentiels. Le projet pilote s'est concentré sur la collaboration avec la communauté pour restaurer la cascade d'ellangawa, disparue depuis longtemps.
La naissance d'un champion
Grâce à cette initiative, le projet ESA a relancé une approche durable de planification et de gestion de l'utilisation des terres qui permet désormais à la communauté d'obtenir des avantages économiques réguliers tout en protégeant une zone écologiquement sensible vitale. "Nous avions seulement entendu parler de l'ellangawa des anciens rois, mais nous ne l'avions jamais vu", explique Neil Jayawardena, président de la Habarawatte Farmers Society. "Auparavant, nous ne pouvions cultiver qu'une fois par an, lorsque les pluies arrivaient, mais après le projet, tout a changé.
Avant d'être rénovées, les anciennes citernes de Habarawatte faisaient partie d'un système d'irrigation complexe mis au point par les anciens Cinghalais il y a plus de deux millénaires. Le système de réservoir-village en cascade, ou ellangawa, est une série de réservoirs ou de petits réservoirs organisés dans un micro-bassin versant du paysage de la zone sèche.