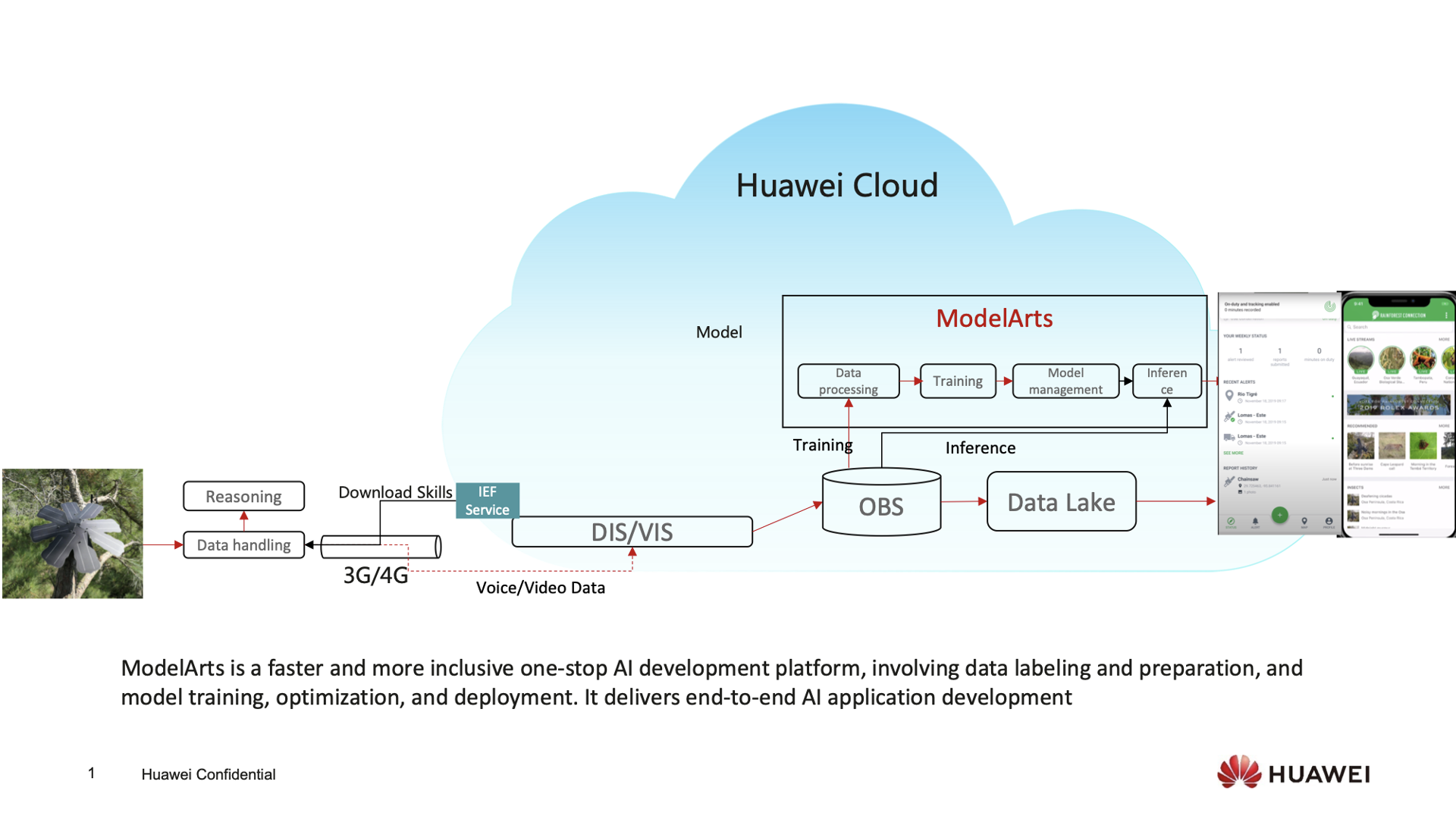Une cartographie participative est entreprise avec les communautés pour comprendre les schémas spatiaux (utilisation des terres, régime foncier, type d'occupation des sols, changements et tendances historiques) et l'état et l'utilisation des ressources de la mangrove dans la zone du projet. L'imagerie Google Earth couvrant l'ensemble de la zone d'intérêt (AOI), combinée à des questionnaires, est utilisée pour évaluer la perception de l'utilisation des ressources par la communauté. Toutes les parties prenantes (agriculteurs, bûcherons, collecteurs de bois de chauffage, producteurs de charbon de bois, fabricants de chaux, anciens et pêcheurs), identifiées lors des entretiens avec les informateurs clés, sont impliquées dans cet exercice et créent une carte d'utilisation des ressources de la zone d'intérêt. Ils sont divisés en groupes d'activité de 5 personnes ou plus. Une seule personne est désignée au sein du groupe pour tracer les limites de chaque type d'utilisation des terres sur la carte. Idéalement, chaque groupe devrait être assisté par un membre du personnel de l'organisation de soutien. Chaque groupe est composé de personnes de sexe et d'âge différents (hommes et femmes/jeunes et vieux) qui sont déjà actives dans les activités respectives (généralement plus de 15 ans).