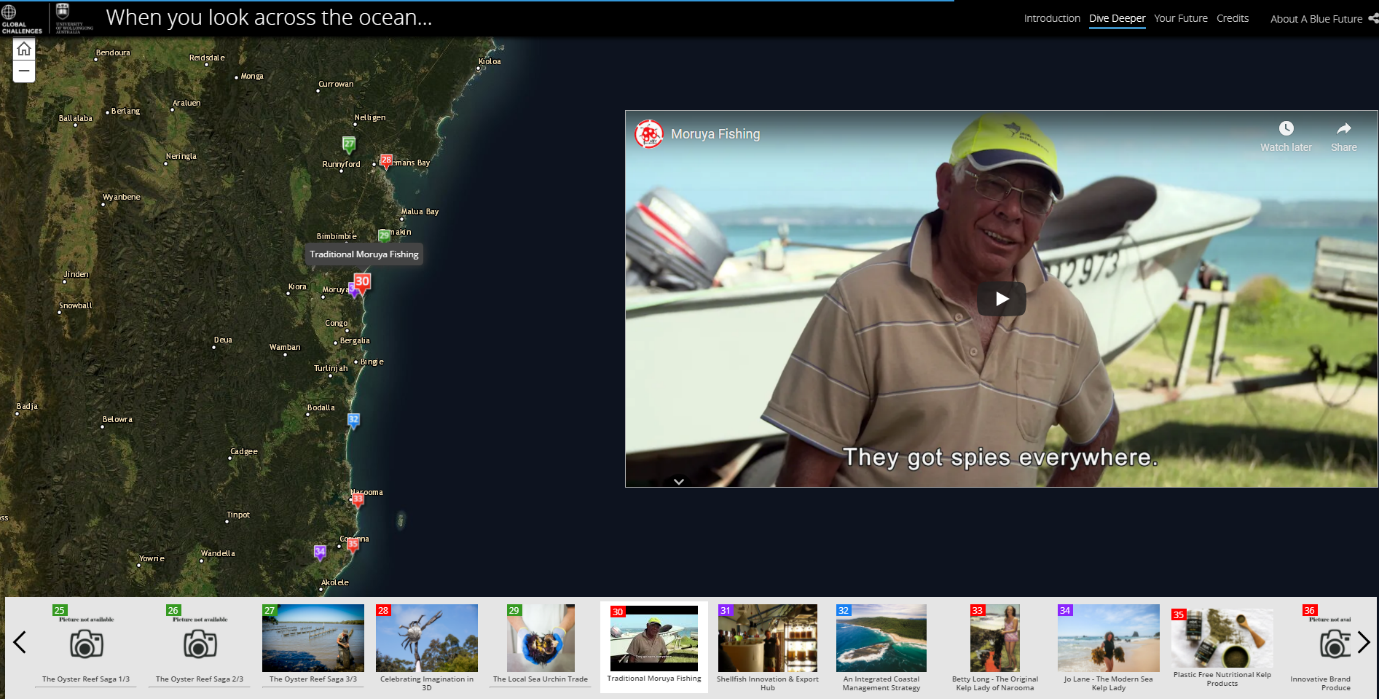En 2013, le Système national des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (SINAREFI) et l'Institut national de recherche sur les forêts, l'agriculture et l'élevage (INIFAP) ont lancé un programme de formation mensuel pour les petits producteurs de la communauté d'Ojo Zarco, dans la municipalité d'Apaseo el Grande, à Guanajuato. Une banque de semences communautaire a été organisée et un groupe de producteurs dépositaires de semences de maïs criollo a été constitué.
Au départ, de nombreux agriculteurs ont assisté aux sessions de formation dans l'espoir de recevoir un soutien financier, mais lorsque le Dr Aguirre de l'INIFAP a proposé à chaque agriculteur de réaliser des expériences pour trouver les meilleures conditions pour sa parcelle, un groupe des agriculteurs les plus intéressés de la région a commencé à se consolider. Les expériences ont permis de comparer le semis "traditionnel" avec celui qui applique un changement de pratique, en ce qui concerne les données relatives à la production de grains et d'anas. Les résultats en matière de couleur et de taille des plantes ont encouragé les producteurs, mais les résultats en matière de productivité ont été décisifs.
Le processus de formation est très lent mais efficace dans la zone de culture pluviale semi-aride. Il faut 6 à 7 ans pour obtenir de bons résultats lorsque seuls les petits agriculteurs disposent de leurs propres ressources.