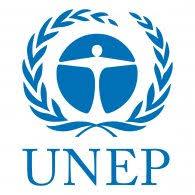Application de la réduction des risques de catastrophes basée sur l'écosystème (Eco-DRR) à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le bassin de la Lukaya, RDC

Le projet visait à réduire les risques liés aux catastrophes et au climat en tant que partie intégrante d'un processus de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) mis en œuvre conjointement en RDC. Des mesures pilotes basées sur les écosystèmes visaient à réduire l'érosion des sols et des ravines ainsi que les risques d'inondation sur deux sites (en amont et en aval) dans le bassin de la Lukaya, tout en améliorant les moyens de subsistance et les revenus. Les capacités ont été développées localement et nationalement sur les mesures basées sur les écosystèmes et le plaidoyer national sur l'EbA/Eco-DRR a été soutenu à travers l'IWRM.
Le projet a adopté une approche Eco-DRR en s'attaquant aux dangers et à la vulnérabilité afin de réduire les risques de catastrophe. Cependant, les activités du projet ont également abordé l'adaptation au changement climatique en travaillant sur les impacts du changement climatique et la vulnérabilité des populations au changement par le biais des mesures basées sur les écosystèmes impliquées dans la GIRE. Ces mesures peuvent donc être considérées à la fois comme Eco-DRR et EbA, tandis que le cadre de mise en œuvre était Eco-DRR.
Contexte
Défis à relever
La gestion des ressources en eau est un défi en partie dû à l'utilisation non planifiée et non coordonnée des terres. L'urbanisation rapide, l'agriculture sur brûlis, l'exploitation des carrières, la production de charbon de bois et l'horticulture ont entraîné la déforestation et la dégradation des sols et de la qualité des eaux fluviales. L'érosion excessive a créé des ravines, des glissements de terrain et augmente le risque d'inondation, qui est devenu un problème majeur en raison de l'augmentation des pluies, ce qui accroît également la pollution des sédiments dans l'eau.
Emplacement
Traiter
Résumé du processus
L'intégration de l'Eco-DRR/EbA dans le développement d'un plan d'action GIRE (bloc 1) est l'objectif sous-jacent du projet. Les activités de terrain telles que l'agroforesterie et le reboisement (bloc 2) et le contrôle de l'érosion des ravines et des sols (bloc 3) fournissent une démonstration des mesures basées sur les écosystèmes et de leurs avantages pour l'inclusion dans le bloc 1. Le renforcement des capacités (bloc 4) et le plaidoyer national (bloc 5) soutiennent la durabilité à long terme de la GIRE et des mesures basées sur les écosystèmes pour la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique.
Blocs de construction
Intégration de l'Eco-DRR/EbA dans le développement d'un plan d'action GIRE
Afin d'établir un cadre de gestion des ressources en eau durable et tenant compte des risques pour le bassin de la Lukaya, des mesures basées sur les écosystèmes sont intégrées dans un plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). L'Association des utilisateurs du bassin de la rivière Lukaya (AUBR/L) a élaboré le plan avec le soutien du PNUE et d'un expert international et est responsable de sa mise en œuvre.
Le plan présente une série d'actions prioritaires sous quatre piliers principaux : l'eau, l'environnement, l'aménagement du territoire et la gouvernance. La promotion d'approches de gestion durable des écosystèmes dans le cadre général de la gestion intégrée des ressources en eau fait partie intégrante du plan d'action.
L'élaboration du plan d'action de la GIRE a mis l'accent sur l'importance de relier les communautés en amont et en aval et de renforcer leur connaissance des conditions géographiques et socio-économiques au sein de leur bassin fluvial commun. La cartographie participative en 3D a été utilisée pour cartographier les risques, les types d'utilisation des sols, les ressources naturelles et pour identifier les principaux problèmes environnementaux et les zones à risque dans le bassin, par le biais d'une approche participative multipartite.
En outre, une surveillance de l'érosion des sols et de l'hydrométéorologie a été mise en place pour permettre la modélisation des risques d'inondation. Cela permettra d'établir des bases de référence et de fournir des données pour informer la planification de la gestion intégrée des ressources en eau.
Facteurs favorables
Le projet Eco-DRR a été mis en œuvre conjointement avec un projet de gestion intégrée des ressources en eau financé par l'UNDA dans la même région.
La cartographie participative en 3D est un excellent outil car elle facilite l'intégration des connaissances spatiales locales aux données topographiques grâce à la participation de nombreux acteurs et à l'utilisation de systèmes d'information géographique.
La cartographie participative en 3D est un excellent outil car elle facilite l'intégration des connaissances spatiales locales aux données topographiques grâce à la participation de nombreuses parties prenantes et à l'utilisation de systèmes d'information géographique.
La participation soutenue des utilisateurs locaux des cours d'eau, par l'intermédiaire de l'AUBR/L, a été un ingrédient clé de la promotion réussie de l'éco-RSE par le biais de la GIRE en RDC.
Leçon apprise
Le processus de planification de la GIRE a été intensif et il a fallu près d'un an pour produire le premier projet.
L'approche communautaire (par l'intermédiaire de l'AUBR/L) est appropriée en raison de la faible présence de l'administration technique centrale au niveau local dans la RDC post-conflit. Le fait de disposer d'une institution de gestion de l'eau existante a été une chance et a permis de réunir les principales parties prenantes en amont et en aval et de renforcer les relations de collaboration. L'obtention de l'adhésion a été cruciale pour l'élaboration du plan et pour les activités, telles que l'installation de systèmes de surveillance sur les terres.
Plusieurs ateliers multipartites et des actions de sensibilisation ont été organisés dans le cadre de ce processus. Les participants ont ainsi pu apprécier le bassin comme un paysage partagé et identifier des priorités communes pour une gestion durable des bassins versants, qui contribue également à la résilience face au climat et aux catastrophes.
Agroforesterie et reboisement
Le reboisement et la revégétalisation ont été entrepris sur des pentes dégradées et autour d'un site de traitement des eaux afin de réduire l'érosion et les risques d'inondation. Des pépinières communautaires ont été créées afin de fournir des plants pour le reboisement et l'agroforesterie.
L'agroforesterie communautaire a été mise en place sur 15 hectares afin d'apporter un soutien supplémentaire aux moyens de subsistance de 20 ménages. Elle est basée sur un cycle de rotation de 8 ans de culture et de sylviculture (sur 8 parcelles, une ajoutée chaque année), ce qui permet une gestion durable des terres et la réduction de l'érosion des sols. Trois types de plantes sont cultivés dans une parcelle donnée, à savoir l'acacia, le manioc et le niébé, qui apportent des bénéfices complémentaires. L'apiculture est également pratiquée. Le produit de tout cela augmente le revenu annuel de tous les ménages, qui le gèrent ensemble. Les ménages, le propriétaire foncier et l'association ont conclu un accord selon lequel 50 % des rendements reviennent aux agriculteurs, 25 % à l'association et 25 % au propriétaire foncier.
Revenu attendu d'un hectare, année 1 : 3 000 USD provenant de la production de 100 sacs de charbon de bois à partir de souches + 6 250 USD provenant de la récolte de 2 500 kg de niébé ; année 2: 9 615 USD provenant de 6 410 kg de manioc ; années 3 à 7: 7 000 USD pour 1 000 litres de miel ; année 8: 35 000 USD pour 1 750 sacs de charbon de bois produits à partir d'acacias matures.
Facteurs favorables
La méthode d'évaluation "Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs" (InVest) a été utilisée pour déterminer les sites d'intervention sur le terrain en modélisant le potentiel d'érosion du sol en fonction de différentes options de gestion. Les exigences relativement faibles en matière de données du modèle InVest et le fait qu'il prenne en compte les caractéristiques géophysiques et écologiques de la zone pour mesurer le potentiel d'érosion du sol font que le modèle InVest convient parfaitement à la planification de l'EbA/Eco-DRR et aux pays pauvres en données.
Leçon apprise
Il est important pour l'adhésion de la communauté d'offrir des avantages multiples et d'en fournir des preuves tangibles. Avant le projet, la production de charbon de bois et l'agriculture sur brûlis constituaient les principales activités. Les agriculteurs ne connaissaient pas l'agroforesterie et estimaient que les terres choisies pour le projet ne se prêtaient pas à l'agriculture.
Le succès global du projet a été démontré par la forte adhésion de la communauté aux interventions, guidée par des partenaires locaux expérimentés, et par le taux de survie élevé (98 %) des arbres agroforestiers plantés.
Toutefois, comme il s'agissait de sites de démonstration, les membres de la communauté qui n'ont pas été choisis et qui n'ont donc pas eu accès aux avantages ont été mécontents. Dans un cas, un feu a été délibérément allumé pour détruire un site de reboisement. À l'avenir, il est donc important de tenir compte des sensibilités locales et de veiller à ce que les bénéfices du projet soient partagés aussi largement que possible, afin de minimiser les conflits entre les utilisateurs des ressources. Cela met également en évidence les limites des projets pilotes.
Lutte contre le ravinement et l'érosion du sol
Il était important de réduire l'érosion des ravines pour limiter l'envasement des sources et des cours d'eau dans les zones de basse altitude et la destruction des infrastructures. Afin de traiter et d'arrêter la formation des ravines, le projet a mis en œuvre une technique de bio-ingénierie utilisant le vétiver, une herbe connue pour ses racines profondes qui peuvent contrôler efficacement l'érosion du sol. Dans cette méthode, des sacs remplis de terre sont compactés dans les ravines afin d'arrêter leur progression. Le vétiver est planté dans les sacs remplis de terre supérieure (remplie de terre fertile). Les sacs se détériorent normalement sous l'effet du soleil, mais les racines du vétiver maintiennent le sol en place.
Les berges des rivières ont également été stabilisées avec de l'herbe de vétiver après avoir enlevé les saillies inégales et adouci la pente. Des pépinières de vétiver ont été créées pour approvisionner les deux zones de travail (près de la station d'épuration et près de Kinshasa).
Facteurs favorables
Une organisation caritative locale près de Kinshasa, où les terrains disponibles pour les projets communautaires sont limités, a fourni un espace pour une pépinière de vétiver.
Leçon apprise
L'utilisation du vétiver pour le contrôle des ravines et de l'érosion du sol a également été très fructueuse, car les résidents locaux ont immédiatement perçu la valeur de protection offerte par le vétiver, en particulier lorsque les sites sont situés à proximité de leurs maisons, écoles ou routes publiques. Avant le projet, les communautés du bassin ne connaissaient pas l'efficacité du vétiver comme mesure de contrôle de l'érosion. Aujourd'hui, les communautés voisines se sont montrées très intéressées par la reproduction de la méthodologie de bio-ingénierie.
Renforcement des capacités
Comme il s'agissait de la première expérience de la RDC dans l'application de l'approche Eco-DRR et de l'approche GIRE, il était essentiel de développer et de renforcer progressivement les capacités au fil du temps, ce qui impliquait :
- Sensibilisation ;
- des formations et des ateliers ;
- des activités d'apprentissage pratique dans les sites de démonstration sur le terrain
- des visites de terrain et des voyages d'étude dans le pays et dans la région.
Au total, 71 formations et ateliers ont été organisés. Ceux-ci comprenaient des réunions générales (lancement et présentation), des ateliers nationaux de sensibilisation à l'éco-RSE et à la GIRE, des ateliers relatifs à la GIRE, au rôle de l'éco-RSE dans la GIRE et à la planification des actions, des formations sur la surveillance hydrométéorologique, la surveillance de l'érosion des sols et la modélisation des risques d'inondation, des formations sur l'agroforesterie et la production de chaînes de valeur, ainsi que des formations sur la surveillance des pertes de sol et la bio-ingénierie visant à réduire l'érosion des sols.
Facteurs favorables
Le projet a souligné l'importance de relier le groupe local AUBR/L aux ministères du gouvernement national concernés et à d'autres partenaires, dont les capacités ont également été renforcées afin que le travail soit durable dans le temps.
Le projet a également créé de nouveaux partenariats qui ont facilité les voyages d'étude dans le pays et dans la région.
Leçon apprise
Une grande partie du renforcement des capacités a eu lieu sur le terrain, dans le cadre de l'apprentissage par la pratique, grâce à la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Si ces formations étaient destinées à soutenir les interventions sur le terrain, elles étaient également conçues pour mettre en place des systèmes gérés localement et durables. Par conséquent, des formations ont également été ajoutées en fonction des besoins identifiés au cours de la mise en œuvre du projet. Par exemple, il a été constaté que les capacités devaient être renforcées sur la manière de vendre les produits de l'agroforesterie (et pas seulement sur la manière de mettre en œuvre l'agroforesterie) et sur la gestion des feux de brousse après qu'un incendie ait détruit un site de reboisement.
Soutenir les actions de plaidoyer nationales sur les mesures fondées sur les écosystèmes
Pour soutenir le gouvernement de la RDC dans sa transition nationale vers la GIRE, une feuille de route a été élaborée pour guider le développement d'une politique nationale de l'eau. La feuille de route décrit les principales orientations et les étapes nécessaires à l'élaboration de la politique nationale de l'eau, les principales parties prenantes impliquées, un plan de travail initial et une stratégie de mobilisation de fonds. La RRC est également soulignée dans la feuille de route comme un thème prioritaire, au même titre que le renforcement des capacités et la coordination intersectorielle. Cette feuille de route est influencée par l'expérience de la GIRE à Lukaya et fait spécifiquement référence à la RRC et au rôle des communautés locales dans la GIRE.
Un groupe de travail national sur l'éco-RRC a également été créé à la demande du gouvernement, qui souhaitait mettre en place une plate-forme nationale sur la RRC.
Facteurs favorables
Les démonstrations sur le terrain, les ateliers et les formations ont permis de susciter un dialogue national sur l'éco-réhabilitation.
Leçon apprise
Le succès du projet dans la sensibilisation à l'Eco-DRR dans le pays a été démontré lorsque le gouvernement de la RDC a pris l'initiative de promouvoir les approches basées sur les écosystèmes au cours des discussions préparatoires sur le cadre mondial post-2015 sur la RRC, devenu le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Le gouvernement de la RDC s'est pleinement approprié la promotion des approches Eco-DRR par le biais de la GIRE.
Impacts
L'érosion des sols et des ravines a été atténuée dans les sites pilotes, réduisant ainsi le risque d'inondation. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues sur la région en 2015 pendant la mise en œuvre du projet n'ont pas aggravé les ravines, ce qui prouve que le contrôle de l'érosion a été efficace. L'approvisionnement en eau potable est protégé.
Les communautés sont plus résilientes grâce à l'augmentation des revenus et à la diversification des moyens de subsistance (par exemple, l'apiculture et la culture d'arbres fruitiers). En effet, le système agroforestier communautaire mis en place depuis 8 ans garantit de nouvelles récoltes de niébé et de manioc, et la vente de charbon de bois produit à partir des champs agroforestiers défrichés a permis d'augmenter les revenus des 20 ménages participants.
Les parties prenantes locales et nationales sont en mesure de concentrer davantage d'efforts sur la prévention des catastrophes et de s'attaquer aux multiples facteurs de dégradation des écosystèmes dans le bassin de la Lukaya qui contribuent aux risques de catastrophes. Le projet a permis de renforcer l'engagement national en faveur de l'intégration de l'éco-RSE dans les politiques nationales de développement, y compris l'élaboration de la politique nationale de l'eau.
Bénéficiaires
1 400 habitants (zones de Ntampa, Kasangulu, Kimwenza et Mafumba du bassin versant de la Lukaya) sur une population totale de 80 000 habitants dans le bassin de la Lukaya.
Objectifs de développement durable
Histoire

Mis en œuvre de 2013 à 2016 dans le bassin de la rivière Lukaya en collaboration avec le gouvernement de la RDC, les communautés locales et les institutions académiques, et financé par la Commission européenne, le projet s'est efforcé de protéger et de réhabiliter l'un des principaux bassins versants fournissant de l'eau potable à la capitale tentaculaire de Kinshasa. Outre la protection de l'approvisionnement en eau potable, l'approche intégrée du projet permet de relever plusieurs défis fondamentaux en matière de développement, notamment les moyens de subsistance et la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la réduction des risques de catastrophe.
L'Association des usagers du bassin de la Lukaya (AUBR/L) était le principal organe de mise en œuvre du projet, qui a d'abord été renforcé, aidé à acquérir une identité juridique et restructuré. L'AUBR/L a été soutenue pour développer un plan d'action GIRE (2016-2018), qui fournit une feuille de route pour la gestion des ressources en eau dans le bassin versant de la Lukaya, y compris des mesures basées sur l'écosystème.
Le projet a mis en œuvre un certain nombre de mesures fondées sur les écosystèmes dans les zones en amont et en aval en tant que démonstrations pilotes de mesures fondées sur les écosystèmes pour l'adaptation et la réduction des risques de catastrophe dans le cadre de l'approche de la GIRE :
En amont: À la source de la rivière près du village de Ntampa dans la province du Kongo Central - Les activités dans cette zone se sont concentrées sur la revégétalisation par l'agroforesterie communautaire et le reboisement pour réduire l'érosion du sol et la sédimentation dans la rivière Lukaya à la source ; la mise en place d'instruments hydrométéorologiques et de surveillance du débit de la rivière et d'un centre d'information Eco-DRR/IWRM.
En aval: Dans le sous-bassin versant de Mafumba, près de Kinshasa, qui connaît un risque élevé d'érosion des sols et d'urbanisation anarchique - les activités à Mafumba se sont concentrées sur le pilotage d'une méthodologie de surveillance de l'érosion des sols et sur le contrôle de l'érosion des ravines par la bio-ingénierie (avec du vétiver) ; à Kimwenza - du vétiver et des arbres ont été utilisés pour contrôler l'érosion des berges de la rivière et établir une zone tampon verte à la station de traitement de l'eau. Le bureau du comité en aval de l'AUBR/L a également été installé dans l'enceinte de la station d'épuration.
Un certain nombre d'ateliers et de formations ont été organisés pour renforcer les capacités aux niveaux local et national, et des visites de terrain et des voyages d'étude ont également eu lieu dans le pays et dans la région. Tout cela a permis et soutenu le développement de la politique nationale de l'eau et la politique nationale et mondiale sur la RRC après 2015.