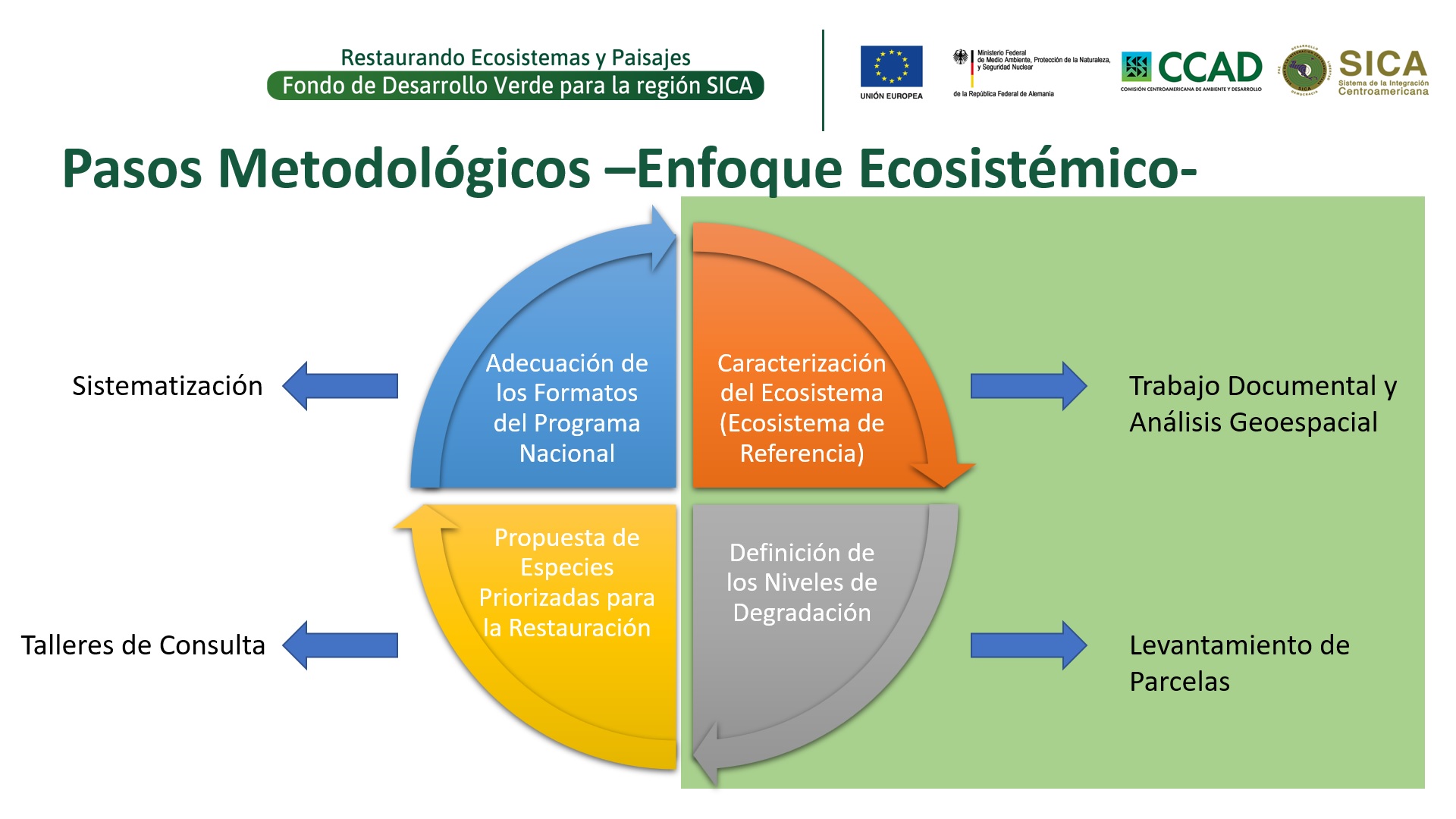Intégration des mesures de développement du café dans les politiques forestières
L'objectif de ce volet est de développer des politiques de gestion agroforestière adaptées à la culture du café et de les relier aux politiques de développement forestier du pays, en répondant aux défis du marché et de la législation internationale en vigueur.
En substance, il est nécessaire de promouvoir des politiques incitatives (économiques et/ou commerciales) qui stimulent l'agroforesterie dans les plantations de café et, en même temps, les chaînes de valeur du secteur forestier comme le petit bois.
Pour ce faire, deux éléments principaux sont nécessaires :
- La capacité d'ajuster les programmes forestiers pour intégrer des éléments d'agroforesterie, sans nuire à la production de café mais en maintenant l'esprit de la politique forestière.
- La promotion du dialogue intersectoriel autour de la question de l'agroforesterie dans les plantations de café, afin d'identifier les points de coïncidence technique et politique.
Pour illustrer cet élément de base, on utilise le cas du programme d'incitations forestières du Guatemala -PROBOSQUE- qui a ajusté la modalité des incitations forestières à la modalité agroforestière, en changeant les paramètres pour inclure la culture du café, ce qui a eu un plus grand impact.