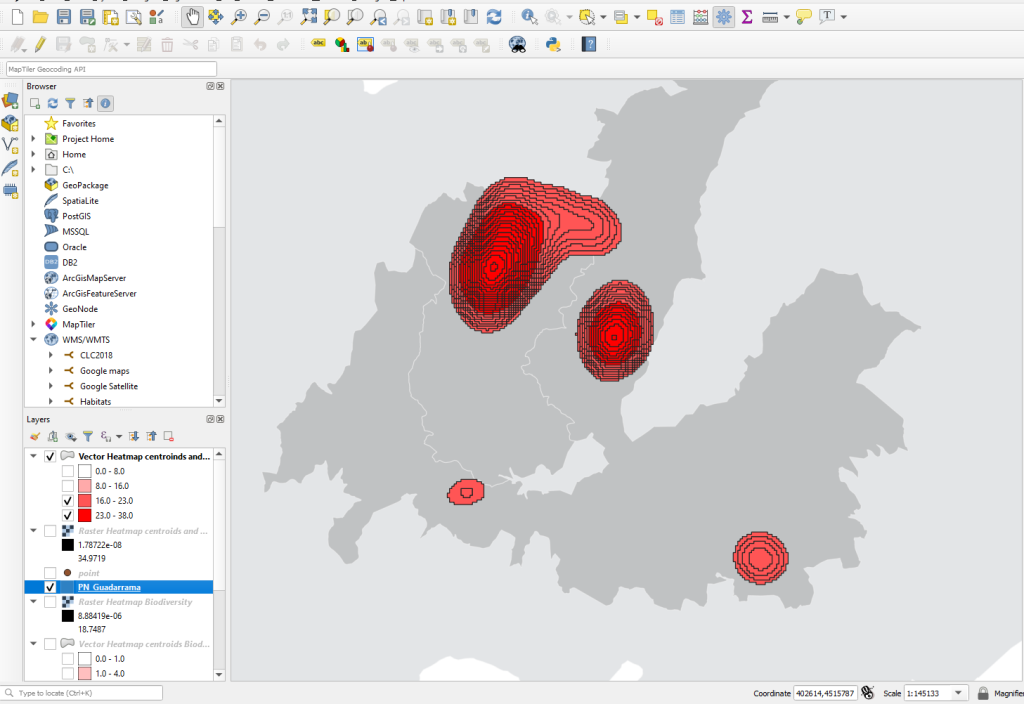Documenter les connaissances écologiques traditionnelles en matière de pêche, de rituel ou d'autres activités communautaires liées aux barrages en pierre.
Le patrimoine culturel subaquatique des déversoirs en pierre est né à l'origine d'un mécanisme de pêche local. Les processus sont basés sur une riche connaissance écologique traditionnelle locale, qui a été apportée par les membres des communautés côtières locales. Traditionnellement, les communautés locales utilisaient les déversoirs en pierre deux fois par mois pendant la marée de printemps, une coutume qui a permis d'éviter la surpêche par les habitants. À marée haute, ils servaient parfois d'étangs à poissons.
Les connaissances écologiques traditionnelles, par exemple sur les périodes de non-pêche, ainsi que sur les activités rituelles liées à la pêche, telles que les cérémonies d'ouverture des plages, sont largement observées dans les communautés côtières, mais elles disparaissent rapidement avant d'avoir été correctement enregistrées par les anthropologues ou les archéologues. Les déversoirs en pierre étant facilement brisés par les typhons ou les fortes vagues, il est absolument nécessaire de procéder à des réparations fréquentes, menées par les communautés et basées sur les connaissances traditionnelles. Si les déversoirs en pierre sont abandonnés, l'esprit communautaire et les connaissances écologiques traditionnelles disparaîtront.
Les connaissances écologiques traditionnelles, que chaque communauté côtière possède, sont non seulement la clé de la conservation des barrages de marée en pierre, mais aussi de leur bien-être. Les fruits de mer provenant des barrages à marée sont durables et plus sains que les aliments importés en conserve ou transformés.
Grâce à des partenariats formels et informels entre les universités et les communautés côtières, l'éducation des jeunes générations à ces connaissances est l'un des principaux facteurs de réussite de la préservation des connaissances écologiques traditionnelles.
Les déversoirs en pierre assurent la prospérité et la durabilité des communautés côtières, et les efforts de documentation contribuent à renforcer les capacités locales et le capital social à long terme.
La collecte de données sur ces barrages et les connaissances écologiques traditionnelles qui s'y rapportent se fait à la fois sur le terrain et dans les archives et les bibliothèques. Dans ce dernier cas, il se peut que ces connaissances n'existent que dans des documents d'archives écrits, car de nombreuses communautés ont perdu leurs traditions à cause de la modernisation et de la mondialisation.