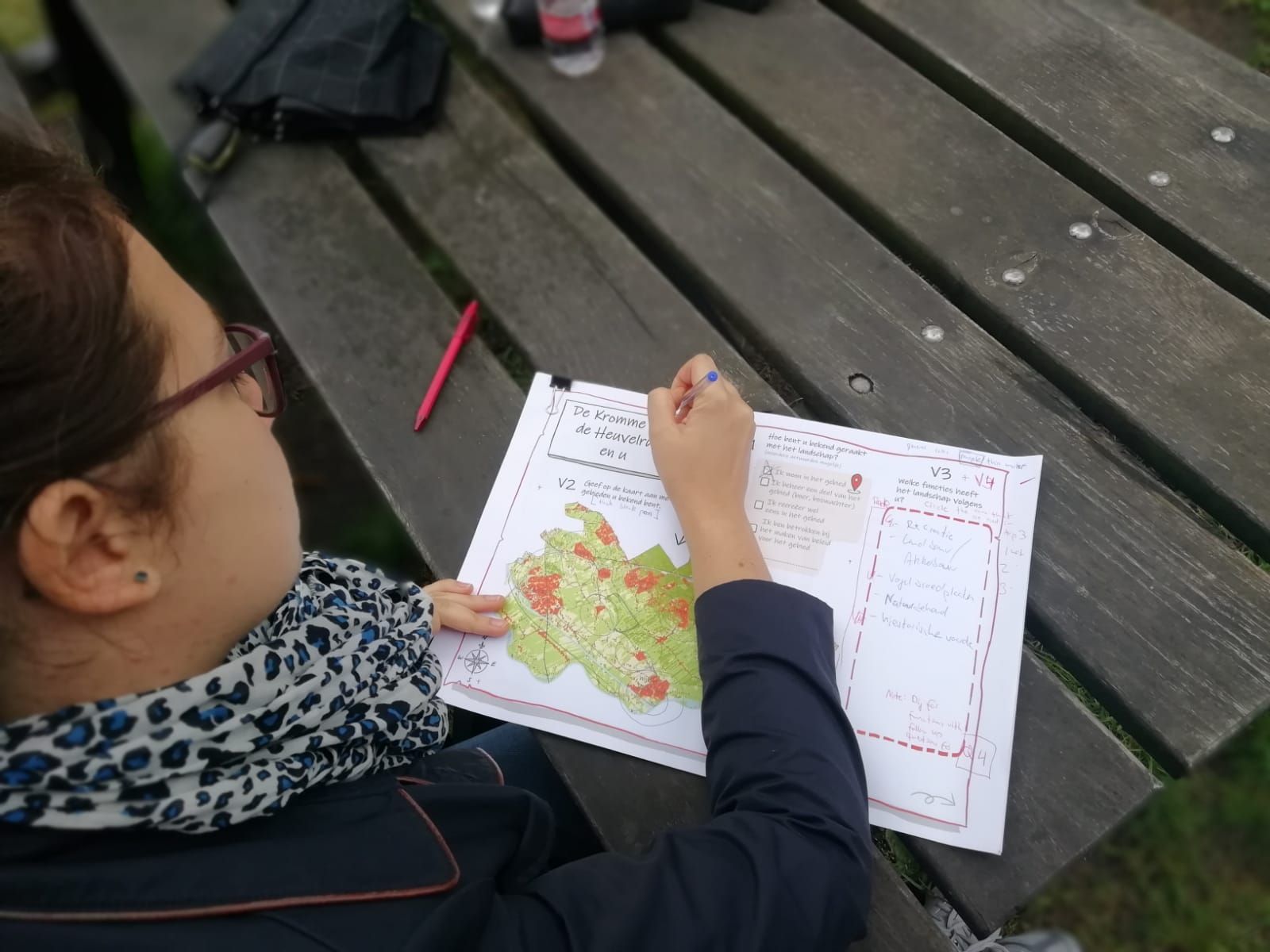Mise en place d'un modèle de gouvernance partagée entre l'université et la municipalité
Création d'une équipe pluridisciplinaire
Participation des nouveaux professionnels du patrimoine et des chercheurs
Recherche sur le patrimoine axée sur la pratique