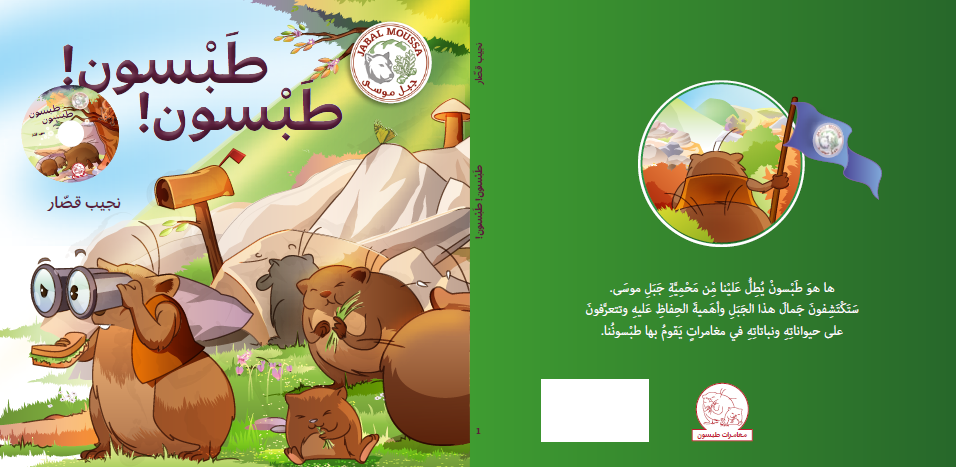S'efforcer d'être enraciné localement, participatif et adaptatif, tout en étant connecté à l'échelle mondiale
Présentation de Jabal Moussa lors de l'événement parallèle du Med MAB au 4ème Congrès mondial des réserves de biosphère à Lima, 2016
UNESCO
Témoignage d'une femme locale lors du lancement de la cuisine de Jabal Moussa, en présence d'un représentant de l'UNESCO et des maires locaux.
APJM
L'"approche hélicoptère" fait désormais partie de notre philosophie et constitue une clé importante de la réussite dans les zones protégées. En tant qu'ONG, nous oscillons constamment entre le local et l'international, et nous visons à être enracinés localement, tout en étant connectés universellement.
Nous nous efforçons de trouver un équilibre entre les atouts, les compétences et les besoins locaux, d'une part, et les concepts et l'expertise internationaux, d'autre part, sans devoir nous arrêter à un quelconque "intermédiaire".
Nous cherchons à être adaptatifs et collaboratifs dans notre gestion de la réserve : nous recherchons les conseils des locaux pour adapter les techniques et les recommandations à notre contexte local.
Notre personnel et les membres de notre conseil d'administration sont principalement des résidents locaux ; nous avons des liens directs avec les parties prenantes locales et nous privilégions les relations personnelles plutôt que les chiffres dans le cadre d'enquêtes à grande échelle. D'autre part, nous visons à adapter les concepts internationaux du Programme sur l'homme et la biosphère, et nous cherchons à jouer un rôle actif dans les réseaux régionaux et internationaux, et à établir des partenariats avec des donateurs multilatéraux et des fondations internationales.
Nous pensons qu'en étant enracinés localement et connectés internationalement, nous sommes devenus des partenaires dignes de confiance à ces deux niveaux.
Disposer d'une équipe locale, connaissant bien la région, est une condition préalable. Une communication transparente et une relation directe avec des acteurs de divers horizons ont été essentielles et ont permis à l'équipe d'aller plus loin que de s'appuyer sur des "intermédiaires".
La volonté d'apprendre et de contribuer aux réseaux régionaux et internationaux, et le fait d'avoir une équipe spécialisée dans différents aspects (développement, conservation, communication...), ainsi que d'avoir des homologues encourageants (secrétariats de l'UNESCO et de l'UICN), nous ont permis d'être connectés au niveau international.
Le processus d'établissement et de maintien de relations à tous les niveaux peut s'avérer fastidieux et chronophage. Il est cependant important de s'y investir car, à long terme, il est gratifiant pour toutes les parties concernées.
La présence sur le terrain est aussi importante que la présence aux conférences : il est essentiel d'apprendre des gens sur le terrain et de tirer des enseignements des autres expériences, ce qui peut être réalisé grâce à une communication approfondie entre les membres de l'équipe.
Plus nous sommes ciblés dans notre processus, plus nous réussissons. Par exemple, nous avons tenté de travailler une fois avec les agriculteurs locaux (non ciblés), en les invitant par le biais d'un message groupé à plusieurs sessions de formation importantes, mais non ciblées. La participation a été modeste et la relation avec les agriculteurs n'a pas été maintenue.
En revanche, lorsque nous avons travaillé avec les apiculteurs, nous avons commencé par des visites individuelles à chacun des 51 apiculteurs, en notant leurs besoins, leur échelle de travail, leurs techniques. Une relation s'est établie. Cela a conduit à la mise en œuvre de plusieurs interventions réussies, et le contact personnel est régulièrement maintenu.