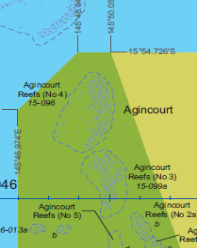Collaboration public-privé pour la conservation
entreprises. En collaboration avec les entreprises touristiques partenaires, DICT mène des activités de recherche, de conservation et d'éducation dans l'environnement marin du district de Gansbaai, dans la province du Cap-Occidental. Les projets de DICT se concentrent sur le Big 5 marin - manchot africain, grand requin blanc, baleine franche australe, otarie à fourrure du Cap, dauphins - autour de l'île de Dyer. L'île Dyer est une colonie de reproduction pour le manchot africain, une espèce menacée, et une zone importante pour la conservation des oiseaux. La collaboration fructueuse dans le cadre de ce partenariat public-privé s'est développée de manière organique et est propre au contexte et au paysage des parties prenantes de cette destination particulière. Toutefois, il est tout à fait possible de reproduire ce modèle en identifiant la valeur touristique essentielle d'une attraction basée sur un écosystème donné, en sensibilisant largement toutes les parties concernées d'une destination à cette valeur, puis en élaborant une stratégie commercialement et écologiquement efficace et en créant un organe de gouvernance multipartite autour de cette valeur.
o Réussir les entreprises commerciales en réinvestissant constamment les bénéfices dans les entreprises : Le suivi de la recherche pour permettre la conservation des écosystèmes côtiers et marins, qui constituent le principal atout du modèle d'entreprise sur la côte du Cap-Baleine. De même, l'investissement dans des bateaux plus grands et dans d'autres biens matériels serait superflu si le capital naturel continuait à s'éroder.
o Partenariats avec d'autres entreprises de la destination, des voyagistes, d'autres entreprises non touristiques, le gouvernement local, des organisations à but non lucratif telles que le tourisme équitable et le grand public.
Si le Trust a contribué à mieux faire connaître cette incroyable zone marine, aucun des travaux de conservation, de recherche et d'éducation n'aurait été possible sans des entreprises commerciales prospères. Par exemple, la saisie quotidienne de données et les observations d'animaux marins et d'oiseaux de mer ont permis de tirer des conclusions sur leur comportement et ont donné lieu à d'importantes publications scientifiques. Les fonds destinés au Trust sont également collectés par les entreprises, ce qui garantit sa stabilité financière. Le Trust vise à protéger le patrimoine marin et a été en mesure de soumettre une lettre de préoccupation concernant le projet de centrale nucléaire à Bantamsklip, à un peu plus de 22 km de son bureau en 2010. Grâce à la richesse de ses propres résultats de recherche et de ses connaissances locales, il a été possible de mettre en évidence des failles critiques dans l'évaluation de l'impact environnemental. En conséquence, l'Université de Pretoria sera consultée à l'avenir sur les espèces de cette zone et sur les éventuels programmes de surveillance.