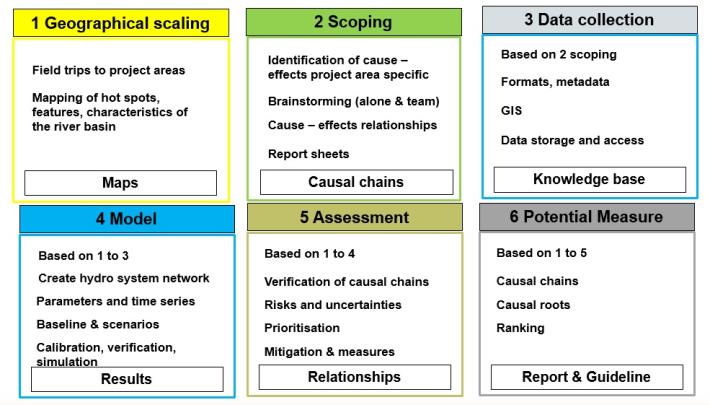Assistance technique (AT)
Contrairement au marketing social, l'assistance technique (AT) est basée sur des interactions plus personnelles avec les pêcheurs au niveau du groupe de pêche (coopératives ou associations) ou au niveau du pêcheur individuel. Cela permet d'aborder les questions de manière plus détaillée et plus approfondie, bien que de plus grands groupes de personnes ne soient pas atteints. L'objectif principal est de promouvoir le soutien des pêcheurs aux actions de conservation (par exemple, la création de zones franches, l'adoption de pratiques de pêche durables). Les outils d'assistance technique visent à renforcer les capacités des communautés côtières et à éliminer les obstacles techniques, en mettant l'accent sur le leadership des pêcheurs pour améliorer la gestion des ressources halieutiques. Parmi les exemples d'activités d'assistance technique, citons les entretiens individuels, les sorties de pêche, les échanges de pêcheurs entre les sites, la formation formelle à des méthodes de pêche spécifiques par le biais d'ateliers et de cours, la formation informelle, les réunions avec les autorités, le suivi des processus administratifs et juridiques (par exemple, le renouvellement des concessions/permis de pêche) et la fourniture de matériel organisationnel (par exemple, des classeurs, des tableaux, etc.).
- Le niveau élevé d'expérience technique et de compétences du partenaire de mise en œuvre permet des interventions d'assistance technique plus approfondies et plus détaillées avec les pêcheurs ; - Une recherche formative bien conçue, mise en œuvre et analysée soutient la définition des domaines thématiques pour l'assistance technique ; - Des partenariats avec des agences gouvernementales et des ONG pour ajouter des ressources humaines et financières et donner aux pêcheurs l'assurance que leurs efforts sont reconnus ; - La participation du public cible à la conception et à la mise en œuvre future des activités d'assistance technique pour générer l'appropriation et contribuer à réduire la résistance à l'effort de la campagne ; - Des partenariats avec des agences gouvernementales et des ONG pour ajouter des ressources humaines et financières et donner aux pêcheurs l'assurance que leur effort est reconnu.
Les interventions d'assistance technique aident la campagne à traiter les questions identifiées lors de l'étape d'élimination des obstacles, mais les interventions ne sont pas nécessairement limitées à cette étape du processus. Malgré les différences dans le contexte de chaque site de campagne, défini par les conditions du pays et de l'industrie de la pêche, des domaines thématiques très similaires ont été identifiés pour chaque stratégie d'AT.
L'établissement d'une relation de confiance avec les pêcheurs est une étape primordiale pour toutes les activités d'assistance technique. Les activités qui impliquent le plus grand nombre de pêcheurs possible génèrent un sentiment d'appropriation chez les pêcheurs et facilitent l'adoption de comportements. En outre, les pêcheurs sont habilités à assurer le suivi des accords découlant de chaque activité, à améliorer leur auto-organisation, à conclure des accords internes ou avec des tiers pour réaffirmer et garantir publiquement leurs décisions collectives, et à promouvoir leur participation à des activités qui ont un impact sur le processus décisionnel en matière de gestion des pêches.