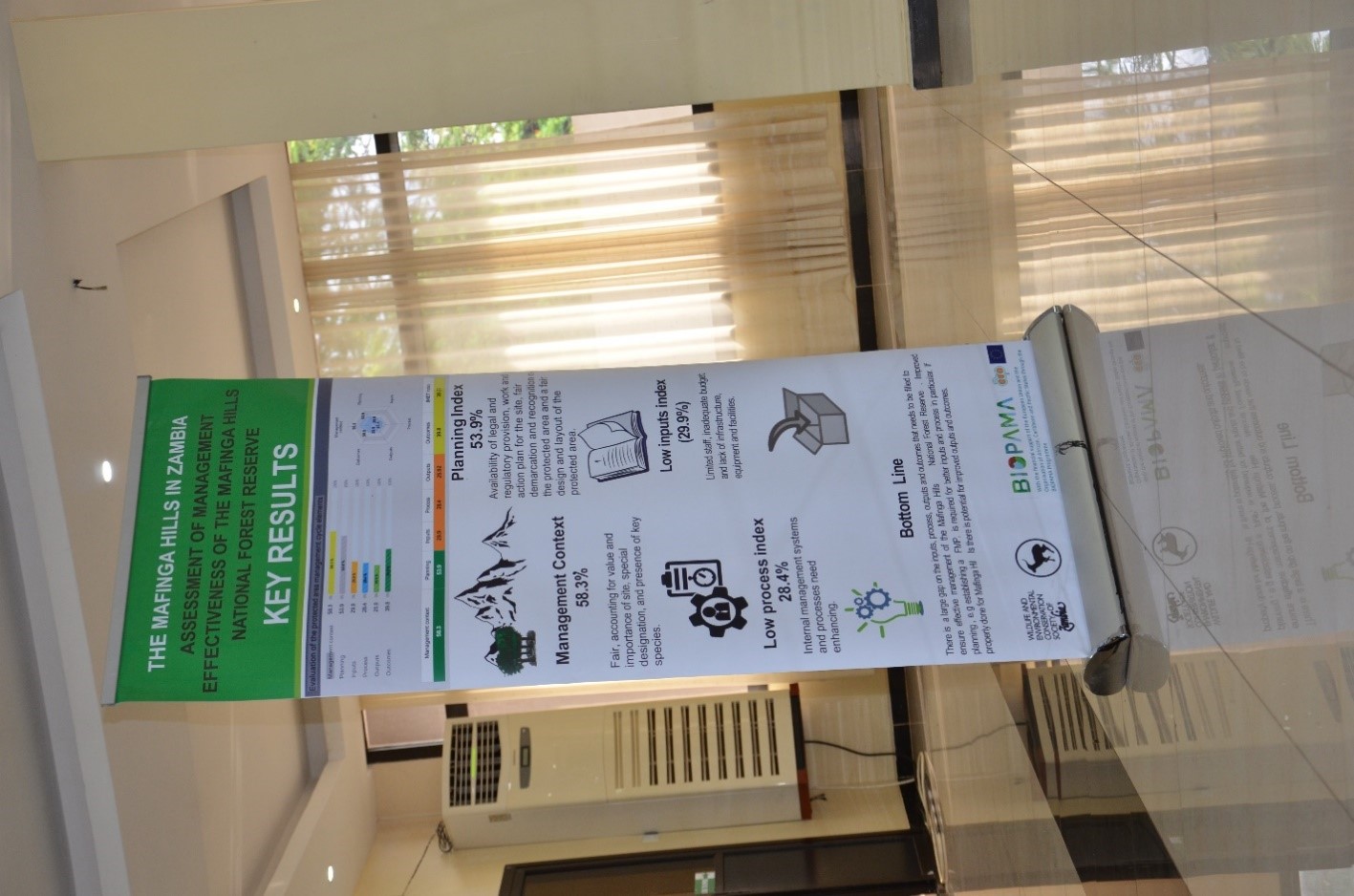Participation des hommes et des femmes au réseau de valeur de la pêche au homard
La S.C.P.P. Vigía Chico, qui est impliquée dans le projet d'amélioration de la pêche, a développé de bonnes pratiques pour parvenir à une pêche durable, mais la pêche a été perçue et gérée uniquement comme une activité d'extraction, et non comme un système complexe qui englobe d'autres étapes le long du réseau de valeur. C'est sur cette base que les coopératives ont entrepris une analyse et un diagnostic de la participation des hommes et des femmes à chaque maillon du réseau de valeur. Ainsi, il a été possible de visualiser que la composition des liens englobe des activités dans lesquelles les femmes jouent un rôle crucial non seulement parce qu'elles exercent l'activité elle-même (par exemple, l'administration, le transport, la transformation, la commercialisation, le stockage, le débarquement, la préparation des approvisionnements), mais aussi parce que les activités complémentaires (par exemple, la production de science citoyenne, la prestation de services, le soutien familial) jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de la conservation des ressources et de la pêche durable.