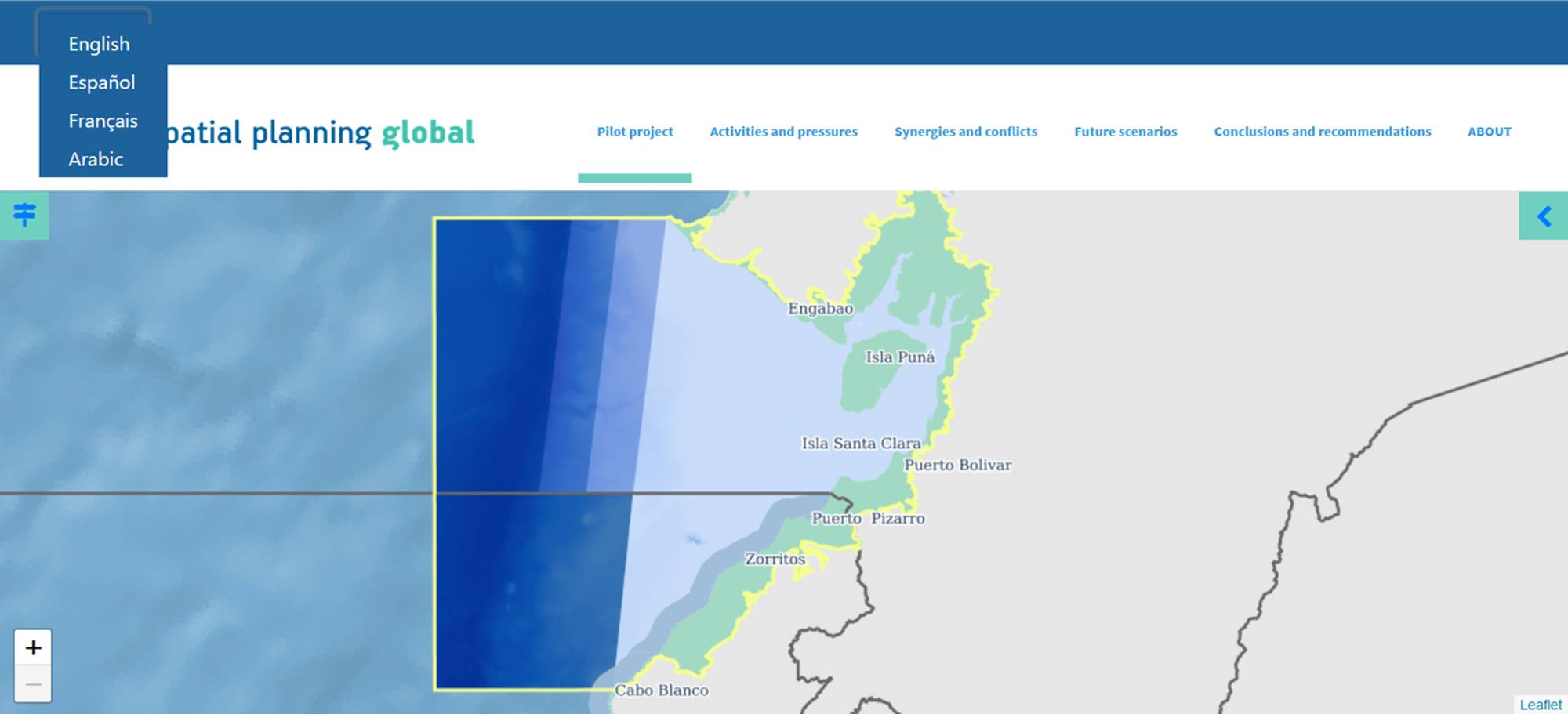La gestion participative a été mise en œuvre depuis la création de l'APN à la demande de ses communautés, dans leur intérêt et dans celui des générations futures ; toutefois, au fil du temps, ce dynamisme s'est concentré sur la conservation avec la participation spécifique de ses communautés.
Les plans de vie sont un processus participatif qui permet d'obtenir l'avis des membres de la communauté, en réfléchissant à chaque dimension (culturelle, environnementale, sociale, politique et économique), ce qui permet d'établir un diagnostic afin de coordonner les actions visant à un comportement durable, qui sont également alignées sur les objectifs et la vision du plan directeur de l'APN.
Ces visions contribuent à des actions plus pertinentes qui aident à s'articuler avec d'autres documents de planification sur le territoire et à l'implication d'un plus grand nombre d'acteurs dans le cadre d'une stratégie clé pour parvenir à une conservation efficace.
Le chef de la MRC et l'ECA Maeni développent des capacités techniques et sociales qui favorisent la participation active des communautés dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de vie, orientés vers la conservation du NPA.