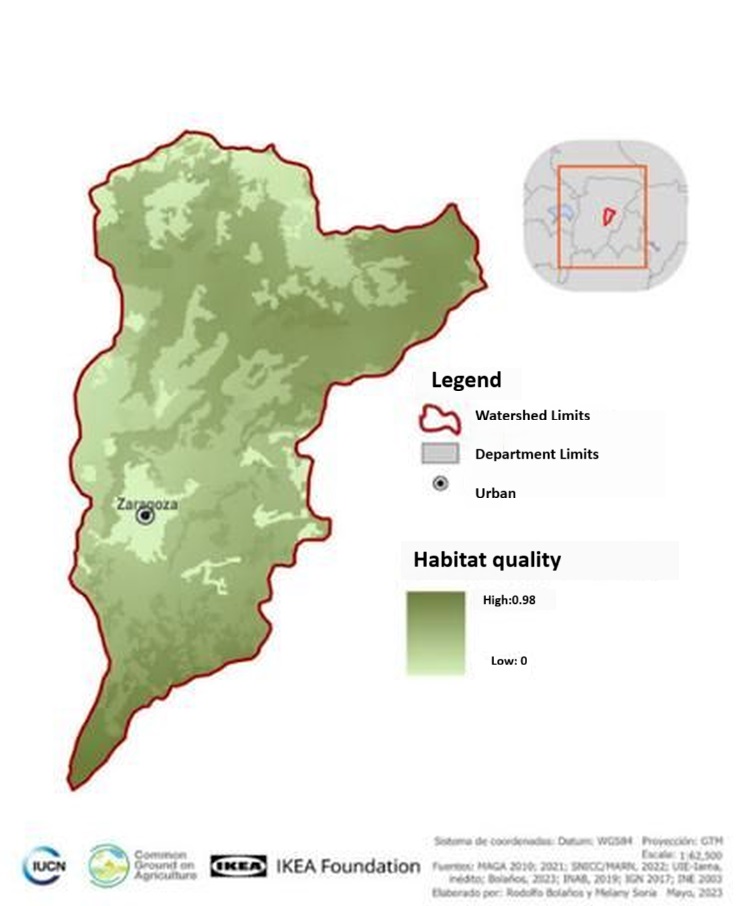Une approche collaborative et participative est essentielle à l'élaboration du matériel de formation. Pour garantir la pertinence, la praticabilité et l'appropriation, un groupe de travail est généralement constitué, comprenant des représentants des ministères, des universités, des pisciculteurs, des acteurs de la chaîne de valeur et des chercheurs. Des processus itératifs, des ateliers de validation et des consultations avec les parties prenantes sont utilisés pour affiner le matériel et s'assurer qu'il reflète les besoins locaux.
La formation doit porter non seulement sur le "comment", mais aussi sur le "pourquoi". En expliquant la raison d'être de pratiques spécifiques, telles que la réduction des impacts environnementaux ou la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les agriculteurs acquièrent une compréhension plus profonde et sont habilités à prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur les objectifs de durabilité. Il ne s'agit pas simplement de suivre des instructions, mais de favoriser la pensée critique et la résolution adaptative des problèmes.
Pour créer des entreprises résilientes et prospères, la formation doit également intégrer des éléments tels que l'éducation commerciale, les innovations tout au long de la chaîne de valeur et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelable décentralisées. Ces éléments permettent aux pisciculteurs d'améliorer leurs connaissances financières, de répondre aux défis du marché et de l'environnement, et de mettre en œuvre des solutions innovantes pour accroître la productivité et la durabilité.
Si nécessaire, des consultants peuvent être intégrés pour harmoniser les résultats et accélérer le processus, mais diverses parties prenantes du secteur et de la chaîne de valeur doivent toujours être impliquées dans la révision du contenu.
Le matériel doit être étroitement aligné sur les besoins et les priorités des institutions locales et intégré en collaboration dans les programmes d'études nationaux et les collèges de formation technique, afin de garantir à la fois la pertinence et l'appropriation locale.
En Inde, l'élaboration de matériel de formation à l'aquaculture a nécessité de nombreux ateliers et un retour d'information participatif de la part des pisciculteurs locaux, des agences gouvernementales, des ONG et des chercheurs. Ce processus de collaboration a été essentiel pour créer des sessions de formation modulaires adaptées aux contraintes saisonnières de la pisciculture, en particulier pour les femmes et les petits exploitants. Les supports ont été testés et révisés en permanence pour garantir leur pertinence. Ils ont été rédigés dans les langues locales et adaptés à l'apprentissage sur le terrain, sans recours à la technologie. Cette approche inclusive a permis aux agriculteurs de s'approprier le contenu de la formation et de garantir son efficacité à long terme.