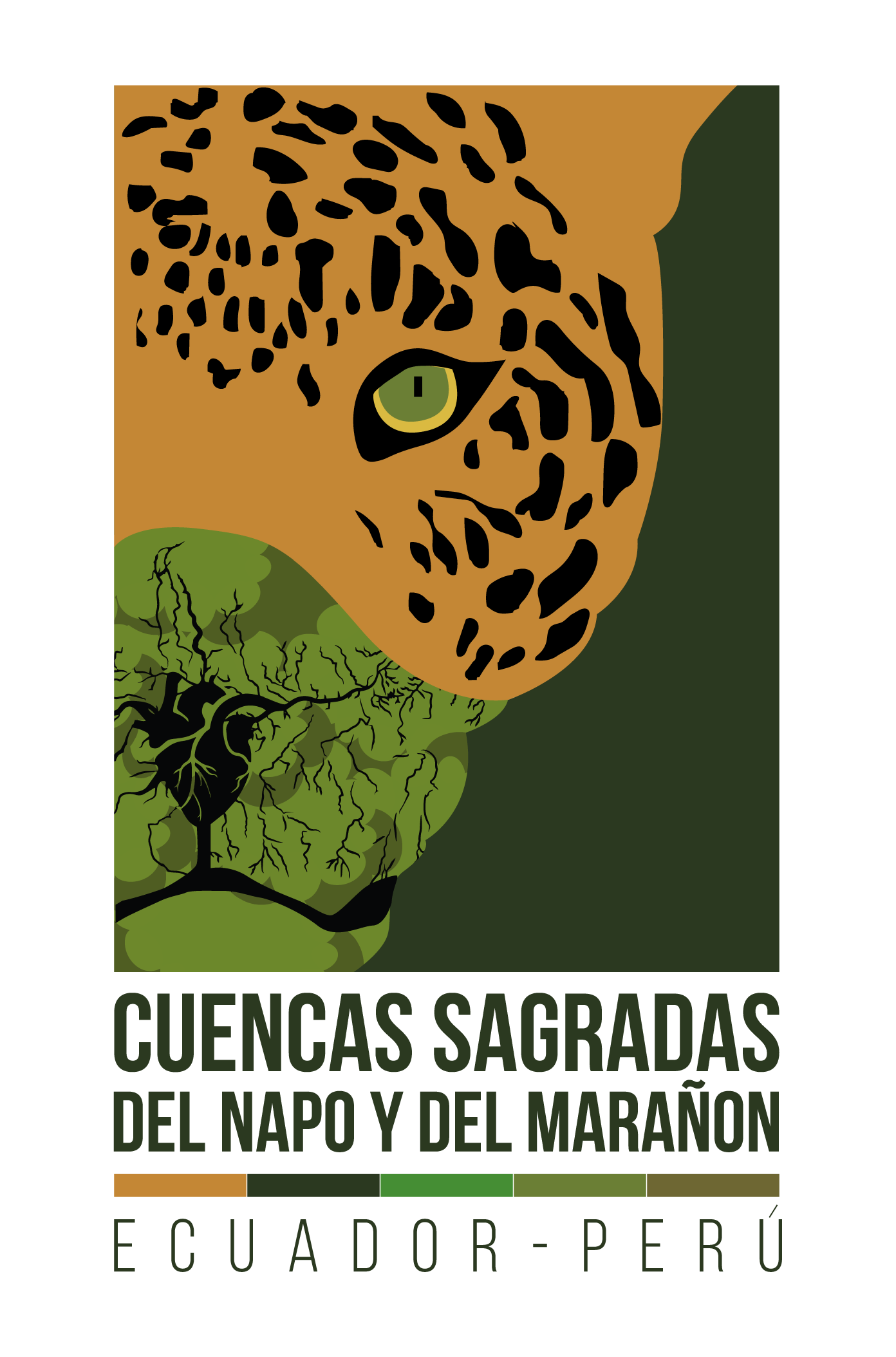Coordination intersectorielle par le biais de dialogues interministériels et multipartites
Un comité national multidisciplinaire sur la RPF a été mis en place en tant que comité consultatif, facilitant la coordination intersectorielle et interministérielle pour passer de l’engagement à la RPF à des politiques et des actions concrètes. Il s’agit de 15 personnes venant des ministères de l’environnement, de l’agriculture, de l’énergie et de l’eau, de l’aménagement du territoire et des représentants de la société civile et du secteur privé. Il est constitué de cinq groupes de travail traitant i) la gestion des forêts, ii) l'eau, iii) l'agriculture, vi) le financement et v) la gestion des sols. Il valide toutes les décisions clés. Les membres participent également en tant que personnes ressources aux activités de renforcement des capacités techniques.
Le comité a mené une évaluation des besoins des parties prenantes et des capacités, une analyse du financement et a facilité divers dialogues multipartites, et veille à ce que les intérêts des parties prenantes impliquées soient pris en compte.
Le plateforme RPF est un forum de dialogue multipartite de plus de 50 membres, dirigé par le comité RPF, pour discuter, proposer et valider des solutions pratiques pour la RPF aux niveaux régional et local et soutenir la mise en œuvre de la stratégie et du développement des capacités.