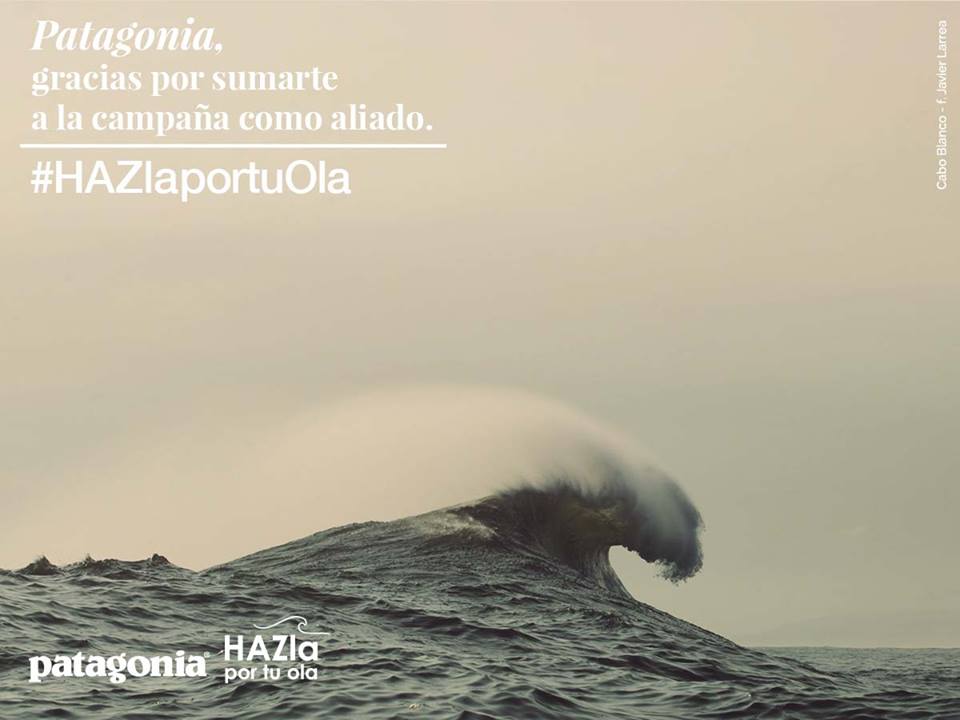Un partenariat à long terme avec les scientifiques
Depuis les années 1950, les scientifiques étudient le caractère unique des Terres australes françaises (TAF), qui constituent un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs en sciences naturelles. Les premières stations scientifiques construites à l'époque constituent aujourd'hui les chefs-lieux de districts qui accueillent chaque année plus de 200 scientifiques issus de 60 programmes de recherche. L'Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) coordonne ces activités et assure l'excellence de la recherche scientifique dans les TAF.
Depuis 1955, la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) administre ce territoire, plaçant la science et la protection de l'environnement comme pierre angulaire de la souveraineté française sur les TAF.
Consciente de la vulnérabilité de ces écosystèmes, la communauté scientifique a plaidé pour la création de la réserve naturelle des TAF et conseillé son extension en mer en 2016. La gestion de la réserve naturelle, assurée par les TAAF, s'appuie sur un comité scientifique, le Comité de l'environnement polaire (CEP), qui émet des avis sur les actions de recherche et de gestion.
Avec l'élargissement du périmètre de la réserve, le lien avec les scientifiques est plus que jamais essentiel. Le nouveau plan de gestion prévoit des activités de recherche pour une gestion adaptée et efficace des écosystèmes riches et vulnérables des TAF.
Le partenariat historique avec l'Institut Paul-Emile Victor (IPEV), coordinateur des programmes scientifiques en TAF, assure l'excellence des activités de recherche. La forte implication des partenaires scientifiques a permis la création de la Réserve Naturelle et son extension en mer grâce à un travail d'écorégionalisation. Leur rôle dans la gouvernance et dans l'élaboration du plan de gestion assure aujourd'hui la robustesse des actions de gestion.
Les organisations scientifiques étant impliquées dans la TAF depuis plus de 60 ans, l'adhésion de l'ensemble de la communauté scientifique est obligatoire pour la mise en place d'une réserve naturelle et sa réglementation. L'implication des scientifiques dans la gouvernance et la gestion de la réserve garantit l'appropriation des actions de conservation par ces acteurs majeurs.
Si les bénéfices mutuels des activités scientifiques et de conservation sont reconnus par les scientifiques et la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), une définition claire des responsabilités de chacun, avec par exemple l'établissement de conventions, est essentielle pour éviter tout conflit.
La recherche étant l'une des principales activités dans les Terres australes françaises, les impacts environnementaux des programmes scientifiques doivent être correctement évalués et validés par le comité scientifique.