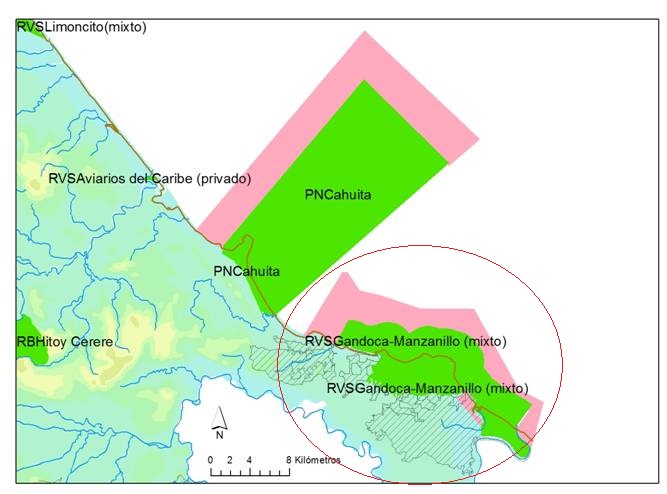Respect des cadres politiques
La politique et la législation nationales en matière de pêche prévoient la participation des pêcheurs aux régimes de gestion des pêches, ce qui est cohérent avec les politiques régionales et mondiales en matière de pêche, telles que la CCRP et le SSSF, et favorise l'implication des pêcheurs et de leurs organisations dans la gouvernance des pêches. En outre, les orientations stratégiques et les objectifs des partenaires potentiels/réalisés favorisent des relations efficaces pour le renforcement des capacités, le soutien technique et l'obtention d'un siège à la table des négociations.
- Cadre politique/juridique existant ; - Organisations ayant des intérêts convergents ; - Initiatives nationales, régionales et mondiales en matière de gouvernance de la pêche.
- La concentration, l'effort et le travail d'équipe sont nécessaires pour bénéficier d'un environnement favorable - La prise de conscience des réalités et de l'environnement existants est importante.