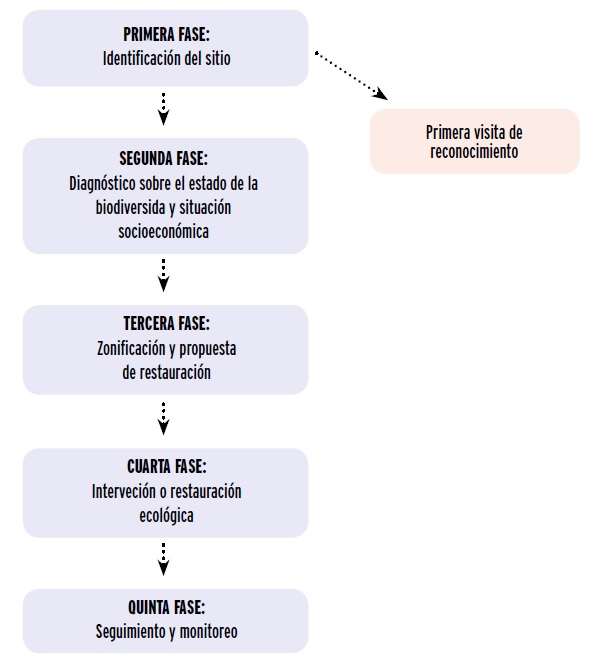Élaborer un diagnostic sur l'état de la biodiversité et le statut socio-économique
L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques les paramètres biologiques nécessaires pour déterminer l'état actuel d'un écosystème afin de déterminer les mesures de restauration appropriées à mettre en œuvre dans cet écosystème spécifique.
Le diagnostic de l'état de la biodiversité est réalisé à l'aide d'une revue documentaire et de visites de terrain, où : 1) l'identification du site, y compris la composition, la structure et les différentes strates qui composent l'écosystème, 2) la description des services écosystémiques, 3) la composition floristique, 4) la diversité des groupes de faune vertébrée et invertébrée, 5) la présence d'espèces invasives, et 6) l'identification des menaces et des facteurs de dégradation.
La situation socio-économique est étudiée à l'aide d'une revue documentaire et de visites sur le terrain, qui permettent : 1) d'identifier les utilisateurs actuels du site, 2) de décrire les activités productives menées par les utilisateurs, 3) de clarifier le statut foncier du site, 4) d'identifier les acteurs locaux présents sur le territoire, 5) d'identifier le potentiel de développement local avec des activités écologiquement durables.