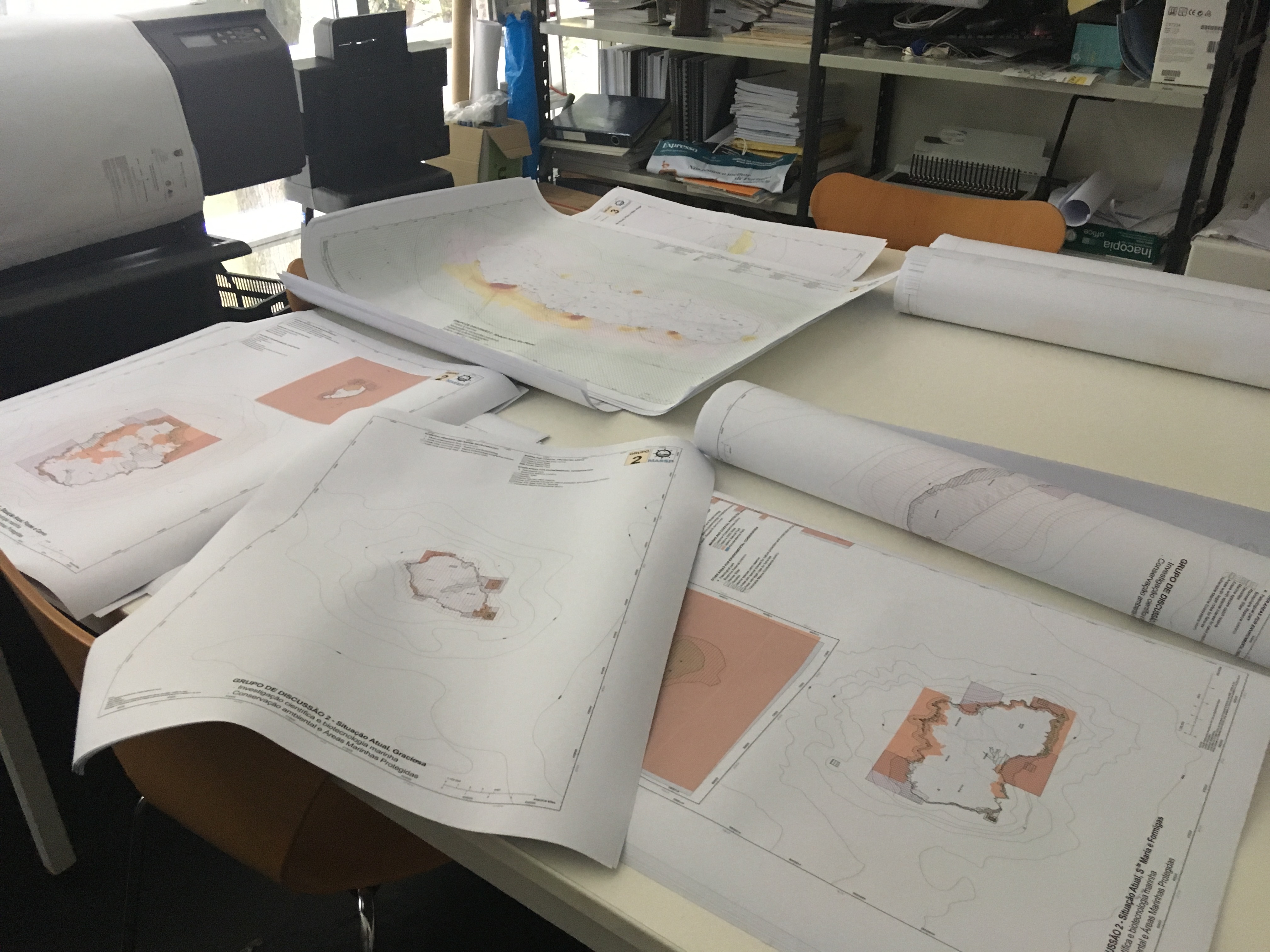Institutionnalisation de l'administration indigène
Renforcement de la capacité interne de la communauté à se constituer en gestionnaire de parc
Intégrer la compréhension et les valeurs indigènes de la nature et de la culture dans le système de gestion du patrimoine
Renforcement du département de l'archéologie et de la conservation dans le parc national