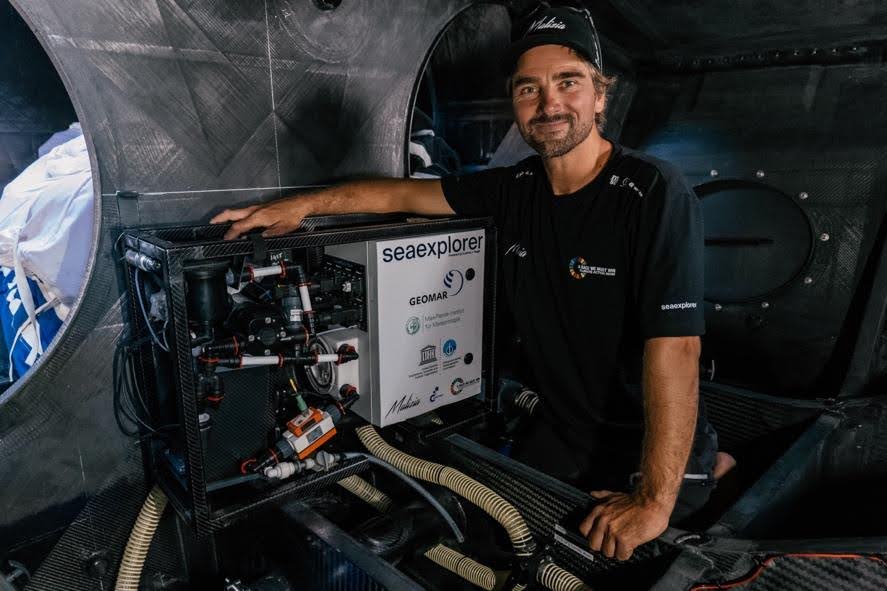Module 1 - Utiliser une initiative existante (la forêt olympique) comme modèle pour permettre aux membres des comités nationaux olympiques de lancer leurs propres projets de restauration de la nature.
Le projet de forêt olympique du CIO - une initiative de reboisement lancée au Mali et au Sénégal - a suscité l'intérêt des comités nationaux olympiques, qui ont exprimé leur souhait d'agir contre le changement climatique et de mettre en œuvre des projets similaires dans leur propre pays.
Suite à cet intérêt, le CIO a lancé le réseau de la forêt olympique, où les CNO peuvent s'appuyer sur le projet original de la forêt olympique en concevant et en mettant en œuvre leurs propres initiatives pour restaurer les forêts existantes, les corridors pour la faune et la flore, les bassins versants côtiers et les écosystèmes, ainsi que pour mettre en œuvre des projets d'agriculture régénératrice.
Le réseau s'appuie sur l'initiative de la forêt olympique du CIO et l'élargit, en aidant à mettre en évidence le travail du Mouvement olympique qui contribue à la lutte contre le changement climatique et à la conservation de la nature. Il reconnaît les projets locaux réalisés par les CNO selon les meilleures pratiques et dans le cadre du CIO. Le CIO apporte son soutien aux CNO (orientation, conseils techniques pour la candidature au réseau, ateliers, webinaires et, dans certains cas, financement), reçoit leurs projets et les évalue sur la base de critères spécifiques. Grâce à ses bureaux situés dans le monde entier, l'UICN aide le CIO à fournir un retour d'information technique sur les projets, à effectuer des visites sur le terrain et à examiner la documentation technique fournie par les CNO.
L'établissement de lignes directrices et de critères clairs pour ce type d'initiative est essentiel pour éviter la multiplication de projets de qualité médiocre ayant une faible valeur ajoutée et peu de bénéfices pour la conservation de la nature et les communautés locales. Montrer l'exemple dans ce domaine contribue à inciter le Mouvement olympique à planifier et à allouer les ressources de manière adéquate.