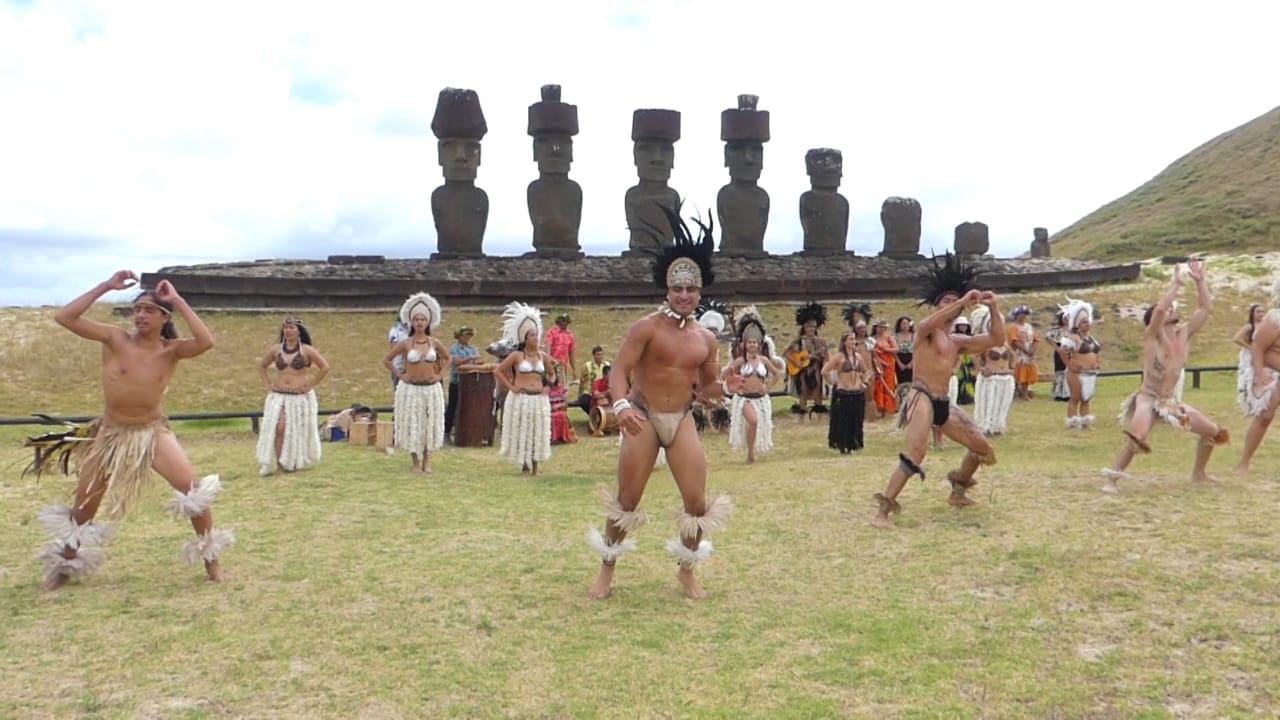ReLED - Réseau des musées Ledro
ReLED Rete Museale Ledro | Ledro Museum Network.
ReLED
Village de maisons sur pilotis.
MUSE
Le réseau ReLED Museum a été créé en 2012 grâce à une coopération entre la municipalité de Ledro, le musée des sciences de Trente et sa branche territoriale, le Pile Dwelling Museum de Ledro. Il ne s'agit pas d'une nouvelle structure mais d'un réseau de ce qui était déjà présent dans la région. Il s'agit d'une "méthode de travail" innovante qui implique directement l'agence de tourisme de Ledro et indirectement les écoles, les associations culturelles et les installations touristiques de la région.
Le réseau utilise des instruments de gestion territoriale tels que le réseau des réserves des Alpes Ledrensi et la réserve de biosphère des "Alpi Ledrensi et Judicaria", qui fait partie de la désignation MaB de l'UNESCO.
ReLED implique plus de 70 000 personnes chaque année dans des ateliers, des visites guidées et des activités de divertissement culturel qui permettent de raconter la vallée de Ledro à travers différentes disciplines : archéologie, histoire, ethnographie, sciences naturelles, géographie et paysage. Le Pale Dwelling Museum est au cœur de ces activités avec plus de 40 000 visiteurs par an.
ReLED est aujourd'hui une petite entreprise culturelle qui implique activement (y compris les gardiens, les opérateurs, les fonctionnaires, le personnel de nettoyage) plus de 20 personnes dans une zone qui compte 5500 habitants et qui est située à 50 km de la capitale régionale de Trente.
Ledro est à bien des égards une frontière. La vallée est située à la limite entre la province de Trente et la région de Lombardie. Il s'agit d'une situation avantageuse pour la ReLED car elle a permis de développer une pensée latérale, capable de dépasser les limites étroites de la discipline archéologique du musée qui a été en mesure de transformer un lieu marginal en un "centre du monde". Le ReLED est né avec une vision clé axée sur l'engagement et la promotion de multiples professionnels et expériences de travail.
Un groupe fonctionne mieux qu'une personne seule Un groupe soudé doit être stable mais aussi ouvert à ses membres. Il est important de veiller à ce que les activités exercées dans le cadre d'un emploi existant ne soient pas basées sur le volontariat.
À la base de tout, il y a la passion des gens pour ces thèmes, qui soutient le musée non seulement en tant que lieu de travail, mais aussi en tant que moyen de croissance mutuelle et lieu de satisfaction personnelle.
Le travail en réseau n'est pas facile et demande beaucoup d'efforts, il faut faire un pas en arrière pour pouvoir faire deux pas en avant ensemble.
Nous sommes conscients que seule une petite partie des visiteurs des musées sont des spécialistes du sujet (4-5%) et nous devons donc être en mesure de nous adresser à un public plus large avec un langage spécifique et approprié.
ReLED est autofinancé à hauteur de 40 %. Il contribue activement à l'économie locale en tant qu'organisation économique et culturelle qui a été capable de penser en termes économiques sans renoncer au contenu. Il est nécessaire de comprendre le développement au-delà des infrastructures.
La culture est la clé de l'économie italienne et ReLED a décidé d'investir dans ce domaine en renforçant son capital humain.