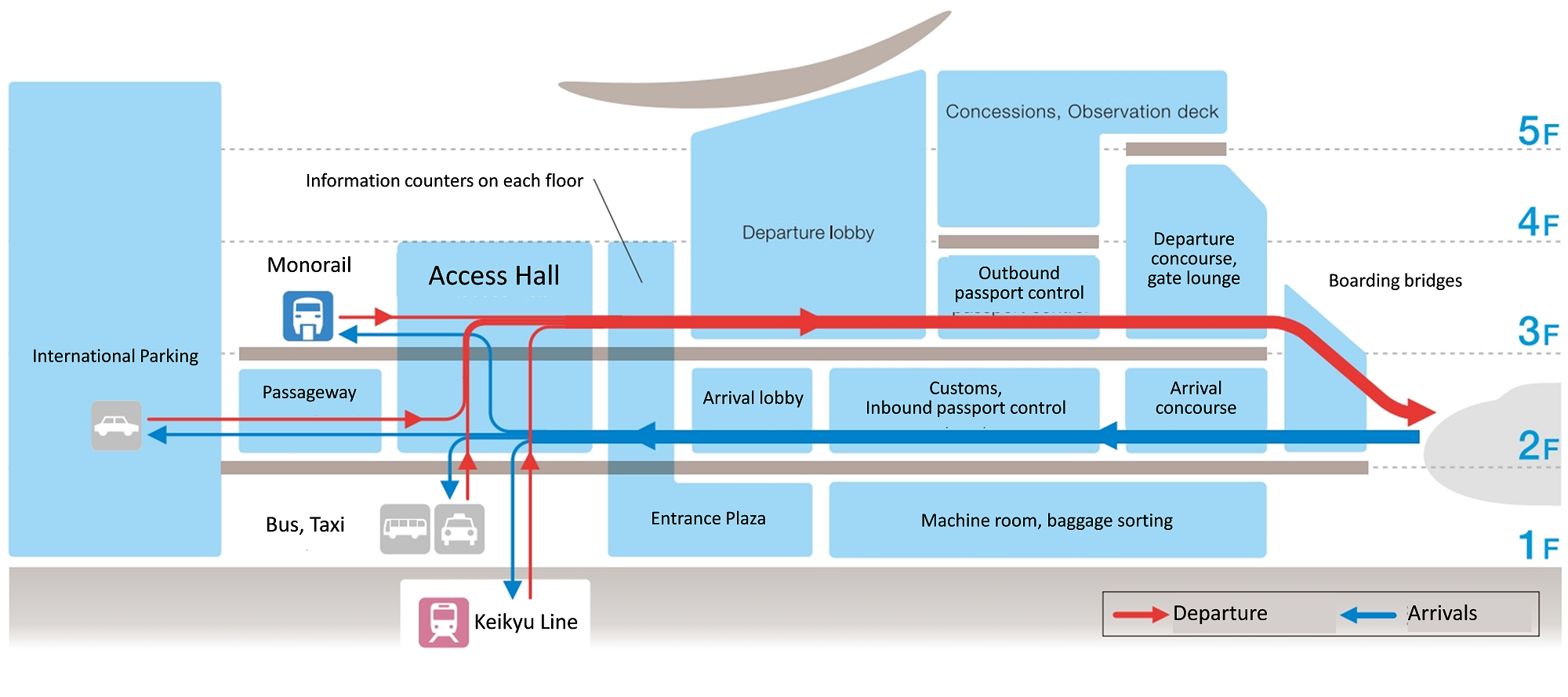Possibilités d'éducation en plein air
Expériences en plein air
Treverton Wildlife Area
L'un des objectifs de l'aménagement de la réserve naturelle de Treverton était de créer des possibilités d'éducation en plein air. De plus en plus de recherches soulignent la nécessité de créer des opportunités pour les enfants, les jeunes et les adultes de faire l'expérience de la vie en plein air. Se concentrer sur les avantages pour les personnes améliore la motivation pour la participation. Comprendre les avantages psychologiques, sociaux, éducatifs et physiques de l'éducation en plein air pour les individus permet une plus grande implication et une utilisation accrue par les éducateurs et l'établissement d'enseignement. Les installations d'éducation en plein air ont permis la réalisation d'activités en plein air (camping, randonnée, pique-nique, projets basés sur l'action, exercice, projets éducatifs, solitaire, etc. Ces opportunités, activités et projets éducatifs en plein air n'ont pas été et ne sont pas les seuls résultats obtenus. Les projets d'éducation en plein air sont planifiés avec l'intention spécifique d'améliorer la biodiversité ou, au moins, de ne pas avoir d'impact sur la biodiversité.
Les explications, étayées par des résultats de recherche, sur les avantages significatifs des événements, projets et activités de plein air encouragent la participation qui, à son tour, facilite les projets liés à la biodiversité. Il est impératif de procéder à une planification appropriée avant un événement ou un programme éducatif. Cette planification doit inclure une analyse des risques et des procédures. Des informations à ce sujet doivent être communiquées aux participants. Plus un programme/projet est mené, plus le projet peut être reproduit au profit de la biodiversité.
Il faut du temps à certains maillons de la chaîne pour comprendre les concepts présentés et les avantages des projets d'éducation en plein air. Par exemple, il faut comprendre comment les activités en plein air sont bénéfiques pour les individus qui peuvent ensuite avoir un impact sur la biodiversité en menant des projets spécifiques dans la zone protégée.
Une fois qu'un leader d'une communauté de pratique "adhère" au concept, d'autres suivront. Une fois qu'un projet a été mené et que ses avantages ont été "annoncés" à d'autres, les retombées se font sentir lorsque le projet suivant est développé. Il est important de réduire les obstacles à la participation.La réalisation d'une évaluation complète des risques liés aux activités et l'élaboration de protocoles avec des mesures de contrôle pour les projets d'éducation en plein air facilitent le processus de planification et éliminent certains des obstacles à la participation des apprenants à des activités en plein air.