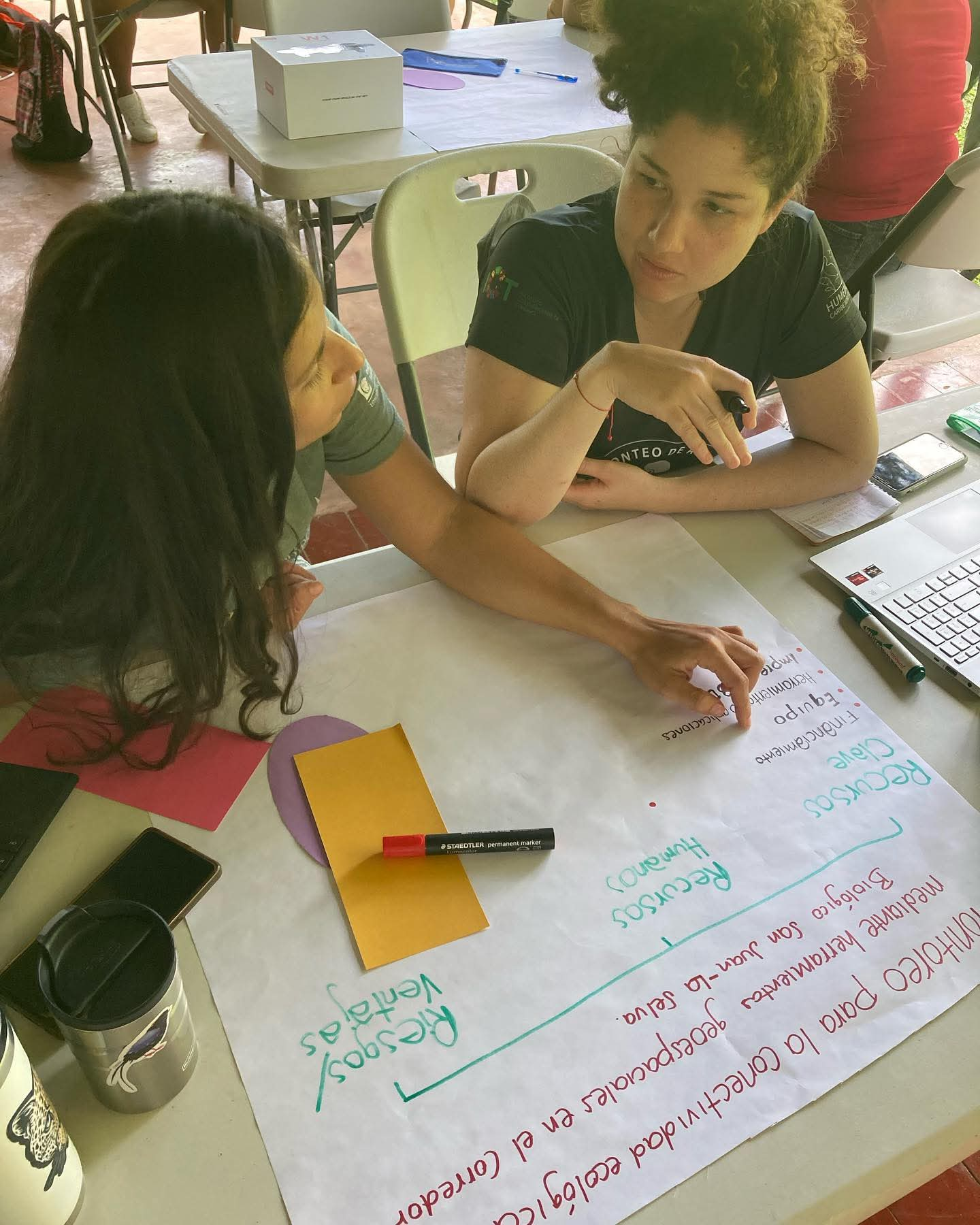Renforcer le partenariat World Rowing - WWF International pour passer de la sensibilisation à l'action
Connecter les bureaux locaux du WWF et les fédérations nationales d'aviron et les clubs du monde entier pour collaborer sur des actions et des projets ayant un impact.
Les athlètes ambassadeurs, acteurs clés de la réussite des objectifs de l'Alliance pour des eaux saines