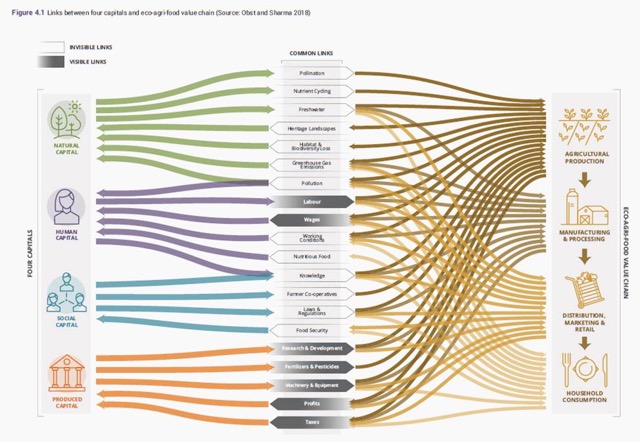Nature Trust Alliance : un partenariat pour des services partagés afin de réduire les coûts administratifs
Alliance pour la protection de la nature
NTA
PONT fait partie d'une coopération entre quatre fonds appelée Nature Trust Alliance (NTA), pour partager des services opérationnels. La NTA a été établie entre le Caucasus Nature Fund (CNF) et PONT en juin 2016. En mars 2017, le Blue Action Fund a rejoint le partenariat de travail, suivi par le Legacy Landscapes Fund en 2020. La mission de NTA est de "fournir un soutien opérationnel à nos partenaires pour leur permettre de se concentrer sur leurs missions principales en matière de conservation de la nature". Le bureau de la NTA se trouve à Francfort, car les quatre fonds partenaires de la NTA sont des fondations enregistrées en Allemagne. Le NTA a permis à PONT d'établir son bureau de programme régional à Tirana, en Albanie, à partir duquel le programme de subventions est géré. Grâce à ce partenariat de services partagés, PONT économise des coûts administratifs (paiements, comptabilité, rapports, audits, soutien à l'investissement, communication).
Renforcement de la position de négociation avec les prestataires de services externes (banques, auditeurs, etc.)
Economies d'échelle grâce à la mise en commun de certains services
Gains d'efficacité dans l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles procédures, de nouveaux systèmes et de la conformité à la législation (1 fois pour l'élaboration/4 fois pour l'utilisation)
Comité d'investissement et politiques d'investissement partagés
Il est important d'analyser, de définir et d'approuver les services partagés potentiels. S'il n'y a pas d'économies d'échelle attendues, il n'est pas conseillé d'en faire un service partagé, car le niveau de complexité augmente dans une structure de services partagés. Les services de type identique s'intègrent mieux dans un concept de services partagés. Dans le cas du NTA, cela signifie que les services administratifs et les services liés à l'investissement en Allemagne sont des services partagés. Les programmes de subvention et les services administratifs spécifiques aux sites étant différents pour les quatre fonds, ils ne sont pas inclus dans les services partagés.
Les attentes, les procédures et la structure de gestion et de gouvernance doivent être discutées et approuvées dès le départ. Des outils de communication et de prise de décision clairs et faciles à utiliser doivent être mis en place. Le partage régulier des connaissances permet une amélioration continue grâce à l'apprentissage mutuel. Un bureau de services partagés existant peut être très bénéfique pour les nouveaux fonds dans leur phase de démarrage, leur permettant de démarrer rapidement. Toutefois, l'entrée d'un nouveau fonds partenaire doit être soigneusement étudiée et il doit y avoir suffisamment d'éléments communs pour que cela soit bénéfique.