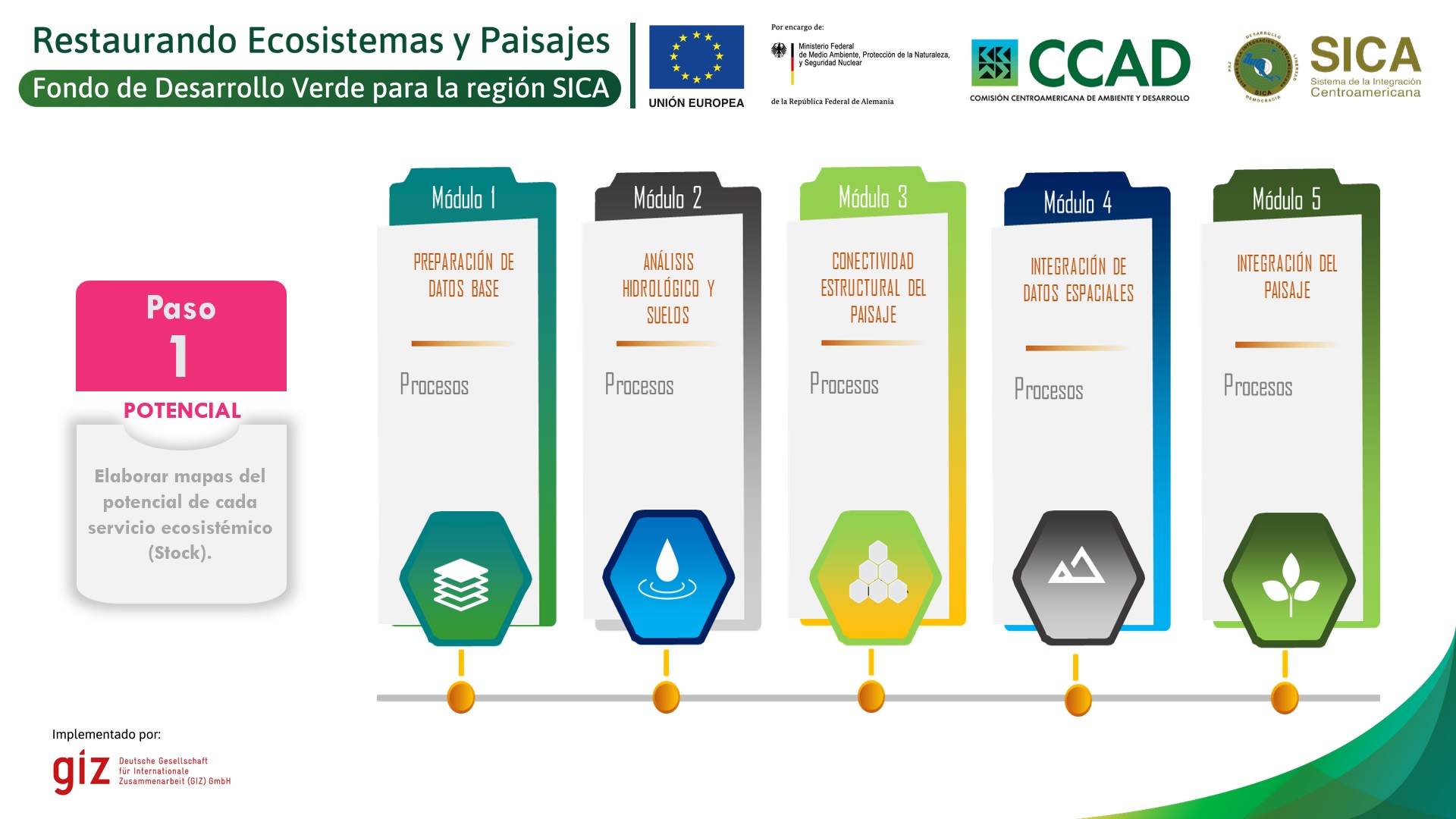Ressources humaines pour la formation des rats
APOPO forme des rats de détection olfactive, mais aussi des dresseurs et des superviseurs de rats de détection olfactive. Les connaissances en matière de dressage des animaux, la compréhension du bien-être et des soins, ainsi que les compétences en matière d'encadrement sont nécessaires pour que les rats franchissent avec succès les différentes étapes de leur formation. En investissant dans le capital humain, nous pouvons soutenir plus efficacement les progrès de nos animaux.
Les valeurs fondamentales d'APOPO sont la qualité, l'innovation, la transformation sociale, la diversité et la solidarité. Dans cette optique, l'équipe de projet actuelle est composée de quatre femmes et de trois hommes, dont six sont tanzaniens. En embrassant et en encourageant la diversité, le développement du projet bénéficie d'un large éventail d'expériences.
Personnel motivé, renforcement des capacités, échange international de processus nouveaux et émergents de formation et d'apprentissage des animaux, pensée critique, volonté d'apprendre et travail d'équipe.
La sélection des membres du personnel avant leur embauche en tant que dresseurs d'animaux doit porter non seulement sur leurs compétences et qualifications théoriques, mais aussi sur la question de savoir s'ils sont à l'aise dans la manipulation d'un rat. La formation continue et le renforcement des capacités tout au long du processus améliorent les compétences des dresseurs et permettent une montée en gamme en interne. Cela crée des incitations, une forte motivation et favorise l'intégrité. Il convient d'accorder une attention particulière au traitement équitable du personnel et à l'égalité d'accès aux opportunités et à l'équité.
Grâce à la forte représentation des femmes dans son équipe, APOPO montre également l'exemple. Elle accroît la visibilité des femmes dans les sciences au sein des communautés et auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons.