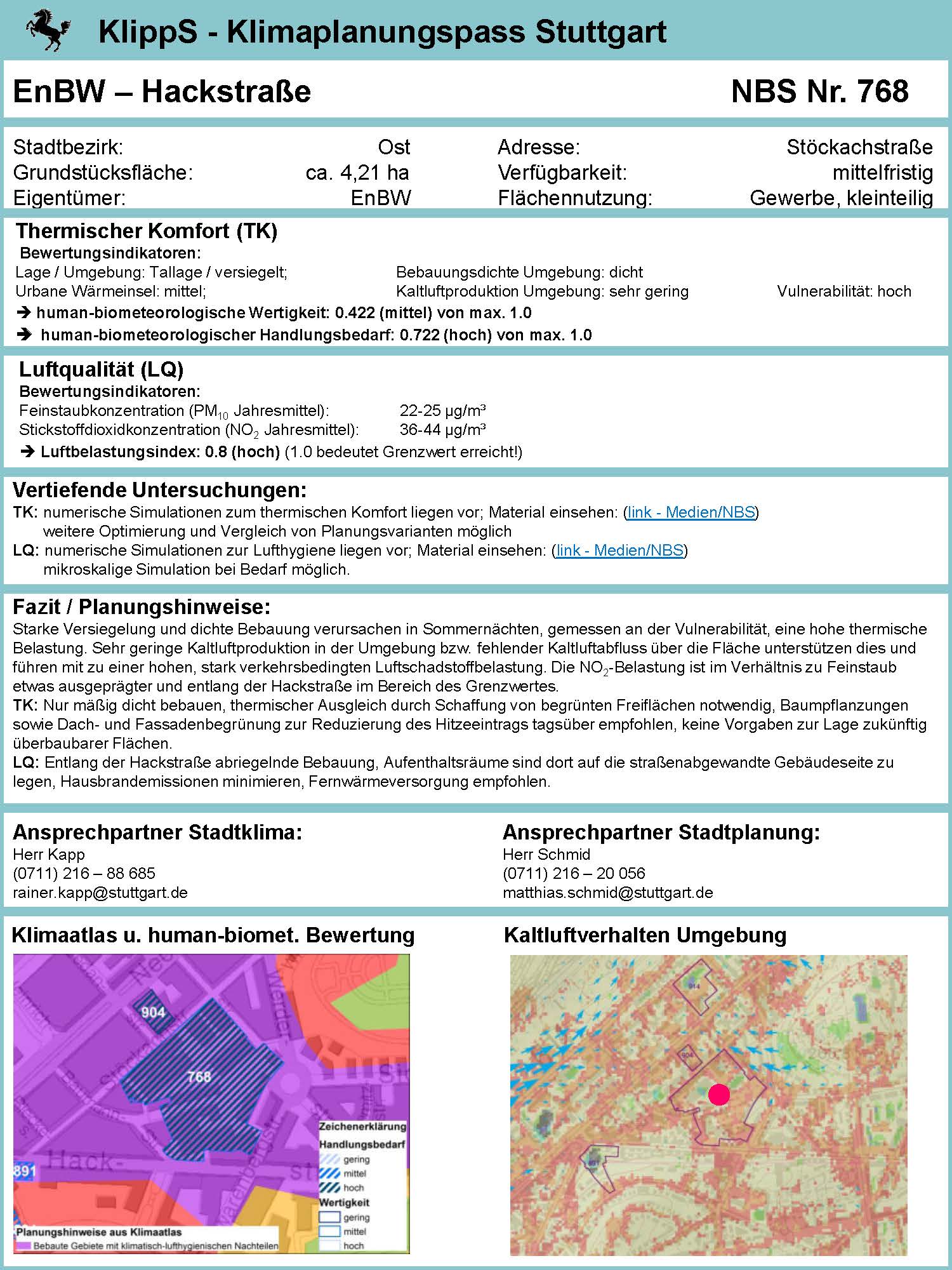Mise en œuvre à grande échelle de systèmes agroforestiers dynamiques
La famille de producteurs et son jardin sont toujours liés à une sphère plus large, comme les relations entre les sexes et les générations, l'organisation sociale, la communauté, les marchés locaux et internationaux, les cultures et, ce qui est souvent négligé comme important, la religion et/ou la spiritualité. Ces aspects doivent cependant être considérés dans le cadre du concept de formation.
La méthodologie proposée est basée sur une période de formation théorique et pratique intensive des formateurs locaux (facilitateurs) et des agriculteurs principaux. En outre, les participants doivent "reconstruire" leurs connaissances sur leurs propres parcelles. La pratique individuelle doit être supervisée et accompagnée par un formateur expérimenté en agroforesterie dynamique.
Les chefs de file présentent leur savoir-faire pratique et documentent les processus expérimentés au cours de la période d'installation suivante. De cette manière, une mise en œuvre pratique des concepts travaillés peut être réalisée dans un contexte concret pour le niveau de production d'une famille rurale.
Le passage à l'échelle se fait de la manière suivante :
- 1 facilitateur local formé forme 10 agriculteurs principaux
- 10 agriculteurs chefs de file accompagnent chacun 5 à 10 agriculteurs dans la mise en œuvre du DAF
- 10 formateurs accompagnent 100 chefs de file
- 100 chefs de file = 500 à 1000 adeptes
- Un concept à long terme consistant à développer des programmes pour au moins 5 ans
- Un cadre institutionnel participatif
- Personnel engagé et ouvert
- Budget pour la formation, le suivi, l'équipement et le contrôle
- Sélection précise des formateurs locaux et des agriculteurs principaux
- Des formateurs seniors SAF compétents sur le plan pratique
- Accès au marché pour les cultures de rente
- Avantages à court terme pour les agriculteurs (récoltes annuelles, moins de travail, pas de dépenses pour des intrants externes)
L'expérience la plus importante est l'avantage de la préparation du sol sans feu. L'avantage des SAF est déjà visible après quelques mois, ce qui encourage les agriculteurs à étendre progressivement les parcelles d'apprentissage à l'ensemble de la plantation. Les besoins économiques à court terme favorisent les monocultures avec des intrants externes coûteux, ce qui crée d'autres besoins économiques à court terme. En outre, l'agriculture n'est pas un avenir souhaitable pour beaucoup, et les jeunes migrent vers les villes (conflit générationnel). Les mégaprojets nationaux tels que les barrages menacent les initiatives locales. D'autres conditions défavorables sont les besoins de base non satisfaits, les mauvaises infrastructures et les conditions climatiques extrêmes qui empêchent de se consacrer à des initiatives SAFS à long terme. Cependant, nous constatons une prise de conscience croissante de l'importance de préserver les arbres et la biodiversité, ainsi qu'un intérêt pour les SAF en raison de la nécessité de restaurer la fertilité des sols, et parce que les familles constatent que ceux qui mettent en œuvre le mode sont moins affectés par les effets du changement climatique, ont de meilleures conditions de travail, une alimentation plus saine et plus diversifiée, et de meilleurs marchés (par exemple pour le cacao, le café, la noix de coco ou la coca biologiques).