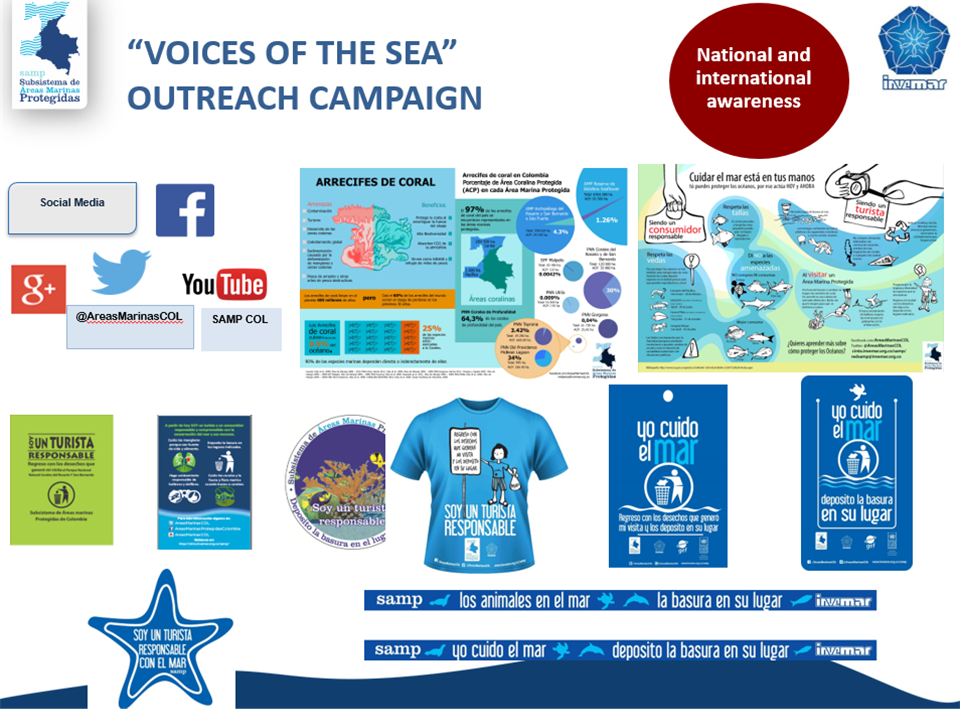Le SAMP est établi et soutenu par un cadre juridique, institutionnel et opérationnel.
L'APMM est établie et soutenue par un cadre juridique, institutionnel et opérationnel.
-Cadre juridique, institutionnel et opérationnel :
8,6 millions d'hectares sous protection (8,9% environ des zones marines)
11 nouvelles AMP (l'objectif initial était de 3)
2 plans d'action élaborés et soutenus : SIRAP Caribe y Pacífico : a) analyse des parties prenantes, mécanismes d'articulation, plans de travail et actions spécifiques pour les AMP à inclure dans les plans d'action ; b) révision de l'état des processus pour l'établissement des SIRAP, tout en prenant en compte les lignes directrices du SINAP et en facilitant les actions coordonnées au sein des AMP.
-Développements juridiques
Conception et début de la mise en œuvre du plan d'action SAMP 2016 - 2023
Adoption formelle du SAMP par le CONAP (Conseil national des aires protégées)
Accords opérationnels
Ces résultats contribuent à garantir un échantillon représentatif de la biodiversité côtière et marine à plusieurs niveaux d'organisation biologique ; à assurer la continuité des services écosystémiques ; à maintenir les éléments naturels associés à des objets d'importance matérielle et immatérielle essentiels aux valeurs culturelles ; et à garantir les processus écologiques qui maintiennent la connectivité de la biodiversité marine.
La complexité des écosystèmes marins nécessite des approches imaginatives en matière de conservation dans des zones où les communautés sont presque entièrement dépendantes des biens et services naturels. Des transactions entre les acteurs locaux et les institutions publiques sont nécessaires par le biais d'accords visant à assurer la durabilité des écosystèmes tout en fournissant des moyens de subsistance aux communautés.